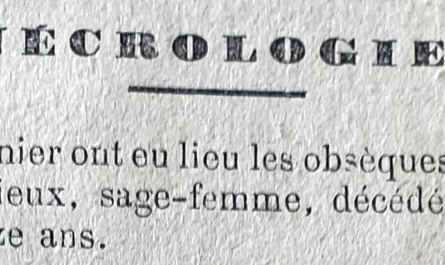Actes du quatre-vingt-onzième congrès national des Sociétés savantes, Rennes, 1966 : Section d’histoire moderne et contemporaine. Histoire maritime et coloniale. Comité des travaux historiques et scientifiques (France). Section d’histoire moderne et contemporaine. Éditeur scientifique. 1969.
LA PÊCHE ET LE COMMERCE DE LA MORUE
AUX ILES SAINT- PIERRE-ET-MIQUELON
DE 1763 À 1793
par Jean-Yves RIBAULT
A propos du traité de Paris, du 10 février 1763, qui enlevait à la France son domaine d’Amérique du Nord, à l’exception des modestes îlots de Saint-Pierre-et-Miquelon et d’un droit de pêche à Terre-Neuve, on a beau jeu d’opposer le sacrifice de Montcalm au dédain sarcastique de Voltaire pour les « quelques arpents de neige » du Canada.
Après deux siècles, quand on voit ce qu’est devenu le Canada, Voltaire fait figure d’imbécile. Et pourtant, sur le fond du problème, Montcalm n’était pas loin d’être d’accord avec l’écrivain. Le 4 avril 1757, il avait écrit au ministre Berryer une lettre qui fut interceptée par les Anglais. Cette lettre a été publiée et elle contient ce passage qui définit clairement en quoi consistaient les intérêts français en Amérique du Nord au milieu du XVIIIe siècle : « Si le Canada devait être cédé, ce ne serait pas une perte irréparable, car je suppose que la Cour ne livrerait pas la Pêche, source des richesses; pour cela, il serait nécessaire de posséder Louisbourg ou quelque île voisine et d’apporter nos marchandises aussi pour les Anglais, et ce petit port ou poste nous serait aussi favorable que le Canada serait défavorable aux Anglais. » (1).
Ainsi donc, pour Montcalm, comme pour les théoriciens de la colonisation (tels l’abbé Raynal) et pour les négociants métropolitains, le Canada, colonie de peuplement, présentait moins d’intérêt pour le commerce français que cette véritable colonie d’exploitation que constituaient les eaux Terre-neuviennes, « l’un des viviers où le monde s’alimente depuis le XVIe siècle » (Robert Perret) (2).
Cet aspect essentiel de l’histoire de l’Amérique du Nord, les historiens français l’ont en général assez ignoré et il a fallu attendre la parution en 1962 du monumental ouvrage de M. de La Morandière, Histoire de la pêche française de la morue dans l’Amérique septentrionale, pour en avoir une vue d’ensemble (3).
Afin de bien préciser l’importance de ce commerce, je voudrais citer deux séries de chiffres établies par M. de La Morandière.
En 1786, 386 navires, totalisant 42 241 tonneaux et portant 12 469 hommes d’équipages, pêchèrent à Terre-Neuve 367 559 quintaux de morue sèche et 3 175 134 morues vertes, dont la vente produisit 10 892 010 livres.
Par ailleurs en 1784, dans le tableau d’ensemble des pêches maritimes, Terre-Neuve figure pour 60 du tonnage total et 45 du nombre d’hommes d’équipage.
Ce sont des chiffres qu’il faut avoir en tête pour apprécier la portée et le sens du traité de Paris et la place des îles Saint-Pierre-et-Miquelon dans l’histoire de la rivalité franco-anglaise en Amérique du Nord au XVIIIe siècle. Après Plaisance (Terre-Neuve), après Louisbourg (île Royale), elles formèrent le troisième et dernier établissement français chargé de préserver et d’exploiter notre droit de pêche à Terre-Neuve, que l’Angleterre chercha avec opiniâtreté à nous enlever au cours du XVIIIe siècle.
Les îles Saint-Pierre-et-Miquelon L’histoire elle-même des îles ne nous retiendra pas longtemps (4).
Il suffit de savoir qu’elles ne furent au XVIe siècle qu’un petit poste de pêche, découvert, semble-t-il, par les Portugais en 1520, puis rapidement fréquenté par les navires bretons. Les îles furent habitées à partir de 1660 environ et pourvues d’un embryon d’organisation sous la direction d’un commandant nommé en 1694; elles dépendaient du gouvernement de Plaisance (Terre-Neuve) et furent cédées aux Anglais, comme Plaisance elle-même, par le traité d’Utrecht en 1713. Louisbourg prit alors la relève et connut grâce à la pêche sédentaire une remarquable prospérité jusqu’en 1758, date à laquelle les Anglais s’emparèrent de l’île Royale. La France ne possédait plus alors aucun établissement de pêche en Amérique du Nord; le commerce de la morue sèche était si important pour les ports de France que tous les négociants et tous les armateurs demandèrent à la Cour de se faire reconnaître la possession d’un poste de pêche. Choiseul, sans se préoccuper davantage du Canada, n’eut de cesse qu’il n’obtînt, pour remplacer Louisbourg, les îles Saint-Pierre-et-Miquelon, malgré la farouche opposition de l’opinion publique anglaise, représentée au Parlement par l’intraitable William Pitt.
Les îles furent peuplées à partir de 1763 par d’anciens colons de l’île Royale puis par quelques centaines d’Acadiens, victimes du « grand dérangement » de 1755 et qui s’évadèrent de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-Ecosse, pour venir s’installer à Miquelon.
En outre, les colons faisaient venir de France à leur service une main-d’œuvre de pêcheurs. On peut calculer, malgré le manque de stabilité de la population, que les îles comptaient environ 1 500 colons sédentaires ; les engagés faisaient monter ce chiffre à 2 000 habitants environ ; l’été, avec les équipages de pêche, 2 500 à 3 000 personnes fréquentaient la colonie.
Les plus notables colons, tels Dupleix-Sylvain et Rodrigue, étaient originaires de l’île Royale, ainsi que les officiers et les fonctionnaires.
L’expérience qu’ils possédaient du commerce maritime leur permettait de tirer parti de l’excellent port de Saint-Pierre, où se concentrait toute l’activité commerciale et artisanale de la colonie.
L’île de Miquelon, au contraire, ne possédait aucun mouillage sûr, mais quelques prairies et terres cultivables. Les Acadiens, anciens fermiers, s’y étaient installés et s’adaptèrent difficilement à leur nouveau métier de pêcheurs.
L’activité de la colonie fut interrompue le 13 septembre 1778 par l’arrivée d’une escadre anglaise et les îles ne furent rendues qu’en 1783 par le traité de Versailles. Une nouvelle fois, le 14 mai 1793, le commandant de la colonie fut forcé de capituler et les habitants connurent un nouvel exil jusqu’au second traité de Paris en 1815.
Telle fut dans ses grandes lignes l’histoire de la colonie. « Je sais bien, écrivait Choiseul, au gouverneur Dangeac, le 12 avril 1763, que les isles Saint-Pierre et Miquelon pourront avec le temps devenir un entrepôt assez considérable de commerce; mais elles ne le peuvent qu’autant que la base de leur établissement qui est la pêche et la sècherie prendra des accroissement » (5). Poste de pêche et comptoir commercial, telle était la double fonction économique assignée par le gouvernement au petit territoire.
La nouvelle colonie justifia-t-elle les espoirs que l’on plaçait en elle? Les îles Saint-Pierre-et-Miquelon devinrent bien un poste de pêche florissant, mais jamais elles ne connurent la prospérité de l’île Royale. Colons et négociants métropolitains exploitaient les pêcheries en une collaboration qui n’allait pas toujours sans heurts; l’exportation de la morue sèche en France constituait l’essentiel de l’activité commerciale de la colonie. Pourtant, les îles Saint-Pierre-et-Miquelon entretinrent aussi avec les Antilles françaises et les ports de la Nouvelle-Angleterre et des Etats-Unis des relations dont l’étude ne manque pas d’intérêt.
 LA PÊCHE
LA PÊCHE
A partir de 1763, les armateurs français disposèrent, pour faire la pêche de la morue, du grand banc de Terre-Neuve, de la côte du Petit-Nord sur l’île de Terre-Neuve depuis le cap Bonavista jusqu’à la pointe Riche, et des îles Saint-Pierre-et-Miquelon. A chacun de ces lieux correspondait une technique particulière. Sur le grand banc se pratiquait la pêche errante; les matelots jetaient leurs lignes du bord même de leurs goélettes; les morues étaient vidées, tranchées et salées et le résultat de cette préparation portait le nom de morue verte. Au Petit-Nord, la pêche à la côte permettait en outre de faire sécher sur les graves (6) les morues, préalablement recueillies dans des chaloupes et débarquées sur l’échafaud (7), construit à terre, où elles étaient « habillées et salées »; cette technique produisait la morue sèche qui se conservait bien plus longtemps et qui, pour cette raison, se consommait surtout dans les régions méridionales de l’Europe.
Enfin, aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon, comme auparavant à l’île Royale, se pratiquait la pêche sédentaire, caractérisée notamment par la présence permanente des pêcheurs sur la côte et un statut particulier des graves (8) (voir fig.). C’est de cette dernière catégorie, et uniquement d’elle, que nous nous occuperons.
- DESCRIPTION GÉNÉRALE.
La description générale de la pêche sédentaire montre qu’il s’agissait d’une technique fort complexe. Elle avait d’abord l’avantage sur les deux catégories précédentes de durer plus longtemps;’ on y distinguait en effet deux phases : la pêche d’été et la pêche d’automne.
Ces deux phases se subdivisaient elles-mêmes en plusieurs périodes, avec l’apparition des appâts successifs ou « boëtte »; on sait que la morue, très vorace, suivait les déplacements de certains petits poissons dont elle faisait sa nourriture. Ainsi, de la première quinzaine de mai jusqu’à la fin de juin, elle apparaissait sur les bancs de Saint-Pierre et de Miquelon à la suite du hareng; c’était l’époque de la « morue de primeur », la plus grosse, puisque 30 morues suffisaient à faire le quintal, et la plus chère sur les marchés européens. Aux environs de la Saint-Jean, arrivait le capelan; la morue le suivait en quantité prodigieuse, mais d’une taille et d’une qualité inférieures à la précédente; il en fallait 40 à 45 pour faire le quintal. A la fin de juillet, le capelan était remplacé par l’encornet; au début du mois d’octobre et jusqu’à la mi-décembre, le hareng revenait à la côte, beaucoup plus gros d’ailleurs que l’espèce apparue au mois de mai, et attirait des morues aussi grandes que celles de primeur, mais plus grasses et plus difficiles à sécher à cause des conditions atmosphériques. On laissait le produit de la pêche d’automne dans le sel jusqu’au mois d’avril suivant; on lavait alors ces morues et on les étendait sur les graves; on obtenait ainsi une denrée de qualité inférieure, qui, jointe au rebut de la campagne de pêche qui formait en général le huitième du produit total, était vendue à bas prix aux Antilles, sous le nom de morue de réfaction, pour servir de nourriture aux esclaves noirs (9).
Si la morue sèche constituait le produit principal de la pêche sédentaire, il n’était pas le seul; chaque année, les bâtiments métropolitains emmenaient quelques dizaines de milliers de morues vertes. En outre la pêche de la morue avait ses sous-produits. L’huile de foie de morue, comme toutes les huiles de poisson, servait à l’industrie du cuir; les tanneries l’utilisaient pour assouplir les peaux qu’elles traitaient (10); elle pouvait également pallier une éventuelle pénurie de chandelles et fournissait un éclairage qui, pour être nauséabond, n’en était pas moins très vif. La barrique d’huile de 30 weltes, produite par 90 à 100 quintaux de morues, se vendait 90 à 105 livres et les îles Saint-Pierre-et-Miquelon en produisaient quelques centaines par an. Les œufs de la morue de primeur, sous le nom de rogues ou raves, se vendaient aux Basques pour la pêche du hareng et de la sardine, 25 à 30 livres la barrique produite par 50 quintaux de morue (11).
Enfin, les langues des morues, arrachées par les pêcheurs et enfilées sur des baguettes pour calculer le nombre de poissons pris, pouvaient également constituer un article de consommation.
Le voisinage des îles Saint-Pierre-et-Miquelon avec le grand banc et le banc de Saint-Pierre permettait de ne pas limiter la pêche aux côtes de la colonie. Si les banquereaux et le banc à Vert n’étaient guère fréquentés (12), le banc de Saint-Pierre à environ 75 kilomètres des îles, fournissait un des plus beaux poissons de Terre-Neuve; certains capitaines poussaient même jusqu’au grand banc où la morue était plus abondante et demeurait plus longtemps qu’à la côte. Ces voyages exigeaient naturellement des bâtiments pontés, capables de tenir la mer et de transporter une grande quantité de poisson; on employait donc des brigantins, de 80 à 100 ou 120 tonneaux, à deux mâts gréés de voiles carrées (c’est-à-dire en forme de trapèze régulier ou de rectangle), et surtout des goélettes, de 30 à 70 ou 80 tonneaux, à deux mâts également, mais gréés de voiles latines (en forme de triangle) (13); ces bâtiments faisaient trois à quatre voyages par campagne. Le poisson était préparé et salé sur les fonds même, il ne restait plus qu’à le sécher sur les graves. Certains habitants envoyaient parfois sur le banc de Saint-Pierre de grandes chaloupes, embarcations non pontées, marchant à l’aviron ou à la voile, mais la crainte des gros temps les retenait le plus souvent à cinq ou six lieues au large des côtes; les embarcations plus petites ne s’aventuraient pas en général à plus de deux lieues. Les demi-chaloupes et canots servaient à prendre la boëtte avec des filets ou « sennes »; ils recueillaient ces appâts dans les rades et les baies, le long de la côte (14).
L’abondance et la qualité de la boëtte étaient très importantes pour le succès de la pêche. Chaque chaloupe et chaque bâtiment ponté en emmenait une provision, car on pêchait alors à la ligne de main.
La fameuse ligne de fonds ou ligne dormante, inventée par le capitaine Sabot de Dieppe, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, provoqua de grandes contestations; le 14 février 1788, le ministre interdit son utilisation, mais le 2 mars, il revenait sur cette décision et voulait bien avertir les Chambres de commerce de Granville, Saint-Malo et Dieppe qu’il tolérait l’emploi de lignes de fonds pour les armements à la morue sèche et seulement pour la pêche « le long du bord et aux petites cordes, non en chaloupes » (15). Chaque matelot disposait de deux lignes munies à leur extrémité d’un plomb et d’un « haim » ou hameçon où il accrochait son appât. Lorsqu’il manquait de boëtte, le pêcheur se servait d’un hameçon spécial appelé le « faux »; au bout de la ligne était suspendu un poisson de plomb armé de deux crochets ; animé d’un mouvement incessant, cet hameçon accrochait au hasard dans la masse des morues un ou deux poissons, non sans en avoir auparavant tué ou blessé plusieurs autres. Toute la journée, le pêcheur retirait ainsi une ligne, décrochait la morue, plaçait un nouvel appât.
rejetait sa ligne et recommençait les mêmes opérations avec la seconde, On imagine combien ce travail incessant, dans la brume, l’humidité et l’inconfort, parfois même la tempête, pouvait être pénible.
- LES ARMEMENTS.
Les conditions générales de temps et de lieux auxquelles la pêche sédentaire était assujettie étant ainsi définies, examinons le détail des armements. On peut classer ces armements en trois grandes catégories : celle des embarcations non pontées, celle des bâtiments pontés appartenant aux colons, celle des bâtiments pontés appartenant aux armateurs métropolitains.
- L’armement des embarcations non pontées.
La plupart des habitants de la colonie faisaient la pêche près des côtes au moyen d’embarcations non pontées, à un seul mât, gréé en
voiles latines ou carrées, avec une quille : les chaloupes. Chaque chaloupe allait pêcher et ramenait son poisson à l’échafaud où un piqueur coupait la tête de la morue, l’éventrait et la passait au décoleur; celui-ci la vidait et la transmettait à l’habilleur qui la tranchait pour la mettre à plat ; puis le poisson ainsi « habillé » passait au saleur qui le plaçait dans le sel où il demeurait huit à dix jours; après avoir été lavé, on l’étendait alors sur les graves où il séchait assez longtemps; mis en piles, il « suait » pendant quelques jours; on le replaçait alors sur la grave pour qu’il achevât de sécher. Le personnel spécialisé de l’échafaud était commun pour plusieurs chaloupes. Chaque embarcation disposait d’un personnel autonome, formé de 3 matelotspêcheurs et de 2 graviers.
Il est bien difficile de calculer les frais d’armement de ce genre de pêche. En 1768, Loyer-Deslandes estimait à 1 022 livres la construction et l’équipement d’une chaloupe; il calculait que le produit de la pêche, sur la base de 150 quintaux par saison, vendus à 18 livres 10 sols le quintal, se montait à 2 775 livres; le bénéfice du propriétaire de la chaloupe était donc de 1 753 livres par an, chiffre rassurant pour la prospérité des colons (16). L’ordonnateur Beaudéduit rectifiait ce calcul; il estimait, quant à lui, que la construction, l’équipement et, en outre, ravitaillement d’une chaloupe ne pouvaient coûter moins de 1 600 livres; le profit n’était donc plus que de 1175 livres, mais sur cette somme, devaient vivre deux ou trois familles, car la plupart des habitants possédaient une chaloupe en société (17). Ces chiffres furent établis pour les premières années de la colonie. Avec le temps, les frais se firent plus nombreux et plus considérables; il semble que les chaloupes étaient devenues plus grosses. En 1789, la situation était si grave que le commandant de la station (18), M. de Vaugiraud, fit assembler les habitants et les propriétaires pour avoir leur avis (19). Il résulta de leurs calculs qu’à la fin de la campagne, le propriétaire d’une chaloupe était déficitaire. En effet, la construction, l’équipement et l’avitaillement d’une chaloupe revenaient à 3 208 livres ; relevons parmi les dépenses : 347 livres pour la voile, 60 livres d’abonnement pour la boëtte, 645 livres pour la nourriture de cinq hommes du 1er avril au 10 octobre, 440 livres pour 22 barriques de sel. Une chaloupe pêchait ordinairement dans une année 200 quintaux de morues, dont 24 quintaux revenaient au patron, 42 aux deux compagnons et 30 aux graviers. Restaient à l’habitantarmateur 104 quintaux, qui, vendus au prix de 20 livres le quintal, lui rapportaient 2 068 livres, à quoi il fallait ajouter 90 livres, produit de la vente d’une barrique d’huile (l’autre barrique revenant à l’équipage) ; c’était en tout un gain de 2 158 livres, mais un déficit de 1 050 livres lorsque l’on considérait les 3 208 livres dépensées à l’armement (20). Il s’agit là, bien entendu, d’un calcul théorique, car l’armateur n’était pas obligé de faire construire une chaloupe pour chaque campagne de pêche. Toutefois, l’expérience confirmait l’impossibilité pour le propriétaire de faire un gain appréciable. Le commandant Vaugiraud se rendit aux raisons des habitants et des capitaines et accorda la permission aux colons d’employer autant de warys qu’ils le voudraient.
En effet, jusqu’à cette date, 18 juin 1789, la pêche en wary avait été simplement tolérée pour les pêcheurs pauvres et interdite aux autres (21). Le wary était une petite embarcation à fond plat, d’origine anglaise, utilisée par les pêcheurs français de Terre-Neuve depuis le milieu du XVIIIe siècle environ. Dès les débuts de la colonie, les habitants les plus pauvres, incapables de se faire construire une chaloupe l’avaient utilisée. On ne sait pourquoi les administrateurs en interdirent l’usage général. Il s’avéra pourtant que l’armement d’un wary était beaucoup plus économique que celui d’une chaloupe.
En effet, le même calcul qui révélait en 1789, un déficit de 1 050 livres par chaloupe, faisait ressortir un gain, modeste mais réel, de 180 livres par wary. L’équipage d’un wary ne comprenait que deux matelots et un gravier à terre. Alors que la mise-dehors d’une chaloupe et son avitaillement coûtaient 3 208 livres, ceux d’un wary atteignaient à peine 1110 livres, y compris le salaire du compagnon-matelot (250 livres) et celui du gravier (100 livres) ; la pêche d’un wary produisait 80 quintaux de morue par campagne, dont 20 quintaux revenaient au patron. Le propriétaire pouvait donc vendre 60 quintaux à 20 livres le quintal et la barrique d’huile, ce qui lui faisait un gain de 1 290 livres et un bénéfice de 180 livres (22).
Comment les habitants se procuraient-ils ces embarcations? En 1763, la plupart des habitants étaient arrivés sans chaloupes; le capitaine de vaisseau Tronjoly demandait au duc de Praslin d’en faire passer une vingtaine (23); en 1764, il fut donc envoyé à l’île Saint-Pierre les pièces de bois et les agrès nécessaires à la construction de douze chaloupes; quatre furent construites mais demeurèrent invendues, de même que le bois des huit autres (24). Les habitants avaient en effet construit 320 embarcations depuis l’année précédente, écrivait le gouverneur Dangeac, en rendant hommage au travail de ses administrés (25). Le gouverneur comprenait sans doute dans ce nombre les chaloupes appartenant aux navires métropolitains, car l’année suivante, il ramenait ce chiffre à 310 et en 1766 à 150 chaloupes environ (26). En fait, si nous en croyons l’inspecteur anglais Woodmass, il y avait en 1769 à Miquelon 50 chaloupes environ et à Saint-Pierre 80 (27). Comment concilier ces renseignements contradictoires? Tenons nous en au recensement de 1776 qui dénombrait à Saint-Pierre 154 chaloupes, 84 canots et warys et 14 barquettes pour 29 échafauds et à Miquelon 71 chaloupes et 39 canots et warys pour 23 échafauds (28). La plupart de ces embarcations avaient dû être construites dans la colonie même et plus particulièrement sur l’île de Langlade, comme l’avait remarqué Woodmass; Dangeac reconnaissait d’ailleurs que les Acadiens excellaient dans le travail du bois.
Plusieurs avaient été achetées aux armateurs métropolitains et peutêtre même aux pêcheurs anglais de Terre-Neuve. En tout cas, en 1783, après la reprise de possession de la colonie, le notaire Bordot enregistra de nombreux contrats de ventes de chaloupes par des habitants de Plaisance à ceux de Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui nous fait connaître d’ailleurs les prix de ces embarcations; ils variaient de 313 à 1 200 livres, mais les prix courants étaient de 600 à 900 livres (29). En 1784, la colonie avait refait une partie de sa flottille; les colons de Saint-Pierre possédaient 71 chaloupes, 68 warys, 21 canots et 17 demi-chaloupes pour 14 échafauds ; ceux de Miquelon, 26 chaloupes, 30 warys, trois demi-chaloupes et 2 canots pour 9 échafauds; en 1786 à Miquelon encore, les 92 familles se partageaient la propriété de 44 chaloupes (30).
- L’armement des bâtiments pontés appartenant aux colons.
Les colons plus aisés utilisaient des bâtiments pontés pour faire la pêche sur le banc de Saint-Pierre et sur le grand banc. Ils y employaient quelques brigantins, mais surtout des goélettes de 35 à 50 ou 60 tonneaux, ou même plus, montées par un équipage de huit ou neuf hommes.
L’intérêt de ce genre d’armement résidait dans le fait qu’il n’exigeait pas d’échafauds à terre; la morue était traitée sur la goélette même et il ne restait plus qu’à la faire sécher sur les graves. Chaque bâtiment effectuait, en général, quatre voyages par campagne de pêche et rapportait chaque fois 5 000 à 7 000 morues, dont 38 à 40 faisaient le quintal. A la fin de la saison, l’armateur pouvait donc disposer de 20 000 à 28 000 morues, c’est-à-dire de 500 à 700 quintaux, et de 3 ou 4 barriques d’huile ^31). Venait alors le moment de régler l’équipage selon l’engagement ordinaire aux trois septièmes du produit de la pêche. Soit un équipage de huit hommes (le capitaine, le trancheur, trois compagnons, le saleur, le décoleur et le mousse) et une pêche de 700 quintaux, il revenait donc à l’armateur-propriétaire les quatre septièmes, c’est-à-dire 400 quintaux. Mais comme l’équipage était venu de France sur les navires métropolitains, il devait payer leur passage sur la base de 4 quintaux par homme, en tout 32 quintaux; il donnait en outre à son équipage, lors du désarmement, une prime spéciale de 10 pour s’assurer son réengagement l’année suivante, ce qui lui enlevait encore 70 quintaux. Il lui restait donc 298 quintaux pour acquitter les frais d’armement et d’avitaillement de sa goélette, les primes d’assurance, l’entretien des graves, la solde et la nourriture des graviers et diverses autres charges ’32).
La flottille des bâtiments pontés appartenant à la colonie s’était formée peu à peu. En 1776, existaient à Saint-Pierre 47 goélettes et 2 brigantins et à Miquelon 20 goélettes (33); après la reprise de possession, en 1784, Miquelon n’avait plus qu’une goélette, mais Saint-Pierre disposait de 15 bricks ou brigantins et de 28 goélettes (34).
Comme les chaloupes, plusieurs goélettes avaient été construites dans la colonie même; Woodmass signalait que sur les 14 goélettes qu’il avait dénombrées à Miquelon en 1769, 8 avaient été bâties l’hiver précédent sur Langlade; à Saint-Pierre 6 des 40 goélettes avaient été construites dans les mêmes conditions (35). De nombreux bâtiments furent aussi achetés aux Anglais et aux Américains. En 1768, par exemple, Dangeac signalait l’achat dans la colonie d’une goélette de Boston et d’une autre de Louisbourg; en 1769, Woodmass rencontra à Saint-Pierre un équipage américain qui, son bateau vendu, attendait une occasion de repasser en Nouvelle-Angleterre (36).
En 1770, Dangeac déclarait que 14 goélettes avaient été construites durant l’hiver ou achetées aux Anglais (37). Mais, après 1783, ce commerce prit des proportions considérables; ainsi, en 1788, sur 34 bâtiments américains entrés à Saint-Pierre, 12 y furent vendus; en 1790, il y eut 8 vendus sur 38 entrés (38). Les armateurs métropolitains, tantôt vendeurs, tantôt acheteurs, participaient eux aussi à ce négoce.
Les contrats de vente enregistrés par le notaire de Saint-Pierre donnent des renseignements intéressants sur l’importance de ce marché des navires dans la colonie (39). Les prix variaient beaucoup suivant la jauge, la qualité, l’état et la provenance des bâtiments.
Quelques exemples nous le font voir. Le 28 juillet 1788, Benjamin Petitpas, habitant de Saint-Pierre, vendait sa goélette Le Dauphin, de 60 tonneaux, pour la somme de 5 400 livres, aux capitaines malouins Latouche-Pineau et Dujardin-Pintedevin, agissant au nom de leur associé, l’armateur Jacques Canevas de Saint-Malo; au mois d’octobre suivant, ces mêmes capitaines échangeaient leur goélette la Bonne Société contre celle du capitaine Gilbert, la Joséphine, d’une valeur de 8 100 livres, à quoi s’ajoutait une traite de 2 000 livres sur Saint-Malo. Le 19 août 1788, Bernard Lafitte, agissant par procuration pour un négociant de la Martinique, Jean Dandaule, cédait à son fils André Lafitte le bateau Le Postillon, de 30 tonneaux, pour la somme de 8 000 livres. Le 19 octobre 1788, Pierre Douville vendait au fils du chirurgien, Edme Henry, sa goélette Les Deux Sœurs, de 60 tonneaux, 6 000 livres. Voici d’autres actes de vente enregistrés par le notaire Bordot; le 1er septembre 1790, vente par MichelGodefroy Barriou de sa goélette La Belette, de 40 tonneaux à André Lavaquière qui la paya 2 000 livres ; le 23 octobre, vente pour 9 000 livres de la goélette la Marie, de 80 tonneaux, par Dominique Lissabe à Bernard Lermett de Bayonne, capitaine de navire, agissant pour le sieur Bardoitz, négociant de Saint-Jean-de-Luz, dont il gérait l’armement. Le 29 octobre, Jean Mesdaver dit L’Allemand vendait au sieur Tousac, pour la somme de 3 600 livres, la goélette la Thérèse, de 50 tonneaux, qu’il avait précédemment achetée à un Anglais nommé Duns; le 21 mai 1792, le capitaine Dolabaratz de Saint-Jean-de-Luz « géreur » de l’armement d’un négociant de Bayonne, Lehimas, acquérait pour 9 340 livres la goélette le Hasard du capitaine bordelais Jean Saint-Aignan; le 10 octobre, Luc Richard, de Saint-Pierre, vendait 4 100 livres sa goélette la Miquelon, de 37 tonneaux, au capitaine malouin Guillaume-François Néel; le 18 octobre, Pierre Lourteig opérait une excellente affaire en revendant 5 000 livres à Louis Le Mâle la goélette la Mélanie, qu’il avait achetée 4 060 livres, le 4 juillet 1789, sous le nom de Le Vison, à Robert Barker de Boston. Enfin, pour montrer le peu de valeur des bâtiments construits dans la colonie même, signalons, le 4 novembre.1792, la vente par le sieur La Marche aux sieurs Guillaume Maucel et Jean Hulin, pour la somme de 1100 livres seulement, de la goélette la Marie-Joseph qu’il avait construite à Saint-Pierre en 1788.
Dans ces actes de vente, il est souvent fait mention de sociétés d’armement; il s’agissait le plus souvent des membres d’une même famille qui mettaient leurs capitaux en commun pour armer un certain nombre de bâtiments et se partageaient les bénéfices, s’il y en avait.
Tel était le cas de l’armement Boullot frères et sœurs; l’aîné était capitaine de port à Saint-Pierre; ses quatre frères résidaient dans la colonie et ils avaient réuni le peu de capitaux dont ils pouvaient disposer à ceux de leurs sœurs qui habitaient à Saint-Malo, pour acheter un brigantin L’ Hirondelle, et cinq chaloupes (40). Il existait bien d’autres sociétés dont nous ne pouvons que deviner l’activité.
Souvent la société avait un correspondant en France; ainsi, le 14 octobre 1788, le notaire Bordot enregistra un contrat d’association entre les sieurs Henry, fils du chirurgien, Mainville, aide-chirurgien, Chibeau, habitant de Saint-Pierre, et Saint-Martin, armateur d( Saint-Malo, propriétaires en société du brigantin la Marie, des goélettes la Barker et la Maréchale de Lévis, et de deux chaloupes; les associés se partagèrent la somme de 16 654 livres, bénéfice de la campagne de 1788. Mais les frais d’armement ne cessèrent d’augmenter; en 1789, ils s’élevaient à 27 000 livres, en 1790 à 33 067 livres et en 1791 à 32 867 livres (41). Dans ces conditions, on voit mal comment ces petites sociétés pouvaient faire fortune. On possède même, pour la plus notable d’entre elles, la Société Rodrigue frères, une déclaration de faillite. Le 16 octobre 1792, Charles Rodrigue, après avoir prêté serment, vint déclarer au juge Dupleix-Sylvain qu’il renonçait à poursuivre une expérience devenue trop onéreuse; le juge rapporte ainsi sa déclaration : « Il a toujours eu l’émulation la mieux soutenue et s’est donné les plus grandes peines dans la régie et administration des biens et objets confiés à cette gestion, appartenant à la société formée et existante entre lui et son frère aîné Antoine Rodrigue depuis 1783, mais les dettes dont elle était alors chargée, les pertes et non-valeurs essuyées dans leurs armements, les emprunts et engagements onéreux qu’en conséquence desdites pertes ils ont été obligés de faire, les poursuites de plusieurs de leurs créanciers, la dureté des temps et l’ingratitude de la pêche depuis quelques années en ces îles ont réduit leur commerce dans une situation qui ôte au déclarant tout espoir de jamais satisfaire aux dettes actuelles de ladite société. Il fait abandon général à ses créanciers de tous les biens de la société : à Saint-Pierre, une habitation considérable de pêche avec bâtisses et dépendances; 3 200 quintaux de morue adressés en 1790 à Bayonne et Bordeaux; l’affrètement du navire Le Bon Père, 12000 livres; recouvrement d’assurances : 16000 livres; dû par M. Jean Lasserre à la Martinique, 4 500 livres; à Bayonne les goélettes La Vigilante, la Marie-Antoinette, la Françoise et la Geneviève; à La Rochelle, le navire Le Bon Père; au Port-Louis, le brigantin L’Aimable-Société, d’environ 160 tonneaux, et 5 chaloupes; au Barachois de Miquelon, une prairie étendue sur laquelle on peut faucher, année commune, de douze à quinze cent quintaux de foin »^42^ On voit donc que la société disposait d’un avoir fort important; malheureusement, elle souffrait d’un passif impressionnant ; Rodrigue avouait un déficit de 200 000 à 220 000 livres ; il avait des dettes dans presque tous les ports de France : à Lorient et au Port-Louis, 61 668 livres; à Nantes, 8107 livres; à Saint-Malo, 21 060 livres; à La Rochelle, 8 686 livres ; à Bordeaux, 45 000 livres ; au Havre, 8 500 livres; à Bayonne et à Saint-Jean-de-Luz, 129 131 livres; à Saint-Pierre même, 4 000 livres et diverses autres sommes un peu partout.
Telle fut la fin de la Société Rodrigue frères. Qu’en était-il advenu des autres? Nous l’ignorons, mais on peut penser qu’elles ne furent pas plus florissantes. L’armement des bâtiments pontés appartenant aux colons souffrait en effet de la concurrence des armements métropolitains.
- Les armements métropolitains.
Les négociants des ports de France, particulièrement de Granville, de Saint-Malo, de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz, faisaient pour Saint-Pierre-et-Miquelon, deux sortes d’armements : l’armement en pêche et l’armement en « troc » ou en traite (43). Ils envoyaient d’abord, au mois de mars, des goélettes de 50 tonneaux environ, montées par des équipages de huit hommes qui, en passant sur le grand banc, s’arrêtaient pour pêcher et traiter leur poisson, de la même manière que les goélettes de Saint-Pierre; puis, ils gagnaient la colonie avec leur chargement de morues vertes, pour les faire sécher sur les graves; durant la campagne de pêche, ils effectuaient ainsi trois voyages et emmenaient en France sans les faire sécher les morues vertes du quatrième voyage.
Un peu plus tard, arrivaient dans la colonie des bâtiments d’un tonnage plus important, de 100 à 150 tonneaux, avec un équipage de 16 hommes, ou de 150 à 200 tonneaux avec un équipage proportionné au nombre de chaloupes armées (44). Ces bâtiments venaient directement à Saint-Pierre ou à Miquelon; ils étaient chargés de grandes quantités de vivres et d’ustensiles de pêche et transportaient des matelots-passagers venus de France pour s’engager auprès des colons ou même pour pêcher à leur propre compte. Ces bâtiments, une fois la cargaison débarquée et entreposée dans des magasins, demeuraient au mouillage dans le barachois, tandis que l’équipage partait à la pêche, à raison de 5 hommes (3 matelots et 2 graviers) par chaloupe. En somme, ces deux catégories d’armement, en pêche et en traite, utilisaient les méthodes respectives des armements de la colonie : en embarcations non pontées et en bâtiments pontés.
A la fin du mois de septembre, le jour de la Saint-Michel, on arrêtait la pêche. C’est alors qu’avait lieu le « troc ». En effet, la plupart des – habitants ne pouvaient, faute de goélettes, porter leur poisson en Europe; d’autre part, les gros brigantins ne pouvaient se procurer un plein chargement par la seule pêche de leurs équipages. Alors, on échangeait les cargaisons de vivres contre les morues, sur la base de 20 livres le quintal de poisson.
Quelques-uns des armements métropolitains laissaient une goélette au Barachois de Saint-Pierre, avec quelques chaloupes, pour la pêche d’automne ; mais le plus grand nombre des bâtiments pontés mettaient à la voile dans le courant du mois de novembre, pour gagner l’Europe ou les Antilles.
Les armements métropolitains, et notamment l’armement en « troc », au contraire des deux catégories précédentes, étaient très avantageux. On estimait le bénéfice des bonnes années à 30 ou 40 du capital engagé (45). Ce rapport exceptionnel provenait de certaines conditions particulières d’engagement.
Les armateurs métropolitains se faisaient d’abord payer 4 quintaux de morues le passage des graviers et matelots engagés par les colons.
En outre, ils pratiquaient, envers leurs propres équipages, l’habituel prêt à la grosse aventure. Soit, par exemple une goélette de 45 à 50 tonneaux, montée par huit hommes, l’armateur forçait l’équipage à recevoir lors de l’embarquement un prêt obligatoire; le capitaine recevait 150 livres, le trancheur, 200, les trois compagnons, à 200 livres chacun, 600, le saleur, 180, le décoleur 125 et le mousse 120, en tout une somme de 1 375 livres; les emprunteurs forcés devaient payer un intérêt de 12 %, c’est-à-dire 1 547 livres; le remboursement du capital augmenté de l’intérêt devait se faire, à la fin de la pêche, en morues, sur la base de 13 livres 10 sols le quintal, ce qui faisait 114 quintaux 64 livres; remarquons que le taux courant était de 20 livres le quintal ; la différence constituait naturellement un nouveau profit pour l’armateur. Au total, au bout de sept mois, du 1er mars au 30 septembre, celui-ci recevait donc une somme de 2 292 livres 16 sols, ce qui assurait un bénéfice de 917 livres 16 sols (46).
En outre, lors du « troc » de ses marchandises contre le poisson des colons, l’armateur métropolitain fixait arbitrairement le prix de ses fournitures bien au-dessus du taux pratiqué en France, ce qui constituait une autre source de profit.
Que recevait l’équipage, à la fin de la campagne? Soit, comme précédemment, une pêche de 700 quintaux; suivant l’engagement aux trois septièmes, l’équipage recevait donc 300 quintaux. Cette quantité était alors divisée en parts dont chacun recevait un certain nombre selon sa qualité; il devait d’ailleurs payer sur sa part l’intérêt du prêt à la grosse. Ainsi, le capitaine recevait 72 quintaux 72 livres, moins 12 quintaux 50 livres, donc 60 quintaux 12 livres, qui produisaient, à 20 livres le quintal, une somme de 1 204 livres 8 sols. Des calculs semblables pour les autres membres de l’équipage donnent pour le trancheur : 40 qx 90 1 — 16 qx 66 1 = 24 qx 24 1 qui, multipliés par 20 livres, font 484 livres 16 sols ; pour chaque compagnon : 36 qx 36 1 — 16 qx 66 1 = 19 qx 70 1, X 20 1 = 394 livres; pour le novice : 22 qx 72 1 — 8 qx 33 1 = 14 qx 39 1, X 20 1 = 287 livres 16 sols; pour le mousse : 18 qx 18 1 — 8 qx 33 1 = 9 qx 85 1, X 20 1 = 197 livres. L’huile se partageait par moitié entre l’armateur et l’équipage; chaque homme en retirait environ 40 livres (47).
La plupart des armements métropolitains se faisaient en société.
Nous en connaissons quelques-unes. La société Piquelin avait son siège à Granville; elle disposait de deux navires, d’une goélette et de neuf chaloupes et elle possédait sur l’île Saint-Pierre une « habitation » étendue, gérée par Patrice Letourneur. La société Poyedenot jeune, Destebecho et Cie avait son siège à Bayonne; elle disposait de trois brigantins dont deux étaient armés en « troc », de sept go lettes, d’un bateau et de quatre chaloupes; comme cette société n possédait pas de graves, elle en avait acheté une à René Rosse, pouila somme de 1 800 livres, et avait engagé de grands frais pour la défricher, c’est-à-dire enlever toutes les herbes et disposer les galets; elle louait aussi la grave de Loyer-Deslandes, moyennant 400 livres.
La société Mancel et Desperles, de Brest, possédait le brick l’Union, le navire l’Amitié et quatre chaloupes; elle avait acquis de Bernard Lafitte une portion de terrain payée 2 000 livres où elle avait fait construire un magasin; elle louait la grave de Boullot. La société Miramond de Bayonne était formée par six capitaines de navires, et avait pour « géreur » le capitaine Galant Doyembehere; elle louait trois graves sur l’île aux Chiens et un magasin à Saint-Pierre, pour une somme totale de 2 800 livres ; elle louait, en outre, pour 12 000 livres, le brick La Marie-Louise à son propriétaire Picon. Dernière société importante, celle de la veuve Ernouf de Granville, dont le capitaine « géreur » Jean Lafosse dirigeait une petite flotte de cinq bâtiments ; le poisson était séché sur deux graves louées par les veuves Ravenel et Beaubassin (48).
- LES CONFLITS.
Les trois catégories d’armement avaient entre elles des rapports très étroits, notamment sur trois points dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises : les graves, la main-d’œuvre métropolitaine et le « troc ». î)es conflits ne pouvaient manquer de se produire.
- Les graves.
Chose étonnante, le sol des îles Saint-Pierre-et-Miquelon qui ne pouvait porter aucune culture, tirait sa valeur de l’exploitation des ressources maritimes. Le séchage des morues exigeait, en effet, des portions de sol bénéficiant de certaines conditions : terrain plat, exposé au vent et non au soleil, dont la chaleur cuit le poisson au lieu de le dessécher et favorise en outre l’éclosion d’insectes; les grèves ou graves étaient naturellement tout indiquées pour recevoir les morues; mais il fallait éviter les graves à fond de vase ou de sable sur lesquelles le poisson séchait mal et se corrompait; quand on ne pouvait faire autrement, on construisait des « vigneaux », sortes de banquettes rectangulaires faites de pierres ou de branchages, pour y étaler les morues (49). Bien préférables étaient les graves de galets ou de roches. Les meilleures graves étaient naturellement très recherchées. Sur la côte du Petit-Nord, l’attribution s’en faisait par ordre d’arrivée des navires à l’échafaud du Croc, près du havre de BelleIsle. Aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon, comme auparavant à l’île Royale, elles appartenaient à des propriétaires.
Dans toutes les colonies françaises, il revenait au gouverneur, de concert avec l’intendant, de distribuer les concessions de terre aux habitants t5°). Aussi les instructions données à Dangeac, le 23 février 1763, ne mentionnent-elles rien sur ce sujet. Le gouverneur, aussitôt arrivé à sa destination, se préoccupa d’octroyer des concessions aux colons qui l’avaient accompagné. Il partagea entre eux les seules portions du sol qui avaient un peu de valeur dans un pays aride et voué à la pêche, c’est-à-dire les graves. Selon quels critères le fit-il?
Combien de bénéficiaires y eut-il, cette première année? Nous l’ignorons. Cependant, dès le 30 octobre 1763, le capitaine de vaisseau Tronjoly rapporta à la Cour que les habitants se plaignaient d’une répartition peu juste, trois ou quatre des nouveaux propriétaires étant incapables, pour diverses raisons, de mettre leurs graves en valeur (51).
Aussi, Choiseul écrivit-il à Dangeac, le 3 mars 1764 : « Plusieurs habitants de l’Isle Royale m’ont demandé des concessions. Je n’en ai voulu accorder aucune. Je leur ai fait savoir à tous qu’ils n’avoient qu’à s’adresser à vous pour cet effet. Je ne saurois prendre de parti là-dessus; elles doivent être proportionnées à l’espace du terrain propre à la sécherie et aux échafauds nécessaires; d’un autre côté, il y a des habitants qui méritent plus ou moins de préférence, soit par le plus ou moins de moyens pour la pesche, soit par les pertes qu’ils ont faites lors de la prise de l’Isle Royale ; c’est à vous à concilier ces différents objets autant que la nature du terrain et les circonstances pourront le permettre » (52). Ces sages instructions, Dangeac les suivit-il? On peut le croire quand il écrit : « J’ai cru faire la distribution des habitations de pêche, relativement à la connoissance que j’avois des pertes qu’un chacun avoit faites à l’Isle Royale en biens-fonds semblables » (53). Il avait opéré, selon ce critère, un partage qui fut définitif; en 1764, il y avait à Saint-Pierre 27 concessions sur l’île Saint-Pierre et 19 sur l’île aux Chiens ; ces 46 concessions représentaient une superficie de 161 785 toises carrées, dont 107 856 constituaient d’excellentes graves et le reste, à peu près le tiers, était formé de marais et nécessitait donc l’installation de vigneaux (55). A Miquelon, la situation était un peu différente; les Acadiens qui s’essayaient à la pêche pouvaient disposer de beaucoup plus d’espace, mais, en fait, leurs entreprises n’atteignirent jamais l’ampleur de celles de leurs compatriotes de Saint-Pierre; aussi le seul renseignement dont on dispose pour Miquelon, indique que 86 propriétaires se partageaient en 1784 une superficie de 107 040 toises carrées seulement (56).
Peu de capitaines métropolitains fréquentaient Miquelon; au contraire, ils venaient en grand nombre à Saint-Pierre et ils devaient passer des accords avec les propriétaires des graves; ils ne le faisaient d’ailleurs pas sans renâcler. Ils trouvaient, en effet, anormal que d’s graves fussent possédées par des propriétaires qui ne s’en servaient pas et tout aussi anormal qu’eux-mêmes, les pêcheurs, fussent obligés de les louer. Le 7 avril 1765, le ministre jugea nécessaire de transmettre leurs plaintes à Dangeac : « Les concessions de graves sur les côtes des isles Saint-Pierre et Miquelon exigent, Messieurs, de votre part la plus sérieuse attention : il m’est revenu qu’elles avoient été distribuées la plupart à d’anciens habitants de l’Isle-Royale qui, ne s’étant pas trouvé en état de les exploiter eux-mêmes, les ont louées aux capitaines de navire qui sont allés faire la pêche. M. Dangeac m’a même informé qu’il s’étoit élevé entre eux des difficultés sur le payement. Par exemple, le sieur Beaubassin a eu une concession à l’isle Saint-Pierre pour 30 bateaux (chaloupes) ; il en a loué la plus grande partie. Claparède en a eu une autre et le capitaine du navire le ClaudeAlexandre de Granville lui a payé 60 quintaux de morue, 472 livres 10 sols en argent, pour l’emplacement de huit chaloupes. Le sieur Bertrand occupe La Pointe Lucas, ancienne habitation de La Hoguerie et Lucas; il n’a employé l’année dernière qu’un bateau (chaloupe); il n’est pas, dit-on, en état d’en occuper davantage; il loue le reste.
Ces particuliers n’étoient point, dit-on, anciennement habitants de l’Isle-Royale. Lucas et Lercan demandent les deux tiers de cette concession. Le sieur Le Marié des Landelles et compagnie de Granville demandent le quart de celle de Beaubassin, y comprenant l’échafaud qu’ils ont fait en 1764, et dont ils ont payé le loyer 1 500 livres. Le sieur Bretel, aussi de Granville, sollicite la concession de l’Isle aux Bours et il représente que le sieur Ravenel, qui l’a obtenue, en a déjà une à Saint-Pierre » (57).
Les plaintes continuèrent car l’année suivante, le 1er août 1766, le ministre écrivit à Dangeac des instructions plus précises : « Il n’est pas juste que les habitants abusassent (de leurs concessions) pour louer l’excédent à un prix exorbitant. L’intention de Sa Majesté est que vous fassiez cesser cet abus dont il y a eu beaucoup de plaintes ; il paroit, en effet, qu’il suffirait de payer pour le loyer de ces graves 5 de la pêche que les locataires y feront. Je vous prie d’examiner ce projet et si vous le trouvez juste, comme il me le paroît, vous pourrez faire un règlement pour l’ordonner. Je vous observerai qu’il est très important de favoriser la pêche et par conséquent de ne pas permettre qu’elle soit vexée par un loyer trop cher du terrain qui lui est nécessaire » (58).
La mesure fut adoptée et les graves devinrent une sorte de bien de famille dont on héritait, que l’on louait et que l’on pouvait vendre (59). Ainsi, en 1784, la société d’Estebecho avait acheté pour 1 800 livres la grave de Noël Rosse mais louait en outre celle de la veuve Milly pour 1 000 livres par an, celle de Loyer-Deslandes, à raison de 5 du produit de la pêche et celle de la veuve Beaubassin, également à raison de 5 La société Ernouf louait, aux mêmes conditions, celles de Charles Jouet et de la veuve Ravenel (60).
En 1784, après la reprise de possession, il y eut une vigoureuse réaction contre cet état de fait. Le nouvel ordonnateur, Malherbe, fut le premier à recenser les inconvénients du mode de possession des graves : « Les terrains des îles Saint-Pierre-et-Miquelon n’ont été concédés aux anciens habitants de l’île Royale et de l’Acadie que pour les dédommager des pertes essuyées dans ces endroits, mais sous la condition expresse de mettre en valeur les graves établies et à établir, en faisant la pêche soit pour leur compte personnel, soit en société avec quelque armateur. L’habitant doit être assujetti à l’exploiter par lui-même ou en société et que la location, qui en est ordinairement payée très cher, en soit prohibée, parce qu’il ne peut résulter de cette location qu’un découragement de la part de celui qui la paye, en ce qu’elle lui enlève une partie de son poisson et, par conséquent, le bénéfice le plus clair. Parmi les habitants de Saint-Pierre, il y a un grand nombre de propriétaires de petites embarcations à qui la location de portions de graves enlève presque tout le bénéfice de la pêche, parce qu’il paye en poisson, au prorata de celle qu’il fait. Le reste lui suffit à peine à rembourser les dépenses qu’il a faites le temps de la pêche et lui ôte le moyen de se procurer la subsistance et les hardes indispensables pour sa famille durant l’hiver. Il est étonnant que les graves de Saint-Pierre n’aient été distribuées qu’à 25 et que, dans ce nombre, il y en ait qui s’en tiennent à la location; les graves de Miquelon ont été distribuées avec plus d’équité; les habitants, bien loin de se servir d’étrangers pour entretenir leurs graves et prendre soin de leur poisson, y employent leurs femmes et leurs enfants (61) ».
L’année suivante, un mémoire anonyme, mais dont l’auteur était probablement le nouveau contrôleur Pièche de Loubières, reprenait les mêmes observations, avec plus de sévérité : « L’étendue et la position des possessions actuelles prouvent assez que les concessions faites lors de l’établissement de 1763, n’avoient roulé que sur un très petit nombre d’individus et principalement sur les parents ou alliés de la famille du gouverneur et les personnes attachées au service, les seules sans doute qui n’auroient jamais dû y prétendre; ces mêmes personnes, remplacées aujourd’hui par des officiers nonpêcheurs, croient avoir le droit de prélever, sur le travail pénible et très hasardeux de la pêche, un tribu assuré par les loyers de leurs prétendues possessions. Il est bon d’observer que ce sont, pour la plupart, les plus belles graves qui sont louées à rente fixe par les propriétaires résidant en France » (62) ». Ce mémoire eut une grande audience dans les bureaux de la Marine, où de nouvelles dispositions furent prises : « Les graves ont été concédées presque en entier aux habitants sédentaires, qui les regardent comme un patrimoine et comme un dédommagement aux pertes qu’eux ou leurs ancêtres ont souffertes lors de la prise de l’Isle Royale, en sorte que plusieurs qui sont restés en France s’en sont fait un objet de revenu par des locations et que d’autres qui sont passés dans la colonie donnent également à loyer ce qu’ils ne peuvent ou ne veulent occuper euxmêmes. Sa Majesté veut qu’on examine d’abord avec attention les motifs et l’étendue des concessions; elle ne balancera pas à révoquer celles qui, n’ayant été accordées que par faveur, ne seroient pour les concessionnaires absents que des objets d’un revenu équivalent à un impôt sur la pêche et elle réduira toutes celles qui, fondées même sur de justes titres, auroient été accordées sans mesure. Dans tous les cas, le prix du loyer devra être tellement modéré qu’il ne puisse influer contre l’accroissement de la pêche » (63).
Les instructions données au commandant de la station, M. de Barbazan, le 3 avril 1786, lui recommandaient de « ne pas laisser les graves en la possession de particuliers incapables de les mettre en valeur et qui ne les possèdent que par des ventes simulées et seulement pour en conserver la propriété aux vendeurs qui ont négligé jusqu’ici de les faire valoir » (64). Le commandant, pour assurer l’exécution de cet ordre, prit une ordonnance le 8 avril 1786 qui dut rétablir équitablement les choses car on ne découvre plus aucune plainte à partir de l’année 1786 (65).
- La main-d’œuvre métropolitaine.
Si les propriétaires de graves obligeaient les armateurs métropolitains à engager quelques frais supplémentaires, les négociants des ports de France ne faisaient rien pour être agréables aux colons.
En effet, les habitants des îles Saint-Pierre-et-Miquelon manquaient de main-d’œuvre pour équiper leurs chaloupes ou leurs goélettes ou tirer parti de leurs graves ; ils étaient donc obligés d’en faire venir de France, en ayant recours aux armateurs et capitaines métropolitains. Chaque année arrivait ainsi dans la colonie une main-d’œuvre indispensable qui se partageait d’ailleurs en deux catégories : les pêcheurs passagers et les pêcheurs hivernants.
Parmi les pêcheurs passagers, il convient de distinguer ceux qui venaient dans la colonie pêcher pour leur propre compte; ils possédaient ou louaient des chaloupes et avec le produit de leur pêche s’acquittaient du prix de leur passage, des avances qu’ils avaient reçues des armateurs et, à l’occasion, du loyer des embarcations dont ils s’étaient servi. Ils vendaient ou chargeaient à fret le reste de leur pêche et, avant de revenir en France, échouaient les chaloupes qui leur appartenaient. Cette catégorie particulière eut des représentants assez nombreux les premières années de la colonie mais elle disparut totalement, à partir de 1783 (66); nous ne nous en occuperons pas plus longtemps.
La plupart des pêcheurs passagers étaient engagés par les habitants pour la durée d’une campagne de pêche. Les colons les faisaient venir des ports de France, surtout de Bayonne et de Saint-Jean de Luz, mais aussi de Saint-Malo et de Granville. La campagne terminée, les colons donnaient à chacun de leurs engagés une part de pêche convenue et contractaient avec eux de nouveaux engagements pour l’année suivante. Le pêcheur passager pouvait alors vendre son poisson sur place ou bien le charger à fret pour la France (67).
Parfois, les habitants demandaient à certains de ces pêcheurs de rester à leur service jusqu’au printemps suivant; ils les employaient à faire la pêche d’automne et étaient ainsi assurés de disposer de leur aide pour la campagne prochaine. On les appelait alors pêcheurs hivernants. Nous ne pensons pas qu’il soit possible ni même très utile de distinguer plus longtemps pêcheurs passagers et pêcheurs hivernants. Cette terminologie n’est d’ailleurs pas toujours très précise dans les documents que nous avons étudiés. Contentons-nous donc de parler de la main-d’œuvre métropolitaine et du conflit qui opposa, à son sujet, les armateurs de France et les habitants des îles Saint- Pierre-et- Miquelon.
Dès le 24 mai 1765, Dangeac signalait que « la mauvaise volonté des armateurs de France ou des capitaines qui en viennent rend tous les travaux inutiles puisqu’ils n’ont pas amené un seul équipage pour faire la pêche. Une partie de nos habitants avoient su prévoir cette mauvaise volonté et, en conséquence, avoient hiverné à leur pain des équipages de chaloupes et, si le pain avoit été plus commun, ils en auroient hiverné davantage » (68). Le 30 avril 1766, il écrivait à nouveau : « Ce qui fera le plus de tort à la pêche, c’est le défaut d’équipages pêcheurs. La moitié de nos chaloupes resteront dans l’inaction sur les graves, faute d’hommes pour les conduire. Les bâtiments venus cette année tant de Bayonne, Saint-Jean-de-Luz que de Saint-Malo n’ont pas amené un équipage pour nos habitants sédentaires » (69). Les années suivantes, la situation changea du tout au tout; de la pénurie, on passa à la pléthore de main-d’œuvre et le même Dangeac écrivait le 13 mai 1772 : « Les capitaines et armateurs amènent beaucoup de garçons; la population se monte à trois ou quatre mille bouches » (70). L’inconvénient résidait alors dans le manque de vivres et Dangeac se vit obligé de renvoyer en France une partie de ces pêcheurs pour leur éviter de mourir de faim. On en arriva enfin à une sorte d’équilibre; le recensement de 1776 dénombrait 604 matelots à Saint-Pierre et 127 seulement à Miquelon, où l’on sait que les habitants préféraient employer une main-d’œuvre familiale (71). Ces chiffres n’avaient rien de fixe d’ailleurs et pouvaient varier considérablement d’une année à l’autre. Ainsi, en 1785, il n’y avait plus que 323 matelots au service des habitants de Saint-Pierre (72), mais en 1790, le 10 octobre, on en comptait 1134 dans la colonie (73).
Chaque habitant en engageait suivant ses besoins et l’importance de son exploitation; ainsi, Rodrigue qui employait 61 pêcheurs en 1777 n’en avait plus que 4 en 1785; aux mêmes dates, les engagés de Dupleix-Sylvain étaient 44 puis 16; ceux de Pradère-Niquet, 32 et 34 (74).
Les armateurs métropolitains, ayant accepté, bon gré mal gré, de faire passer des pêcheurs dans la colonie, essayèrent de tirer le plus de profit possible de la situation. Dès 1773, Dangeac dénonça le « monopole exercé par le commerce au pays de la Basquerie sur les pêcheurs qui viennent de cette partie à Saint-Pierre; les armateurs font d’abord payer à chaque homme 80 livres pour leur passage; ils les forcent ensuite de prendre certaine somme à la grosse, à un intérêt exorbitant et, rendus à la fin de la pêche, ils se saisissent du fruit de leurs travaux et après s’être payés de 80 livres pour le passage, ils se payent encore sur la même morue de l’intérêt de la grosse, de sorte que les pêcheurs ont rarement de quoi payer leur passage (de retour) » (75). Malgré les protestations du gouverneur, la situation des pêcheurs passagers demeura aussi précaire jusqu’au moment où la nouvelle administration fut mise en place en 1785.
A cette époque, le contrôleur Pièche de Loubières, agissant en tant que commissaire de la marine, résolut de s’opposer aux exigences des armateurs métropolitains (76).
Le conflit portait alors très précisément sur le voyage de retour des pêcheurs passagers. La coutume voulait jusque-là que ceux-ci n’eussent à fournir que leurs vivres pour la traversée. Or les capitaines refusaient désormais de les ramener en France s’ils ne leur payaient pas, en plus de leurs vivres, une somme de 60 livres. Pièche de Loubières mena une petite enquête et découvrit qu’en 1784, les armateurs de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz avaient passé un « concordat » d’après lequel ils défendaient expressément à leurs capitaines, sous peine de 500 livres d’amende, de recevoir à leur bord les passagers qu’ils auraient amenés aux habitants s’ils ne payaient pas ces 60 livres pour leur retour. Pièche de Loubières avait même réussi à se faire communiquer les instructions de Saubat Claret, armateur de Saint Jean de Luz, à Pierre Berade, capitaine de son navire L’Angélique, qui avait amené 52 passagers et se proposait de les abandonner dans la colonie. Car les pêcheurs passagers refusaient de se soumettre aux exigences des armateurs. Ils représentaient « qu’embarquant leurs vivres pour la traversée au retour, ils croyaient devoir être d’autant moins soumis à payer leur passage que les armateurs les avoient forcés de recevoir à leur départ de France une somme de 100, 150 à 200 livres à la grosse, portant un intérêt de treize et demi pour cent payable dans la colonie en morue de choix sur le pied de 13 livres 10 sols le quintal, et que le remboursement du capital, l’intérêt et la différence du prix de la morue au taux ordinaire de 20 livres le quintal absorbaient tellement le bénéfice de leur pêche qu’ils étoient dans l’impossibilité de payer les 60 livres qu’on vouloit exiger d’eux ».
Pièche de Loubières prit naturellement leur parti et rendit compte de l’affaire au chevalier de Girardin, commandant la station. Celui-ci, par ordonnance, obligea les capitaines à conduire en France tous les pêcheurs passagers qui auraient été à la charge des habitants durant l’hiver; les pêcheurs, quant à eux, devraient embarquer leurs vivres, selon l’usage, faire le quart à bord et fournir les mêmes services que l’équipage.
Pièche de Loubières tira de cette affaire des conclusions intéressantes. H écrivait, en effet : « Le but de ce concordat est une jalousie d’intérêts. Le but des armateurs a été sans doute, en s’appropriant le bénéfice des pêcheurs attachés à la pêche sédentaire, de les décourager et priver par-là les habitants des moyens de la faire ». En effet, les pêcheurs préféraient se mettre au service des habitants qui les engageaient tout simplement à la part, suivant les prescriptions de l’ordonnance du 20 juin 1743 qui avait été édictée pour l’île Royale.
Les armateurs, au contraire, obligeaient leurs équipages à recevoir le fameux prêt à la grosse dont le remboursement absorbait une grande part de leur salaire. L’ordonnance de 1743 avait d’ailleurs prévu cette préférence des pêcheurs à l’égard des habitants et, pour éviter que les armateurs ne fussent pas absolument privés d’équipages, elle défendait aux habitants, par son article 13, de payer le passage de leurs engagés et de leur faire aucun avantage indirect. Mais, comme le disait Pièche de Loubières, « l’armateur d’Europe doit-il se prévaloir de l’avantage qui résulte de la sagesse de cette loi pour pressurer le malheureux pêcheur, instrument de sa fortune? »
Il concluait en donnant un aperçu de l’état d’esprit, si l’on peut dire, et de la situation lamentable des équipages métropolitains : « Les équipages des bâtiments armés à Saint-Malo et à Granville, assujettis, comme ceux de Bayonne, à prendre de l’argent à la grosse (la grosse de l’argent dans ces deux ports est à 17 %, mais le remboursement s’en fait en morue de choix au prix du cours de la colonie), mais moins laborieux et plus débauchés que les Basques, découragés d’ailleurs par les remboursements qu’ils ont à faire à la fin de la pêche et qui vont leur enlever tout, ne tardent pas à s’enfoncer dans les cabarets d’où leurs capitaines ne les retirent qu’avec des fusiliers et à grands frais (un matelot n’entre point en prison qu’il ne lui en coûte 3 livres et autant pour la sortie ; si c’est la nuit qu’on l’arrête, la taxe double; des capitaines ont payé jusqu’à 30 livres dans un seul jour), mais qu’importe à l’armateur tranquille : que son armement fasse seulement demi-pêche, le remboursement de son argent à la grosse lui en alloue le produit en entier et, si l’équipage lui redoit, c’est presque toujours les frais de prison qui deviennent coûteux à Saint-Pierre ». Pièche de Loubières conseillait en conséquence de limiter le nombre des cabarets, de les désigner par une enseigne bien apparente et d’assujettir à de fortes amendes les cabaretiers qui recevraient des matelots pendant les heures de travail. « Un règlement pareil préviendroit bien des vols sur les graves, rendroit les équipages plus assidus à leurs travaux et éviteroit les plaintes continuelles des capitaines. »
- Le « troc ».
Plus grave encore que les deux conflits précédents, fut celui qui opposa les armateurs métropolitains aux habitants, à propos du : « troc », car le « troc » était à la base de l’économie de la colonie, de la vie matérielle des colons et notamment de leur ravitaillement.
On a vu qu’à la fin de la campagne de pêche, au mois de septembre, le jour de la Saint-Michel, les habitants vendaient leur poisson aux armateurs métropolitains, qui avaient armé leurs navires en traite.
Les colons se faisaient parfois payer leur denrée en argent, mais le , plus souvent l’échangeaient contre des vivres (biscuits, beurre, pois, 5 farine, lard, etc.) ou des ustensiles de pêche (lignes, toiles à voile, hameçons, plombs, etc.) et particulièrement contre du sel dont ils utilisaient de grandes quantités pour préparer leurs morues. En général, ils ne pouvaient se procurer suffisamment de vivres pour assurer la subsistance de leurs familles durant l’hiver ; alors les armateurs leur consentaient des avances, à des taux élevés. Avec les années, les dettes des colons s’accroissaient et les négociants métropolitains disposaient ainsi de moyens de pression pour diriger à leur guise le commerce de la colonie. On n’en était pas arrivé là d’un coup.
En effet, tant que le roi se chargea d’approvisionner les îles Saint-Pierre-et-Miquelon à ses frais, les habitants n’eurent pas trop à souffrir de leur sujétion commerciale. Mais, à partir de 1766, la Cour réduisit ses envois pour bientôt les cesser vers 1770. Dès le 30 avril 1766, Dangeac s’inquiéta de ce que les navires venus de France n’apportaient pas de vivres; au contraire, écrivait-il, « ils nous ont amené beaucoup de pacotilleurs que nous regardons comme très nuisibles à cette colonie en ce qu’ils n’ont que des choses inutiles que les habitants veulent cependant se procurer » (77). Les années suivantes, les négociants réalisèrent de gros bénéfices, en mettant en vente les marchandises de première nécessité qu’ils avaient fait passer à Saint-Pierre; Dangeac révèle qu’en 1768, les armateurs qui avaient apporté pour 300 000 livres de marchandises, prix de France, en avaient retiré plus de 900 000 livres, prix de la colonie ^78^. Malgré cet énorme profit, les négociants n’assuraient pas avec régularité le ravitaillement des îles. Le 22 octobre 1771, Dangeac se plaignit à la Cour du peu de vivres que les négociants de France apportaient dans son gouvernement; il avait même été obligé de renvoyer une grosse partie des pêcheurs passagers (79). Le ministre avertit alors les Chambres de commerce que le roi était décidé à leur laisser le soin de pourvoir à la subsistance des habitants de la colonie et leur fit connaître les plaintes du gouverneur. Les armateurs répondirent alors que leur conduite avait été déterminée par « l’infidélité des habitants et maîtres de graves qui forcent les capitaines à prendre, en échange des vivres et ustensiles, de la morue non-faite pour qu’elle pèse davantage et de ce qu’ils ne la livrent qu’à la Saint-Michel, temps où la saison n’est plus propre à la sécher ». Ils demandaient en conséquence que la date du « troc » fût fixée au 15 septembre, comme c’était l’usage à Louisbourg, disaient-ils (SO). A cela, Dangeac représenta qu’il était impossible aux habitants de livrer leur morues avant la Saint-Michel et même avant la fin d’octobre, car ils seraient alors forcés d’interrompre leur pêche à la fin du mois d’août, pour avoir le temps de sécher leurs morues, perte de temps qui leur causerait un grand préjudice; d’ailleurs c’était à tort que les négociants avançaient la date du 15 septembre car, à Louisbourg, le « troc » se faisait aussi à la Saint-Michel. Bien plus, le gouverneur contre attaquait : « Les négociants vendent souvent le sel à fausse mesure et d’autres denrées à faux poids, telles que le biscuit qu’ils pèsent avec des romaines, le beurre par barril d’un demi-quintal, d’un quintal ou plus, dans lequel ils comprennent plus de dix livres de sel ; dans des barrils de beurre, on a trouvé des pierres pesant 25 livres. fi se fait aux isles Saint-Pierre et Miquelon avec la métropole, depuis l’établissement, un commerce de 400 000 livres et les colons ne doivent pas 15 000 livres aux négociants, objet bien modique » (81). Dans les bureaux de la Marine, on tira de ces reproches les conclusions qui s’imposaient : « On ne peut dissimuler que l’avidité des négociants français leur fait tout sacrifier à leurs intérêts et qu’ils regardent les colons comme des tributaires trop heureux d’acheter, au prix qu’ils fixent, les denrées qu’ils veulent bien porter à ces malheureux; on pense qu’il convient d’écrire aux Chambres de Commerce pour les prévenir que les habitants ne peuvent payer qu’à la Saint-Michel, et de veiller aux abus » (82).
N’ayant pu obtenir satisfaction sur ce point, les armateurs voulurent se rattraper sur un autre. Le 15 septembre 1774, ils firent des représentations au baron de l’Espérance, nouveau gouverneur, pour lui demander de fixer le prix de la morue à 18 livres le quintal au lieu de 20 (83). Les habitants répliquèrent que, depuis 1763, le prix courant avait été de 20 à 21 livres 10 sols et que, si, en 1773, ce prix n’avait été que de 18 sols, la cause de cette diminution avait résidé dans l’abondance et la mauvaise qualité du poisson (84). D’ailleurs, déclaraient-ils, la morue achetée dans la colonie 20 livres le quintal, était revendue à Bordeaux 42 livres, à Saint-Malo, La Rochelle et Bayonne, de 28 à 36 livres, ce qui assurait aux armateurs un bénéfice confortable. En outre, les négociants s’assuraient un profit de 50 au moins sur les marchandises qu’ils vendaient aux habitants. Ils pratiquaient même, dans ce but, des opérations parfaitement irrégulières; les capitaines bordelais, par exemple, arrivaient à Saint-Pierre avec des cargaisons de vins, d’eau-de-vie et autres alcools qu’ils échangeaient en fraude avec les Anglais pour des cargaisons de vivres, revendus ensuite aux habitants avec d’énormes bénéfices. Ils empêchaient les navires anglais de commercer directement avec les habitants; ainsi, en juin 1774, deux « capitaines-géreurs » de Bayonne et de Bordeaux achetèrent les cargaisons d’une goélette de Boston et d’une autre de Québec; quand ils ne pouvaient faire autrement, ils tentaient de les empêcher d’entrer dans la rade, ce qui se produisit, au mois d’août 1774, pour une goélette de New-York. Les habitants eurent gain de cause et leur morue demeura au taux de 20 livres le quintal (85).
Le conflit évolua à nouveau après 1784. En effet, le ravitaillement des îles fut désormais assuré par les navires des Etats-Unis et les habitants devinrent ainsi moins tributaires du commerce français. Les armateurs relevèrent alors leurs prix. Sur ce point aussi, la nouvelle administration de la colonie tenta de remettre un peu d’ordre. Le commandant de la station, Barbazan, examina, au mois de juin 1786, la situation particulière des habitants de Miquelon, qui ne pouvaient faire aucun bénéfice à cause des avances que les armateurs leur consentaient à des prix trop élevés : « Les fournitures du commerce ont augmenté d’un quart tandis que la morue est restée fixée à 20 livres le quintal; (les négociants) ont exigé cette année que les pêcheurs de Miquelon leur apportassent la morue à Saint-Pierre, moyennant 5 sols le quintal au lieu de 10 l’an dernier. D’autres ont exigé cela aux risques des pêcheurs qui, faute de moyens pour ponter leurs chaloupes, peuvent voir dans le traj 3t leur morue mouillée et avariée par la pluie et les vagues et perdre ainsi dans un instant le fruit de cinq mois de travail et leur unique ressource. L’habitant ne peut commencer sa pêche sans des avances qui pour une chaloupe sont évaluées à environ 1 800 livres. Le moindre accident qui arrête la pêche plonge une famille et souvent plusieurs dans la misère. Voilà quel est l’état des malheureux habitants de Miquelon qui, chassés de l’Acadie, de Louisbourg, de Miquelon, ont tout bravé pour se conserver à la France » (86). Pièche de Loubières, quant à lui, dénonçait la contrebande des armateurs français à Saint-Pierre : « L’habitant sédentaire, forcé de recevoir du commerce d’Europe, à titre d’avances, tout ce qui peut lui être nécessaire pour faire la pêche, doit s’attendre, après avoir acquitté ces mêmes avances, à un débouché pour ce qui lui reste du produit de sa pêche; c’est avec ce restant qu’il doit pourvoir à son entretien et à sa subsistance pendant l’hiver; pour qu’il puisse en retirer le parti le plus avantageux, il ne doit se trouver en concurrence qu’avec le commerce de la colonie. Mais l’avidité de quelques particuliers, n’écoutant que leurs intérêts personnels et cédant à la facilité d’acheter des Anglais la morue à un très bas prix ou par un troc avantageux, fait qu’ils privent en même temps la colonie d’une partie des objets de premiers besoins qu’ils ne devroient échanger qu’avec les colons et les mettent par là dans la dure nécessité de leur vendre leur morue au-dessous du taux ordinaire et même dans la perplexité de ne pas la vendre. La grande quantité de morue anglaise entrée dans la colonie en a fait sortir une partie de l’argent et baisser le prix de la morue française à 17 et 18 livres le quintal, payable en France pour les équipages ». Notre informateur révélait les pratiques de ce commerce interlope : « Les moyens d’empêcher ce commerce interlope sont très bornés par la facilité qu’ont les chaloupes anglaises d’entrer à toute heure dans la rade et dans le barachois où elles débarquent leur morue pendant la nuit. D’autres mouillent au large auprès de l’isle aux Chiens et, au signal convenu, l’armateur envoie ses chaloupes dans lesquelles se verse le chargement et l’Anglois entre ou retourne sans être vu; l’isle aux Pigeons, l’isle au Vainqueur et l’isle Verte, peu éloignées de Saint-Pierre servent encore d’entrepôt ou de rendez-vous. Quelques habitants, ayant des armements de France, sont dans l’usage de joindre au nombre de leurs chaloupes, des chaloupes anglaises avec équipages anglais pour faire, disent-ils, la pêche pour leur compte. Il est très sensible que le loyer de ces mêmes chaloupes appartenant à des Anglais établis à la Grand-Terre n’est qu’un prétexte spécieux pour couvrir la fraude de ceux qui la louent. Vers la fin de la pêche, ils expédient encore leurs chaloupes à la Grand-Terre, sous prétexte d’aller chercher du bois; elles y chargent la morue, couvrant leur chargement avec du bois et reviennent à Saint-Pierre décharger leur morue pendant la nuit » (87).
Pièche de Loubières insistait sur la nécessité de tenir la balance égale entre les négociants métropolitains et les habitants, car les armateurs augmentaient leurs prix sans que les colons en fissent autant pour leur morue. Aussi, pour leur éviter un désavantage trop marqué le commandant de la station, Barbazan, publia-t-il une ordonnance, le 15 juin 1788, qui laissait les habitants libres de fixer le prix de leur poisson (88). Cette mesure devait permettre enfin aux colons de s’opposer aux exigences excessives des armateurs.
Telles furent les méthodes commerciales en usage aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles n’avaient qu’un seul objet : la pêche de la morue, la préparation qu’on lui faisait subir pour la sécher et enfin la vente de cette denrée aux capitaines de navires pontés qui l’emportaient vers les lieux de consommation.
II LE COMMERCE DES ÎLES SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Nous ne pouvons, sans donner à cette étude des dimensions excessives, entrer dans le détail du mouvement commercial de la colonie.
Les matériaux ne manquent pas cependant; les états de pêche et les archives du siège d’amirauté de Saint-Pierre (89), que nous avons dépouillés, fournissent une documentation abondante, mais qui exige un gros travail de recoupements, de calculs, de mise en ordre et d’exposition. Nous nous excusons donc de ne pas pouvoir présenter ici un tableau détaillé de ce commerce, mais d’en dégager seulement les grandes lignes.
- LE COMMERCE AVEC LA FRANCE.
Le nombre des congés distribués par le greffier de l’amirauté aux navires qui portaient en France la morue des îles Saint-Pierre et Miquelon donne une idée assez juste, sinon exempte d’erreurs, du mouvement du port de Saint-Pierre. En voici le dénombrement par année :
| 1765 | 43 | 1773 | 80 | 1785 | 70 |
| 1766 | 36 | 1774 | 78 | 1786 | 87 |
| 1767 | 34 | 1775 | 78 | 1787 | 91 |
| 1768 | 35 | 1776 | 81 | 1788 | 92 |
| 1769 | 41 | 1777 | 78 | 1789 | 105 |
| 1770 | 53 | 1778 | 24 | 1790 | 106 |
| 1771 | 51 | 1783 | 19 | 1791 | 94 |
| 1772 | 57 | 1784 | 64 | – | – |
Ces chiffres ne correspondent pas à la totalité d’js bâtiments qui fréquentaient la colonie; il conviendrait d’y ajouter les petites goélettes des habitants, dont le faible tonnage ne pouvait permettre un voyage au long cours. En outre, de nombreux bâtiments anglais et américains venaient aussi débarquer leurs marchandises à Saint-Pierre ; nous leur consacrons un paragraphe spécial un peu plus loin.
Toutefois, ce tableau permet de constater la progression régulière du nombre des vaisseaux sortis de la colonie; la baisse constatée en 1778 est due aux hostilités engagées avec l’Angleterre qui arrêtèrent naturellement tout commerce jusqu’en 1783; cette année-là peu de navires eurent le temps d’armer pour Saint-Pierre, mais de 1783 à 1790, la progression est remarquable. Avec plus de 100 bâtiments, Saint-Pierre dépassait bien des ports métropolitains.
D’où venaient ces navires? Deux régions se partageaient l’essentiel du commerce des îles Saint-Pierre-et-Miquelon : les ports voisillf) de Saint-Malo et Granville, et ceux de Bayonne et Saint-Jean-de-Luz.
Ainsi, en 1790, 24 navires de Saint-Malo, 5 de Granville, 26 de Bayonne et 12 de Saint-Jean-de-Luz vinrent à Saint-Pierre (90). Mais la plupart des ports de la côte atlantique envoyaient chaque année quelques bâtiments dans la colonie : Brest, Le Conquet, Lorient, Vannes, Nantes, Paimbœuf, l’île de Ré, les Sables d’Olonne, La Rochelle, Rochefort, Blaye, Bordeaux, Siboure; parfois même certains ports de la Manche : Saint-Brieuc, Argentan, Cherbourg, Rouen et même Dieppe étaient représentés. Il n’est pas jusqu’à Marseille qui ne fît quelques expéditions. Les Antilles envoyaient aussi chaque année un certain nombre de navires, jusqu’à une douzaine en 1790, mais ceux-ci feront l’objet d’un paragraphe spécial.
Tous ces bâtiments prenaient dans la colonie leur cargaison de morues sèches et l’emmenaient en Europe. Voici, par année et en quintaux, les quantités exportées (91).
| 1766 | 15153 | 1772 | 52 743 | 1784 | 47123 |
| 1767 | 20 034 | 1773 | 63 160 | 1785 | 57 279 |
| 1768 | 21242 | 1774 | 55180 | 1786 | 62 134 |
| 1769 | 31 682 | 1775 | 49194 | 1787 | 72 018 |
| 1770 | 37 995 | 1776 | 47 841 | 1788 | 76 509 |
| 1771 | 46137 | 1777 | 57694 | 1789 | 68351 |
| 1790 | 91 582 |
On constate donc là aussi une progression assez régulière des quantités exportées, si l’on tient compte de l’interruption due aux hostilités, entre 1778 et 1783. Quels étaient les ports de débarquement ? Sensiblement les mêmes que ceux d’armement. Les quelques dizaines de milliers de morues vertes étaient portées aux ports spécialisés dans la vente de cette denrée : Dieppe et Nantes. La morue sèche s’exportait dans les mêmes villes qui armaient pour la pêche, avec une légère tendance à en concentrer la vente dans les ports les plus importants. Ainsi, en 1790, Saint-Malo reçut 26 cargaisons, Bayonne 23, Saint-Jean-de-Luz 14, Bordeaux 12, La Rochelle 6, Granville 2; chose étonnante, très peu de vaisseaux se rendaient à Marseille, alors que plus de la moitié de ceux qui péchaient au PetitNord allaient y vendre leurs morues sèches, qui étaient ensuite réexportées en Italie.
En 1791, pour la première fois, 668 514 morues sèches furent envoyées en Espagne; 5 navires s’en furent à Bilbao, 1 à Saint-Sébastien, 1 à Santander et 1 à Alicante. On ne sait pas quelles raisons poussa les armateurs à reprendre un commerce qu’ils avaient depuis longtemps abandonné aux Anglais; peut-être, dans cette période trouble, la situation du marché intérieur français leur sembla-t-elle peu propice pour une vente avantageuse de leur denrée et voulurontils rechercher d’autres débouchés.
Si le commerce des îles Saint-Pierre-et-Miquelon se fit surtout avec la France, deux autres courants existèrent, l’un avec les Antilles françaises, l’autre avec la Nouvelle-Angleterre, puis les Etats-Unis.
- LE COMMERCE AVEC LES ANTILLES FRANÇAISES.
Dans les instructions remises à Dangeac, le 23 février 1763, un paragraphe prévoyait que « si le sieur Dangeac prévoit qu’on puisse l’année prochaine ouvrir quelque branche de commerce avec les autres colonies françaises, il aura soin de ne pas négliger cet objet » (92).
Il s’agissait des Antilles françaises qui avaient besoin de grandes quantités de morues sèches pour nourrir leurs esclaves noirs. La morue sèche constituait en effet pour ces collectivités la denrée idéale, qui se conservait longtemps et ne coûtait pas cher. A vrai dire, les îles du Vent surtout l’utilisaient, en concurrence avec les salaisons de bœufs; aux îles sous le Vent, les habitants confiaient aux noirs des portions de terrain que ceux-ci cultivaient pour en retirer leur subsistance (93).
D’un autre côté, les Antilles pouvaient amener aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon des cargaisons de rhum, de tafia, de mélasse, de café et de sucre, qui se consommaient sur place; la mélasse servait par exemple à fabriquer une sorte de bière, avec l’écorce d’un arbre appelé le prusse, qui constituait la boisson des pêcheurs (94). Mais on espérait que Saint-Pierre formerait un entrepôt d’alcools qui alimenterait la contrebande avec les vaisseaux anglais de Terre- Neuve et surtout de la Nouvelle-Angleterre, comme cela se faisait à l’île Royale. Il est très difficile d’étudier un tel commerce clandestin, les archives n’en ayant pas gardé trace. Cependant, les auteurs anglais affirment qu’il existait; c’est en effet très possible mais indémontrable, du moins d’après les sources manuscrites françaises (95).
Le commerce de la morue sèche entre Saint-Pierre et les Antilles, lui, est abondamment attesté et c’est là un des traits originaux de l’économie de la colonie. Il faut bien distinguer un double courant : celui qui amenait des Antilles à Saint-Pierre des navires porteurs de cargaisons de rhum, de mélasse, de tafia, de café et de sucre, et celui qui, de Saint-Pierre aux Antilles, transportait, sur des navires, dont la plupart étaient armés en France et à Saint-Pierre même, des chargements de morues sèches.
Le premier courant fut assez faible. Voilà les chiffres que nous avons relevés. De 1765 à 1790, en tenant compte de l’interruption des années 1778-1784, il y eut 57 navires venus des Antilles à Saint-Pierre. Certaines années, il n’y en eut pas (1771, 1772, 1777); il n’y en eut qu’un en 1766, 1767, 1768, 1773 et 1784; deux en 1765, 1769, 1770, 1774 et 1787; trois en 1775, 1785 et 1788; six en 1776; 7 en 1786; 8 en 1789 et 12 en 1790. La Martinique par Saint-Pierre en envoya 27; la Guadeloupe, 15 par Pointe-à-Pitre (10) et BasseTerre (5); Saint-Domingue, 13 par le Cap-Français (5) et Port-auPrince (8); Tobago même en envoya 2 (en 1786 et en 1789).
L’autre courant, c’est-à-dire, l’exportation des morues sèches de Saint-Pierre aux Antilles, fut plus important. Il était assuré par les vaisseaux des Antilles qui faisaient leur retour, par ceux de Saint-Pierre-et-Miquelon et quelques navires armés en France. Voici, par année, le nombre de ces navires et le nombre de quintaux de morue sèche qu’ils transportaient vers les ports que nous avons cités au paragraphe précédent.
| 1765 | 4 | – | 1775 | 15 | 15 812 |
| 1766 | 5 | 2 230 | 1776 | 23 | 22 263 |
| 1767 | 4 | 2 363 | 1777 | 4 | 2 792 |
| 1768 | 7 | 5 180 | 1784 | 7 | 2 893 |
| 1769 | 8 | 6 669 | 1785 | 8 | 3 106 |
| 1770 | 4 | 2 271 | 1786 | 17 | 16 891 |
| 1771 | 4 | 2 833 | 1787 | 9 | 15 107 |
| 1772 | 8 | 6 457 | 1788 | 15 | 25 351 |
| 1773 | 20 | 10 616 | 1789 | 20 | 38287 |
| 1774 | 20 | 11 880 | 1790 | 14 | 18130 |
On constate dans ce tableau deux périodes particulières : de 1773 à 1776 et de 1786 à 1790, pendant lesquelles le nombre des navires est plus élevé; cette augmentation est due aux encouragements que la Cour accorda à ce commerce qui l’avait toujours préoccupée.
En effet, avant la guerre de Sept Ans, l’approvisionnement en morue sèche des Antilles françaises se faisait par l’intermédiaire de Louisbourg. Le traité de Paris enleva l’île Royale à la France et les armateurs métropolitains ne surent pas se réadapter aux nouvelles conditions qui leur étaient faites. Les pêcheurs anglais et particulièrement ceux de la Nouvelle-Angleterre profitèrent de cette carence pour envahir le marché des Antilles, au point que le gouvernement français, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, accorda le 25 janvier 1765 la permission aux vaisseaux étrangers d’importer de la morue aux Antilles, moyennant un droit de 8 livres par quintal (96). Malgré ce droit élevé, les quelques armateurs français qui, de Bordeaux et surtout de Saint-Pierre-et-Miquelon, s’obstinèrent à soutenir la concurrence britannique, subirent de grosses pertes. En effet, les pêcheurs anglais vendant leur poisson 8 livres le quintal, gagnaient autant que leurs collègues français qui en demandaient 24 livres. On comprend que la morue anglaise avait dans ces conditions, la préférence des acheteurs. Devant cette situation catastrophique, la Cour révoqua le 22 septembre 1766 la permission accordée l’année précédente. Mais les navires britanniques continuèrent leur commerce clandestinement. Le 31 juillet 1767, un arrêt du Conseil accorda pour cinq ans une prime de 25 sols par quintal de morue sèche de pêche importée aux Antilles. La situation ne changea pas; seuls, quelques navires de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui pouvaient se permettre de vendre de 10 à 14 livres le quintal leur morue de réfaction, continuèrent à pratiquer ce commerce.
Pour raviver l’intérêt des armateurs métropolitains, un autre arrêt du Conseil, du 14 mars 1768, permit d’entreposer en France pour les réexporter ensuite à l’étranger, avec exemption de tous droits, les sirops et tafias qui proviendraient de l’échange des morues. Cet arrêt n’eut pas plus de résultat.
En 1773, deux armateurs de Saint-Pierre entreprirent une démarche auprès du ministre de la Marine, pour lui demander d’exempter du droit d’entrée de 1 les cargaisons de morues sèches importées aux Antilles. Le 23 octobre, le ministre s’empressa de leur répondre qu’il accordait volontiers cette exemption; il ajoutait : « Je vous prie, en instruisant les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon de cette faveur, de les engager à se livrer à l’importation de cette denrée ; ils trouveront sur les lieux toute protection pour la vente et les recouvrements. Sa Majesté veut bien tolérer ce commerce directement, afin de faire cesser par tous les moyens possibles l’introduction de cette denrée par les étrangers » (97). Ces encouragements expliquent l’accroissement des envois de Saint-Pierre aux Antilles à partir de 1773. Le 19 mai 1775, d’ailleurs, la prime de 25 sols par quintal fut reconduite pour cinq ans encore. Mais, comme les ports de France s’obstinaient à ne pas profiter de ces avantages, la Cour se vit forcée de permettre à nouveau aux navires anglais de compléter l’approvisionnement des Antilles; elle le fit d’ailleurs en prenant toutes ses précautions, ainsi que le montre ce mémoire du roi, en date du 31 mars 1776, « pour servir d’instruction aux Gouverneur et Intendant des Isles du Vent, relativement à l’admission de la morue étrangère par la voye de l’entrepôt de Sainte-Lucie » : L’abandon presque absolu dans lequel le commerce de France laissoit les Isles du Vent pour leur approvisionnement de morue, dont l’usage est indispensable à la nourriture des esclaves et même d’une partie des habitants, avoit déterminé en 1765 à permettre l’introduction par l’étranger.
Cette permission a été révoquée par un mémoire du 22 septembre 1766, sur les représentations des négociants et sur les offres qu’ils ont faites de satisfaire pleinement à cette fourniture. Ils n’ont pu cependant remplir cette promesse et les habitants de nos isles ont été forcés jusqu’à présent de recourir à la contrebande pour se procurer de la morue. Sa Majesté rétablit par le présent mémoire la permission qui avoit été accordée aux étrangers, par le mémoire du 25 janvier 1765, d’introduire la morue aux Isles du Vent, moyennant un droit de 8 livres par quintal, que Sa Majesté a réduit à 5 livres pour le produit dudit droit être converti en une prime de pareille somme de 5 livres pour chaque quintal de morue de pêche nationale que les bâtiments français apporteront aux Isles du Vent, indépendamment de celle de 25 sols qui leur a été attribuée par l’arrêt du Conseil du 31 juillet 1767 (98).
Ce mémoire spécifiait bien que la morue de pêche étrangère ne pouvait être introduite que par le port de Sainte-Lucie.
La situation se rétablit au profit des armateurs français, du moins si l’on en croit ce rapport officiel qui dénombrait les quintaux de morues importées aux îles du Vent respectivement par les navires français et les navires anglais (99).
| La Martinique | La Guadeloupe | Totaux | ||
| quintaux | quintaux | quintaux | ||
| 1776 | Français | 28 289 | 12 532 | 40 921 |
| Anglais | 3 700 | 3 188 | 6 888 | |
| 47809 | ||||
| 1777 | Français | 23 061 | 5 044 | 28 105 |
| Anglais | 9441 | 6014 | 15 429 | |
| 44 530 |
Si nous remarquons qu’en 1776 et en 1777 les exportations de Saint-Pierre vers les Antilles se montèrent à 22 263 qx et 2 792 qx seulement, il faut en conclure que la concurrence des armateurs des ports de France fut fatale à ceux de Saint-Pierre. Notons également qu’à cette époque les hostilités étaient engagées entre les nouveaux Etats-Unis et l’Angleterre et leur pêche fortement handicapée.
Malheureusement, les armateurs français ne purent longtemps profiter de cette situation et durent eux-mêmes cesser leur pêche.
Lorsque la paix fut revenue, ils reprirent timidement leur commerce avec les Antilles, où ils eurent à nouveau à faire face à la concurrence des Anglais et des Américains. Les négociants de Granville déclarèrent à la Cour que dans ces conditions, il leur était impossible de continuer ces expéditions (100). En effet, un tel voyage de Terre- Neuve aux Antilles, le séjour pour la vente et le recouvrement des fonds, et la traversée de retour ne permettaient pas d’arriver en France avant la fin du mois d’avril, et à cette époque, on ne pouvait plus songer à faire un autre armement. Pour pallier cet inconvénient, la Cour décida, le 18 septembre 1785, de doubler la prime et de la porter à 10 livres par quintal de morue importée aux îles du Vent, mesure valable pour 5 ans. Ce nouvel encouragement explique le nouvel accroissement que l’on constate à Saint-Pierre de 1786 à 1790.
Telles sont les grandes lignes de ce courant commercial qui, à ma connaissance, n’avait jamais été étudié et qui, du moins, pour les îles Saint-Pierre-et-Miquelon, ne fut pas négligeable. La colonie entretint encore d’autres relations avec ses voisins du continent.
- LE COMMERCE AVEC LE CONTINENT AMÉRICAIN ET SPÉCIALEMENT LES ÉTATS-UNIS.
Le projet secret des administrateurs était de faire de Saint-Pierre un entrepôt de marchandises capable d’alimenter un commerce clandestin avec les navires anglais. Poulain de Courval, entre autres, le définissait ainsi en 1764 : « Il faut faire partir des isles (Saint-Domingue, la Martinique et autres lieux) des brigantins, goélettes et bateaux chargés de tafia, sirops, sucre brut et café et quelque peu de coton, pour la Nouvelle-Angleterre et le Canada. Les interlopes dans cette partie donneront en échange leurs bâtiments chargés de planches et de chevrons, même de bois de construction, des mâtures, etc.
A Louisbourg, le commerce avec les interlopes a monté à plus de trois millions. Il est certain que Saint-Pierre fleurira si la paix dure, puisque l’Angleterre sera obligée d’en tirer pour le Canada toutes les denrées de Saint-Domingue et la Martinique » (101).
Ce beau projet ne semble pas s’être réalisé, du moins avec l’ampleur prévue. En effet, il y eut, d’une part, assez peu de navires à venir des Antilles, nous l’avons vu; il est vrai qu’il arrivait chaque année quelques vaisseaux de Bordeaux, chargés de vins et d’alcools.
Mais, d’autre part, les corvettes de Sa Majesté Britannique faisaient bonne garde autour de la colonie, si bien que ce commerce clandestin mit beaucoup de temps à naître. La première mention qu’on en ait date de 1766; Dangeac signalait que cette année-là, trois bâtiments étaient venus de Louisbourg sans doute, en prétextant des relâches forcées, et avaient vendu des cargaisons de planches, de bœufs, de moutons et de volailles (102). En 1769, il déclarait que deux navires de Boston et deux autres du Canada avaient apporté des vivres (103). Cette même année, Woodmass effectua sa tournée d’inspection dans la colonie; il y remarqua bien un ou deux navires de la Nouvelle-Angleterre, mais rassura complètement ses supérieurs sur l’existence d’un commerce de contrebande; nulle part ailleurs, en effet, il n’avait vu le rhum, la mélasse ou le café à un prix plus élevé. Plus curieux, mais tout aussi anodins, étaient les rapports qu’entretenaient les Acadiens de Miquelon avec quelques-uns de leurs compatriotes qui venaient de s’installer à l’île Madame et à l’île Saint-Jean; la proximité relative de ces lieux permettait quelques allées et venues de chaloupes, chargées de rhum ou de vêtements (104).
En somme, il n’y avait là rien d’inquiétant pour les autorités britanniques.
Pourtant, les années qui suivirent allaient marquer le début d’un courant commercial qui ira en s’affermissant grâce aux prochaines hostilités entre l’Angleterre et ses États d’Amérique. En 1774, on a l’assurance qu’au moins une goélette de Boston, une autre de Québec et une autre de New-York vinrent apporter quelques vivres à Saint-Pierre (105). Mais en 1775, ce furent 18 bâtiments de la Nouvelle-Angleterre qui parurent dans la colonie (106); à nouveau 14, en 1776 (107) et 29 en 1777 dos). fis apportaient surtout du bois et quelques vivres; ainsi, en 1777, voici quelles furent leurs marchandises : 21 400 pieds de chêne, 262 585 planches de sapin, 109 750 bardeaux, 17 250 merrains, 89 mâts de chaloupes, 86 quarts de farine et 6627 quintaux de tabac (109). Ces marchandises étaient entreposées dans le magasin de Pierre Arondel où les habitants pouvaient se les procurer à crédit toute l’année, à condition de s’engager à les payer à la fin de la pêche d10). La prise de la colonie par les Anglais en 1778 arrêta naturellement ce commerce, qui ne dut pas être étranger à la décision britannique de s’emparer de nos îles; Saint-Pierre-et-Miquelon demeuraient en effet, en Amérique du Nord, le seul endroit où les insurgents pouvaient faire quelque négoce.
Mais la paix revenue, les Américains reprirent le chemin de notre colonie ; ils y étaient d’ailleurs encouragés par les énormes commandes de bois de construction passées par le consul de France à Boston, M. de Letombe. En 1783, 15 bâtiments américains apportèrent dans la colonie : 1 196 171 planches, 1 603 000 bardeaux, 386 070 briques, 206 boucauds de chaux et 132 000 chevrons (m). En 1784, notre documentation, certainement incomplète, ne nous indique la présence que de deux goélettes de Boston. Mais de 1785 à 1791, nous sommes en mesure d’établir un tableau à peu près complet du commerce américain à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voici d’abord le nombre des navires des Etats-Unis entrés et sortis de Saint- Pierre (112).
- 1785 30 entrés, 16 sortis
- 1786 32 – 26 –
- 1787 31 – ?
- 1788 33 – 22 – l~ –
- 1789 32 entrés, 30 sortis
- 1790 38 – 30
- 1791 22 – 16
La différence entre le nombre des vaisseaux entrés et celui des vaisseaux sortis est due aux nombreuses ventes de goélettes effectuées à Saint-Pierre.
Sur quelles marchandises portait ce commerce ? Elles n’avaient pas beaucoup varié depuis la période précédente; les Américains apportaient seulement un peu plus de vivres et un peu moins de bois.
Voici, à titre d’exemple, l’inventaire des cargaisons débarquées en 1786 : 1151 quarts de farine, 250 quarts de farine de blé d’Inde, 255 quintaux de biscuits, 82 quarts de lard salé, 18 quarts de bœuf salé, 45 quintaux de beurre, 28 quintaux de fromage, 38 bœufs et 35 vaches en vie, 3 495 weltes de rhum et 2 724 weltes de mélasse (la vente de ces deux articles fut interdite par le commandant); 1 260 quintaux de tabac, 241 700 planches, 136 000 bardeaux, j 29 295 bordages de chêne, 50 mâts, 8 700 briques, 273 quarts de goudron et 380 barriques de charbon de terre (cet article venait de Louisbourg) di3). Les autres années, les cargaisons ne différaient pas beaucoup de celles de 1785, sinon en quantité; parfois, apparaissaient des marchandises inhabituelles comme du thé, du cidre, du café, du riz, du chocolat et du savon, mais en petites quantités.
Les Américains désiraient établir à Saint-Pierre quelques maisons de commerce, ainsi que Danseville l’écrivait au ministre en 1786; mais celui-ci n’accepta pas cette proposition (114).
Il est à remarquer que ce commerce se faisait à sens unique et que les navires américains s’en allaient vides ou, comme on disait alors, « sur leur lest »; assez nombreux étaient les bâtiments qui faisaient deux et parfois trois voyages par an.
En tenant compte de ces remarques, on peut dire qu’à peu près tous les ports du continent Nord-américain de la côte est envoyèrent de 1785 à 1791 des navires à Saint-Pierre. On relève dans les registres de l’Amirauté de Saint-Pierre les lieux de provenance suivants : Baltimore, Barnstaple, Bath, Baie des Chaleurs, Baie française, Boothbay, Boston, Cap-Cod, Cascobay, Charleston, Dartmouth, Edgarton, Falmouth, les îles de la Madeleine, l’île Royale, l’île Saint-Jean, Kennebeck, Machias, Marblehead, Middleton, New-Bedford, Newburg, New-York, Nova-Scotia, Passamaquoddy, Penobscot, Peperelsborough, Philadelphie, Portland, Portsmouth, Providence, Québec, Rhode- Island, Salem, Stonington, Sydney, Thomaston, Waldborough, Wilmington, Wiseaset.
Précisons que Boston envoya à Saint-Pierre 16 navires en 1785, 8 en 1786, 5 en 1787, 13 en 1788, 17 en 1789, 10 en 1790 et 11 en 1791, soit 80 navires en 6 ans; Portsmouth en envoya 24 et NewYork 20. Le commerce avec le continent américain n’était donc pas négligeable.
* * *
Lorsque, le 14 mai 1793, les troupes du brigadier-général Ogilvie firent prisonniers le commandant, la garnison et les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, elles arrêtèrent pour une vingtaine d’années, jusqu’en 1815, le développement, somme toute satisfaisant, de notre petite colonie. Puis commença une nouvelle période de l’histoire des îles, période plus calme fort heureusement.
Après avoir connu une belle activité au cours du XIXe siècle et une bonne partie du XXe siècle, le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon passe depuis une trentaine d’années par une pénible crise. L’essor du chalutage, le développement des nouvelles techniques de séchage du poisson ont rendu inutile leur principale fonction : la longue préparation de la morue sèche par les pêcheurs métropolitains sur les échafauds et les graves du territoire.
Il ne nous appartient pas de préjuger de l’avenir des îles Saint-Pierre-et-Miquelon; nous ne pouvons que rapporter l’opinion du comte de Gobineau qui, en 1861, écrivait ces lignes : « Saint-Pierre est situé à proximité de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve, du Canada, à l’entrée du golfe Saint-Laurent. Saint-Pierre n’est pas éloigné de l’Europe. Il n’est pas loin des États-Unis. Cette situation géographique le rend apte à un grand avenir commercial. Saint-Pierre doit nécessairement devenir un entrepôt où les soieries et les vins et les divers articles d’exportation que fournit la France se rencontreront avec les produits américains; et plus les colonies anglaises du Nord-Amérique, le Canada surtout, feront de progrès dans la voie de la prospérité où elles sont entrées désormais, plus il sera inexplicable, plus il sera à déplorer que Saint-Pierre avance, de son côté, si lentement vers l’avenir qui lui est dû » (115).
NOTES
(1) Cité dans Hotblack (Miss Kate), The Peace of Paris, 1763 dans Transactions of the Royal historical Society, 3e série, vol. II, Londres, 1908, p. 234-267, voir p. 265, Appendix D.
(2) Perret (Robert), La géographie de Terre-Neuve, Paris, 1913.
(3) Paris, Maisonneuve et Larose, 1962, 2 t., 1023 p.
(4) Pour la bibliographie, je me permets de renvoyer le lecteur à ma thèse, Saint- Pierre-et-Miquelon et la rivalité franco-anglaise à Terre-Neuve au XVIIIe siècle (École nationale des Chartes. Positions des thèses, Paris, École des Chartes, 1960. p. 97-192), partiellement publiée sous le titre Histoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon (des origines à 1814), Saint-Pierre, Impr. du Gouvernement, 1962. Voir également Bourde de la Rogerie (Henri), « Saint-Pierre et-Miquelon (des origines à 1778) », Mortain, 1937, (extr. de la revue Le Pays de Granville), et Martineau (Alfred), Saint-Pierre-et-Miquelon, dans Hanotaux (Gabriel) et Martineau (Alfred), Histoire des colonies françaises, t. I, L’Amérique, Paris, 1929, p. 245 à 259. Sur la population, voir Ribault (Jean-Yves), La population des îles Saint-Pierre-et-Miquelon de 1763 à 1793. dans Revue française d’Histoire d’Outre-Mer, t. LU, n° 186 (1966), p. 5-66.
(5) Arch. nat.. Col. F3 54. fo 467.
(6) Les graves étaient des plages de sable ou de galets sur lesquelles on étendait les morues afin de les faire sécher.
(7) L’échafaud était une plate-forme de bois, accessible aux bateaux qui y débarquaient leur pêche. L’échafaud portait une baraque, dans laquelle les morues étaient traitées.
(8) On est remarquablement renseigné sur la pêche au XVIIIe siècle par le monumental ouvrage de Duhamel du Monceau, Traité général des Pesches, qui traite de la pêche morutière dans sa seconde partie, au t. II, Paris, 1772. Nous lui empruntons naturellement de nombreuses indications, ainsi que deux gravures qui montrent, mieux que toute description, ce que pouvait être la pêche à la morue sèche, (voir fig.).
(9) Cf. Arch. nat., Section O.-M., Dépôt des Fortifications, Saint-Pierre-et-Miquelon, carton 1, document 63, Mémoire sur la pêche sédentaire de la morue aux isles Saint-Pierre-et-Miquelon, par Carpilhet (1784).
(10) Cf. Arch. nat., Section O.-M., Dépôt des Fortifications, Saint-Pierre-et-Miquelon, carton 1, document 81. Nombreux renseignements sur l’utilisation des huiles de poisson par les tanneries.
(11) Nous ne pouvons ici traiter cette importante question de la rogue. Les pêcheurs de sardine de Concarneau étaient obligés de faire venir cet appât de Norvège et de Danemark, à grands frais naturellement; cf. Henri Sée, La pêche et le commerce de la sardine en Bretagne de 1791 à 1820 dans Mémoires et documents. Julien Hayem, 12e série, Paris, 1929, p. 233-260.
(12) Arch. nat.. Section O.-M.. Déoôt des Fortincations. document 3.
(13) Cf. Robert de Loture, Histoire de la grande pêche à Terre-Neuve, Paris, 1949, p. 235 à 254, Glossaire des termes de navigation et de pêche.
(14) Arch. nat., Section O.-M., Recensements, Gl 463, f° 120 et suiv. Mémoire de l’ordonnateur Malherbe (1784).
(15) Arch. nat., Col. F3 54, fo 592 et 594. (16) Arch. nat., Col. C12, fo 142. Remarquons que le témoignage de Loyer-Deslandes est suspect car son mémoire avait pour but de faire revenir le ministre sur la décision qu’il avait prise de faire évacuer les îles par les Acadiens. Or, Loyer-Deslandes avait besoin de cette clientèle pour ses propres affaires à Saint-Pierre.
(17) Arch. nat., Section O.-M., Dépôt des Fortifications, document 17.
(18) Les forces navales françaises à Terre-Neuve constituaient une station, envoyée de France, tous les ans, pour la surveillance des pêches et l’assistance aux gens de mer. Le commandant de la station reçut en outre, à partir de 1785, d’importants pouvoirs administratifs sur la colonie.
(19) Arch. nat., Col. C12 11, fo 58.
(20) Arch. nat., Col.12 11, fo 179 et suiv.
(21) Ibid.. Col. C12 16. fo 15.
(22) Ibid., Col. C12 11, fO 181
(23) Arch. nat., Col. C12 1, fo 35.
(24) Ibid., Col. C12 2, fo 24.
(25) Ibid., Col. C12 1, fo 78.
(26) Ibid., Col. C12 1, fo 81 et Col. C12 2, fo 14.
(27) Cf. Report concerning Canadian Archives for the year 1905, vol. II, Ottawa, 1905, p. 225 et suiv.
(28) Arch. nat., Section O.-M., Recensements, G1 467.
(29) Ibid., Notariat, G3 478.
(30) Arch. nat., Section O.-M., Recensements, G1 467.
(31) Arch. nat., Section O.-M., Dépôt des Fortifications, Saint-Pierre-et-Miquelon, document 63.
(32) Exemple emprunté à un mémoire de Pièche de Loubières, Arch. nat., Col.
F3 54, fo 577.
(33) Arch. nat., Section O.-M., Recensements, CI 467.
(34) Arch. nat., Section O.-M., Recensements, CI 467
262 JEAN-YVES RIBAULT (35) Cf. Report concerning Canadian Archives. p. 225 et suiv.
(36) Arch. nat., Col. C12 2. f° 178.
(37) Ibid., Col. C12 3, fo 123.
(38) Ibid., G5 37, Amirauté des îles Saint-Pierre-et-Miquelon.
(39) Arch. nat., Section O.-M., Notariat G3 478 et G3 479. On retrouvera les actes cités à leur date.
(40) Cf. notamment Arch. nat., Col. C12 21, f° 64 et suiv.
(41) Arch. nat., Section O.-M., Notariat G3 478 et 479.
(42) Arch. nat., Section O.-M., Notariat, G3 479 in fine.
(43) Duhamel du Monceau, op. cit., p. 89, distingue l’armement en traite («Le capitaine échange la marchandise de traite contre la morue préparée par les gens du pays, pour accélérer le retour, ou pour louer des matelots. ») et l’armement en troc (« pour se procurer du poisson tout préparé à prix d’argent ou contre marchandises »). Nous ne pensons pas que, dans le cas présent, cette distinction soit utile.
(44) Id., ibid., p.92. On armait en général une chaloupe par 20 tonneaux. (45) Arch. nat., Section O.-M., Dépôt des Fortifications, document 63.
(46) Exemple emprunté à un mémoire de Pièche de Loubières, Arch. nat., Col. F3 54, fo 577 et suiv. Remarquons en outre que les armateurs, dans les engagements qu’ils faisaient contracter, sous-seing privé, à leurs équipages, les rendaient caution les uns des autres, en sorte que, si un ou plusieurs matelots désertaient, même avant leur départ de France, le produit de la pêche des autres répondait du remboursement de l’argent et de la grosse de ces déserteurs. Col. C12 9, fo 175 et suiv.
267
(47) Même exemple emprunté à un mémoire de Pièche de Loubières, Arch. nat., Col. F3 54, fo 577 et suiv.
(48) Pour tout ce qui précède, cf. Arch. nat., Col. C12 21, fo 64 et suiv.
(49) Cf. Duhamel du Monceau, op. cit., p. 91.
(50) Cf. Daubigny, Choiseul et la France d’Outre-mer, p. 160.
(51) Arch. nat., Col. C12 1, fo 35.
(52) Arch. nat., Col. F3 54, fo 469.
(53) Ibid., Col. C12 1, fo 61.
(54) Arch. nat.. Section O.-M., Recensements, G1 467.
(55) Ibid.
(56) Arch. nat., Section O.-M., Dépôt des Fortifications, document 31.
(57) Arch. nat., Col. F3 54, fo 474 et suiv.
(58) Ibid., fo 477.
(59) Nombreux exemples dans les archives du notariat conservées aux Arch. nat., Section O.-M.. G3 478 et 479.
(60) Arch. nat., Section O.-M., Recensements, Gl 467.
(61) Arch. nat., Section O.-M., Recensements, Gl 463 fo 122 et suiv.
(62) Arch. nat., Col. C12 9, fo 180 et suiv.
(63) Arch. nat., Col. C12 15. fo 138 et suiv.
(64) Ibid.. Col. – C12 10. fo 11.
(65) Ibid., fa 61.
(66) Arch. nat., Col. C11 F5. fo 119 et suiv.
(67) Il n’y a pas si longtemps, au début de ce siècle, ces engagements de pêcheurs bretons donnaient lieu à une pittoresque manifestation, la Foire ès Marins, qui se tenait au Vieux-Bourg en Pléhérel (Côtes-du-Nord), cf. l’intéressante étude de Paul Sebillot, Le Folklore des pêcheurs, Paris, 1901. p. 300 et suiv.
(68) Arch. nat.. Col. C12 1. fo 81.
(69) Arch. nat., Col. C12 2, fo 24.
(70) Arch. nat., Col. C12 3, fo 196.
(71) Arch. nat., Section O.-M., Recensements. Gl 467.
(72) Ibid.
(73) Arch. nat., Col. C12 12, fa 31.
(74) Arch. nat.. Section O.-M Rep.ensp.mp.nl-s Cl 467
(75 ) Arch. nat., Col. C12 4, fo 10.
(76) Pour tout ce qui suit, voir l’important mémoire de Pièche de Loubières, Arch. nat., Col. C12 9, fo 176 et suiv. et F3 54, fo 584 et suiv.
(77) Arch. nat., Col. G12 2, fo 24.
(78) Ibid., Col. C12 3, f° 20.
(79) Ibid.. Col. C12 4. f° 5.
(80) Ibid., Col. F3 54, f° 493.
(81) Arch. nat., Col. C12 4. fo 6 et suiv.
(82) Ibid., fo 7 et suiv.
(83) Ibid.. fo 39.
(84) Ibid., Col. C12 4, fo 34.
(85) Ibid., fo 42 et suiv.
(86) Arch. nat., Section O.-M., Recensements, G1 463, fo 150 et suiv.
(87) Arch. nat., Col. C12, fo 176 et suiv. La Grand-Terre est naturellement Terre-Neuve.
(88) Arch., nat., Col. C12 16. fo 59.
(89) Les états de pêche sont aux Archives nationales sous la cote Col. C12 19 à C12 21. Les archives de l’Amirauté sont aussi aux Archives nationales sous la cote G5 37.
(90) Cf. Arch. nat., G5 37, année 1790.
(91) Nous ne pouvons donner ici de références; tous les tableaux présentés dans ce chapitre sont le résultat des calculs opérés dans les deux séries d’archives citées dans les notes précédentes.
(92) Arch. nat., Col. C12 1, fo 4.
(93) Ibid., Col. C12 21, fo 50 vo.
(94) Arch nat., Section O.-M., Dépôt des Fortifications. Saint-Pierre-et-Miquelon, pièce 73.
(95) Est-il besoin de rappeler que les îles Saint-Pierre-et-Miquelon furent le paradis des contrebandiers d’alcools au temps de la prohibition?
(96) Pour cet exposé, nous avons utilisé un dossier conservé aux Archives d’Illeet-Vilaine, sous la cote C 1594 (Intendance-Pêche et commerce de la morue 17271786), et en outre un mémoire des négociants de Granville, Arch. nat., Col. C11 F 5 f° 21 à 29.
(97) Arch. nat., Col. C12 6, fo 9 et suiv.
(98) Arch. nat., Section O.-M., Dépôt des Fortifications. Saint-Pierre-et-Miquelon, pièce 20.
(99) Ibid., pièce 22.
(100) Arch. nat.. Col. Cll F5. fo 21 et suiv.
(101) Arch. nat., Section O.-M., Dépôt des Fortifications. Saint-Pierre-et-Miquelon, pièce 8.
(102) Arch. nat., Col. C12 2, fo 33.
(103) Arch. nat., Col. C12 3, fo 72.
(104) Cf. Report concerning Canadian Archives for the year 1905, vol. 2, Ottawa, 1905, p. 225 à 227. L’île Madame était située dans la baie de Canso (île du Cap-Breton); cette île préoccupait beaucoup les autorités britanniques; elles se demandaient en effet comment les Acadiens qui s’y trouvaient pouvaient s’habiller avec des tissus français; on découvrit que les navires de Jersey les approvisionnaient de cette marchandise. En 1774, même le gouverneur de la Nouvelle-Écosse s’inquiéta du peuplement régulier de cette petite île par des Acadiens qui venaient de France sur ces mêmes navires de Jersev. Ibid., p. 233.
(105) Arch. nat., C12 4. fo 42.
(106) Arch. nat., Col. C12 4, f° 88.
(107) Ibid., fo 90.
(108) Ibid., Col. C12 5, fo 19.
(109) Ibid., fo 20. (110) Arch. nat., Section O.-M., Dépôt des Fortifications, Saint-Pierre-et-Miquelon. pièce 73.
(111) Arch. nat.. Col. C12 8. fo 19.
(112) Tableau établi d’après le dossier G5 37 (Amirauté).
(113) Arch. nat., Col. C12 21, f° 105. Nous n’avons pu déterminer ce que représentait les mesures « quart » et « barrique »; le quart, en tout cas, contenait plusieurs quintaux.
(114) Arch. nat., Col. F3 54, f° 571. (116) Gobineau (le comte A. de), Voyage à Terre-Neuve, Paris, 1861, in-16°, p. 43. j