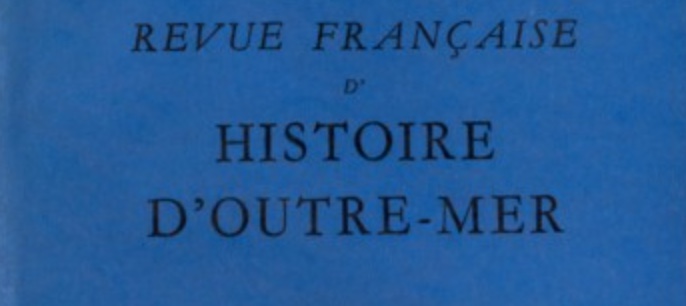Jean-Yves Ribault, conservateur en chef honoraire du patrimoine de l’École nationale des chartes, est spécialisé dans l’histoire des îles Saint-Pierre et Miquelon. Dans son étude couvrant la période de 1763 à 1793, Ribault examine en détail le peuplement de ces îles, leur rôle stratégique et économique, ainsi que les conditions de vie des colons, notamment les Acadiens déplacés par les Britanniques. Son travail met en lumière les défis économiques et politiques auxquels ces îles ont été confrontées, tout en soulignant l’importance de la fidélité de ces colons à la France.
La Population des îles SAINT-PIERRE et MIQUELON
de 1763 à 1793 par Jean-Yves Ribault
- Introduction
- LA POPULATION
- Le peuplement.
- Le préfet apostolique et l’état-civil.
- Irlandais et Micmacs.
- LA CONDITION DES COLONS
- Les notables.
- Pêcheurs et artisans de Saint-Pierre.
- Les Acadiens de Miquelon
- Des témoins : Cassini et Chateaubriand.
Introduction
Le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon, séparé de la France par toute l’étendue de l’Atlantique-Nord, minuscule archipel oublié au sud de Terre-Neuve et en marge du américain, paraît de nos jours comme une sorte de la géographie politique. Peut-on concevoir plus grande disproportion entre ces îles dont la superficie totale est de 242 kilomètres carrés et ses énormes voisins : Canada, États- Unis et même Terre-Neuve, plus grand contraste entre leur prospérité et son dénuement ? Les véritables dimensions du territoire sont ses dimensions économique et historique. Aujourd’hui d’ailleurs sa dimension historique tend à supplanter sa fonction économique, quelque peu amoindrie par les méthodes modernes de la grande pêche.
L’histoire des îles Saint-Pierre et Miquelon se rattache étroitement, sous l’Ancien Régime, à celle des autres colonies françaises d’Amérique du Nord. Parmi elles, le Canada a retenu l’attention d’innombrables historiens, souvent éminents ; mais la Nouvelle-France ne fut pas la seule et peut-être pas la plus importante des possessions françaises dans ces régions ; colonie de peuplement, le Canada était loin de valoir, dans l’esprit des négociants français et des mercantilistes les pêcheries de Terre-Neuve, véritable colonie d’exploitation qui donna lieu durant tout le xviiie siècle à une âpre rivalité franco-anglaise. C’est dans cette perspective historique qu’il faut replacer les îles Saint-Pierre et Miquelon [1].
D’abord petit poste de pêche, fréquenté depuis 1520 par les navires portugais, puis bretons, les îles furent habitées à partir de 1660 environ et pourvues d’un embryon sous la direction d’un commandant nommé en 1694 ; elles dépendaient du gouverneur de Plaisance et furent cédées aux Anglais, comme Plaisance elle-même, par le traité d’Utrecht en 1713. Louisbourg prit alors la relève et connut grâce à la pêche sédentaire une remarquable prospérité jusqu’en 1758, date à laquelle les Anglais s’emparèrent de l’ Ile-Royale. La France ne possédait plus alors aucun établissement de pêche en Amérique du Nord ; le commerce de la morue sèche était si important pour les ports de France que tous les négociants et tous les armateurs demandèrent à la Cour de se faire la possession d’un poste de pêche. Choiseul, sans se préoccuper davantage du Canada, n’eut de cesse qu’il n’obtînt, pour remplacer Louisbourg, les îles Saint-Pierre et Miquelon, malgré la farouche opposition de l’opinion publique anglaise, représentée au Parlement par l’intraitable William Pitt.
C’est ainsi que le petit archipel fut promu au rang de colonie administrée par un gouverneur. Dernier établissement français en Amérique du Nord, les îles Saint-Pierre et Miquelon furent naturellement en butte à l’hostilité anglaise et durent capituler le 13 septembre 1778. Rendues à la France par le traité de Versailles en 1783, elles furent à nouveau conquises par une escadre anglaise le 14 mai 1793 pour n’être restituées qu’en 1815 par le second traité de Paris.
La fonction principale assignée à la colonie après celle de Plaisance (Terre-Neuve) et celle de Louisbourg (Ile Royale) était de préserver et d’exploiter notre droit de pêche à Terre- Neuve. Cette fonction économique est primordiale dans des îles. Déjà traitée par ailleurs [2], nous ne nous y attarderons pas.
Ce que nous présentons ici, c’est l’étude de la population des îles à la fin de l’Ancien Régime. De ce point de vue, comme des points de vue politique et économique, la nouvelle colonie prend la suite de l’Ile Royale et de l’Acadie dont elle fut pour ainsi dire la base de repli.
I. — LA POPULATION
1. — Le peuplement.
Le peuplement des îles Saint-Pierre et Miquelon constitue l’un des aspects les plus originaux et certainement le plus émouvant de l’histoire de la petite colonie. Elle a en effet servi de refuge à de nombreux Acadiens, ce malheureux peuple qui, bien avant d’autres, a souffert toutes les tribulations qu’ont dû supporter à notre époque ce que l’on nomme les personnes déplacées.
A la fin du xviie siècle, l’Acadie s’étendait aux régions qui forment aujourd’hui la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et la Gaspésie. Peuple agriculteur, les Acadiens ne comptaient, en 1671, que 63 familles composées d’environ 400 personnes ; en 1686, on évalue la population à un millier d’âmes environ, à 1.486 en 1707, à 2.800 peut-être en 1714 [3]. On sait qu’en 1713, le traité d’Utrecht avait attribué l’Acadie, sous le nom de Nouvelle-Ecosse, à l’Angleterre. Le gouvernement britannique ne réussit pas à s’attacher cette population profondément catholique et dont on peut dire que la fidélité à la France avait quelque chose de religieux. Ces laboureurs, qui faisaient fructifier des terres fertiles et élevaient de beaux troupeaux, gardaient vis-à-vis de l’administration britannique une attitude méfiante qui irritait les Anglais. Les familles acadiennes comptaient en moyenne cinq enfants chacune, si bien que la population se montait à 7.598 personnes en 1737, 12.500 en 1748 et environ 15.000 en 1754, pour 3.000 familles [4] ; des centaines d’Acadiens passèrent à l’Ile-Royale et à l’Ile Saint- Jean, dont l’Angleterre ne voyait pas les progrès d’un bon œil. Si l’on ajoute qu’en cas de guerre, le gouvernement britannique pouvait craindre qu’encouragée et soutenue par la forte garnison de la colonie française toute proche, la prolifique population acadienne ne se révoltât, on comprend le projet mis sur pied par les Anglais en 1749 : évacuer ces encombrants sujets dans les états de la Nouvelle-Angleterre situés plus au sud et les remplacer dans leurs terres par de nouveaux colons amenés d’Europe, qui formeraient sur les frontières du Canada et de l’ Ile-Royale une population plus sûre. La fondation d’Halifax constitua un premier stade dans la réalisation de ce projet ; la nouvelle ville comptait déjà, en 1752, 4.228 [5].
Restait à exécuter le plus difficile : la déportation et la spoliation des Acadiens. Ce fut au village des Mines que commença le 11 août 1755 l’opération que les Acadiens eux- mêmes ont appelés « le grand dérangement ». Tandis que des milliers d’entre eux s’enfuyaient dans les forêts, ou passaient la frontière pour se réfugier au Canada et à l’ Ile-Royale avec ce qu’ils pouvaient sauver de leurs récoltes et de leurs le reste, que l’on estime à un chiffre compris entre 6.500 et 8.000 déportés, était entassé dans des navires qui débarquaient leur cargaison dans les ports de la Nouvelle-Angleterre [6] ; la Virginie, où échouèrent environ 1.500 de ces malheureux, ne voulut pas les accueillir et, considérés comme prisonniers de guerre, ils furent transportés en Angleterre. Le Maryland en refusa 1.200 qui furent refoulés dans les états voisins ; la Caroline et la Pennsylvanie recueillirent donc la plus grande partie des exilés [7]. Nous avons indiqué les raisons qui expliquent cette opération, mais on ne trouve aucune excuse, à la décharge de l’administration anglaise, pour les conditions déplorables dans lesquelles elle se déroula. Enfin, parmi les Acadiens qui avaient réussi à gagner l’ Ile-Royale, un grand nombre furent transportés en France, lors de la prise de Louisbourg par les Anglais, en 1758.
La paix de 1763 permit au gouvernement français de s’occuper de ces malheureux, victimes de leur fidélité au roi de France. Ceux qui étaient en Angleterre purent revenir en France. L’ambassadeur de Louis XV à Londres, le duc de Nivernais estimait, dans un mémoire du 4 mars 1763, que 866 Acadiens demeuraient encore en Angleterre, particulièrement à Liverpool, Southampton, Bristol et Penryn [8]. que l’on s’occupait enfin de leur triste sort, ils avertirent en leurs compatriotes demeurés en Amérique ; le duc de Choiseul reçut de Philadelphie une lettre, en date du 20 juin 1763, ainsi libellée : « Nous avons receu la copie de celle que Votre Grandeur a eu la bonté de faire tenir à nos frères qui sont en Angleterre, par laquelle nous apprenons que Sa Majesté très chrétienne veut nous retirer de l’esclavage où nous avons esté depuis que l’on nous a déprivé du peu de biens que (sic) nous jouissions auparavant la guerre » [9]. Ce fut la première des nombreuses requêtes qui parvinrent durant l’année 1763,. de toutes les colonies anglaises d’Amérique du Nord à la Cour de Versailles. Le 22 novembre 1763, d’après ces recensements, on put établir un dénombrement général des détenus Acadiens en Amérique : 1.709 en Nouvelle-Angleterre, 249 en Nouvelle- York, 781 en Nouvelle-Ecosse (sauf les familles dispersées sur les côtes), 810 dans le Maryland (à Newton, Georgetown^ Fredericktown, Showhill, Princestown, Port-Tabaco, Haut et Bas-Marlborough, Oxford et Baltimore), 383 en Pennsylvanie, 280 en Caroline du Sud et 185 en Géorgie, au total 4.397, dont 732 hommes, 765 femmes et 2.900 filles et garçons [10]. En outre, à la fin de l’année 1763 il y avait en France de 3.000 à 3.500 Acadiens, y compris ceux qui étaient revenus et qu’on avait regroupés, à Morlaix particulièrement [11].
Nul n’a mieux dit que Bourde de la Rogerie quels pouvaient être à cette époque les sentiments et la situation de déracinés. Durant la guerre, la France en avait accueilli beaucoup ; ceux qui, à l’ Ile-Royale, s’étaient accoutumés aux choses de la mer, avaient embarqué sur les corsaires français ; les plus nombreux, profitant de la diminution de la main-d’œuvre dans les régions maritimes, avaient trouvé facilement de l’ouvrage.
Mais la paix de 1763 rendit leur existence plus difficile ; « les travailleurs revinrent en foule des armées, des escadres et des prisons d’Angleterre. Les proscrits éprouvèrent les tristesses du chômage. Ils vivaient pauvrement dans les bas-quartiers des ports (Dunkerque, Boulogne, Le Havre, Cherbourg, Saint- Malo, Morlaix, Rochefort, Bayonne), parlant entre eux des champs ou des barques qu’ils avaient perdus. Ils avaient le mal du pays — d’un pays où ils avaient peiné et souffert, mais qu’ils avaient commencé à civiliser » [12].
Le gouvernement français ne demandait pas mieux que de leur donner les moyens de reconstituer leur communauté dispersée [13]. Choiseul les invita d’abord à passer aux Colonies, au Kourou, dont il voulait particulièrement encourager l’établissement, à la Martinique et naturellement à Saint-Domingue et à la nouvelle colonie des îles Saint-Pierre et Miquelon [14]. Pour les Acadiens qui vivaient en France dans la misère et ceux qui souffraient de leur exil en Amérique, ce dernier territoire sembla le lieu idéal où ils pourraient se refaire une vraie patrie. Choiseul aurait volontiers accepté de les y faire passer, mais il savait fort bien que les îles Saint-Pierre et Miquelon ne pouvaient accueillir qu’un nombre limité d’habitants, qui, en outre, ne devraient compter pour vivre que sur la pêche. C’est pourquoi, dans les instructions qu’il rédigea pour le nouveau gouverneur, Dangeac, en février 1763, il avait noté : « Comme il se pourroit que, parmi le grand nombre d’Acadiens qui sont en France, dans l’Ancienne et la Nouvelle Angleterre, il y en eût plusieurs qui voulussent aller s’établir dans les isles susdites et que leur trop grande afïluence pourroit donner quelque sujet de jalousie aux établissements anglois voisins, Sa Majesté recommande au sieur Dangeac de ne recevoir que le moins qu’il pourra de ces familles, autant par rapport au sujet ci-dessus que pour éviter la dépense qu’elles occasionneroient et le préjudice que leur trop grand nombre causeroit à son établissement. » [15] Dangeac dut alors recruter quelques familles acadiennes, pas plus d’une centaine sans doute. Le gouverneur représenta au ministre que ces familles, dénuées de tout, ne pourraient, avant de longs mois, subvenir à leurs besoins et qu’il convenait donc que le roi leur fournît les vivres et les ustensiles de pêche, qu’elles ne pourraient se procurer. Choiseul répondit, le 12 avril, qu’il trouvait ces demandes fort justes et qu’il chargeait l’intendant du dépôt des colonies, à Rochefort, de faire passer à Saint-Pierre ces vivres et ces ustensiles, pour une somme de trente à quarante mille livres. Mais il précisait bien que Dangeac ne devrait distribuer ces marchandises que petit à petit et à crédit ; les habitants auraient par la suite à en régler la valeur sur le produit de leur pêche, sans pouvoir espérer pour l’avenir de fournitures « s’ils ne se mettoient en état par leur travail et leur économie de rembourser les premières. Il faut en effet, continuait le ministre, prendre garde de tomber avec ces familles dans les inconvénients qu’on a éprouvés à l’Isle Royale après la remise de possession. Vous savez qu’on leur donnoit du magasin du Roy des vivres et toutes sortes d’ustensiles de pêche dont la plus grande partie du prix n’est jamais rentrée et n’a produit aux habitans que l’avantage de vivre sur les lieux sans être presque d’aucune utilité. La même facilité opèreroit sans doute une plus grande population. Mais elle seroit à charge et sans fruit. Il faut dans ces isles des gens propres à la pesche, des ouvriers et non des habitans sans état ni profession ; c’est surtout dans le commencement de l’établissement qu’il convient de rejeter ceux qui ne pourront point servir. Vous en sentirez les conséquences mieux que personne. » Le ministre, enfin, précisait sa pensée sur l’avenir de la colonie : « Je sais bien que les isles Saint-Pierre et Miquelon pourront avec le temps devenir un entrepôt assez considérable de commerce ; mais elles ne le peuvent qu’autant que la base de leur établissement, qui est la pêche et la sècherie, prendra des accroissements et des principes. Il en résulte absolument qu’il ne faut, quant à présent, placer que des pêcheurs et des ouvriers et n’y souffrir aucune bouche inutile » [16] Dangeac, à l’été 1763, passa donc à Saint-Pierre. De Rochefort, il avait emmené une centaine, peut-être, de chefs de famille. Mais, à peine arrivé, il vit affluer 115 Acadiens des colonies anglaises. Ils venaient de Boston, Roxbury, Charletown, Savannah, Tinten et de nombreux autres villages ; ils portaient seulement quatre noms de famille : Hébert, Vigneau, Le Blanc et Sire [17]. L’année suivante, au mois d’août, 110 autres arrivèrent de l’Ile-Royale et de l’île Saint- Jean, cette fois,, particulièrement de Chedabouctou, de la pointe de Beauséjour et de Beaubassin ; ceux-là s’appelaient Laforest, Boudreau, Vigneau, Le Maie, Chiasson, Bourgeois, Cormier, Bertrand, Cormeau, Arsenau, Lapierre, Devaud, Boudret, Dousset, Renaud, Poirier, Oncle, Brand, Gaudet, Hébert, Mirât, Le Blanc, Pire, Sire et Gautier [18]. Ils rejoignirent les réfugiés de l’année précédente à Miquelon. A la même époque, était arrivé à Saint-Pierre un navire du roi, la flûte La Nourrice, confiée à un certain Gilbert, qui avait passé avec le roi un marché selon lequel il ferait partir pour Cayenne le plus possible d’Aca- diens, au prix modique de 12 sols par ration. Choiseul, qui en faisait part à Dangeac, dans une lettre du 3 mars, lui recommandait de favoriser cette émigration ; il avait d’ailleurs adjoint à Gilbert, deux Acadiens, Perrault et Maurice, qui encourageraient leurs compatriotes à passer en Guyane. – II recommandait enfin « de ne point surcharger les isles Saint- Pierre et Miquelon des habitants de l’Amérique septentrionale. Le nombre de ceux qui demandent à y passer est, en effet, si considérable, qu’il ne seroit pas possible de les y placer. Vous ne recevrez cette année que quelques familles qui sont à Saint-Malo et des enfants qui sont à Rochefort et dont les pères et mères sont passés avec vous l’année dernière ; tous les autres passeront à la nouvelle colonie de la Guyane [19] où je leur procurerai toutes sortes d’avantages, concessions de terres, vivres et outils, et j’espère que dans peu d’années elle deviendra une colonie florissante » [20].
La mission de Gilbert fut plus difficile que ne le prévoyait Choiseul. Il semble que les Acadiens, réfugiés à Miquelon, évitèrent toute rencontre avec Perrault. Celui-ci n’eut d’autre ressource que de leur envoyer de Saint-Pierre des lettres qui révèlent tout ce qu’avait de patriarcal, de religieux, de biblique pourrait-on dire, la société acadienne. Pour les émouvoir, il faisait appel à leur affection pour leurs enfants, il employait des termes empruntés à l’Évangile : « Permettez-moi, leur écrivait-il le 1er septembre, de vous représenter, en qualité de compatriote, que les îles Saint-Pierre et Miquelon ne sont pas des endroits où vous puissiez raisonnablement penser être heureux. Vous avez assez de bon sens pour prévoir que vos familles seront considérables en peu de temps. Vous êtes trop bons pères et bonnes mères pour n’être pas continuellement occupés du bien-être de vos enfants et de leur assurer des établissements solides où ils pourront exercer leur religion. Vous êtes, ainsi que moi, comme des Israélites qui cherchez la terre promise. Il faut faire en sorte de la trouver. Il n’y a point dans les îles Saint-Pierre et Miquelon des ruisseaux qui coulent le lait ni le miel ; au contraire, on peut regarder ces îles comme susceptibles des plus tristes événements et leur peu d’étendue jointe à la stérilité du terrain nous annoncent que plus il y aura d’habitants, plus il y aura de malheureux… Croyez-moi, mes chers frères, venez vous mettre dans le sein de la flûte La Nourrice : vous y trouverez M. Gilbert qui vous sera un bon père et qui ne vous laissera manquer de rien… C’est à vous, messieurs Joseph et Jacques Maurice (Vigneau), comme chefs, à qui je m’adresse particulièrement. Je vous connais pour des hommes remplis de zèle, toujours prêts à vous sacrifier pour les intérêts du roi et ceux de vos Vous savez, monsieur Joseph, que lorsque je fus à Chedabouctou, vous y étiez comme ensevelis. Je vous rappelai à la vie en vous informant des intentions du Roi. Vous m’assurâtes que vous étiez prêts à les remplir. » [21] Perrault terminait cette première lettre en les invitant à passer à Cayenne. Les Acadiens de Miquelon lui répondirent aussitôt qu’ils reconnaissaient les grands avantages que le ministre leur assurerait en Guyane, mais, faisaient-ils remarquer, « nous vous prions de faire attention qu’un pays aussi chaud que celui de Cayenne nous coûterait trop cher, de même que les pays chauds nous ont coûté, où les Anglais ont transporté nos gens, par la force d’un climat si excessivement chaud en comparaison de l’Amérique du Nord qui est tempéré et d’autant plus sain pour nous qu’il est notre pays natal. Quelqu’avantage qu’on nous propose en acceptant ce parti et quelques menaces qu’on nous fasse pour le faire, nous préférerons toujours la vie à tout et jamais nous n’accepterons le parti de quitter ce climat ici. C’est le sentiment commun de tout notre monde, quoique le nombre en soit petit après en avoir perdu la majeure partie, tant par la faim, la prison et les mauvais traitements des Anglois pour nous faire accepter leur parti et changer de sentiments pour notre grand roi, mais rien n’y a pu réussir. L’affection pour notre grand monarque et notre patrie l’a emporté sur toutes les peines des fers et toutes sortes de mauvais traitements que nous avons souffert de l’ennemi… Nous espérons que notre bon roi de France, notre père, voudra bien nous traiter comme ses pauvres enfants et fidèles sujets de son grand pouvoir en ne nous contraignant pas de passer dans un climat si opposé à celui de notre naissance » [22]. Leur détermination ne fut pas plus ébranlée par une seconde lettre de Perrault, du 16 septembre, qui tâchait d’apaiser leurs craintes et qui se terminait d’ailleurs par le rappel de leur entière liberté de décision [23]. En définitive, la mission de Perrault se solda par un échec complet ; Dangeac en avertissait Choiseul le 4 octobre : « J’ai toujours différé à rendre compte à Votre Grandeur des progrès que feroient Mrs Gilbert et Perrault dans l’émigration qu’ils dévoient faire du reste malheureux des Acadiens… Ils n’ont pu en déterminer un seul dans un climat qui les effraye. J’ai même poussé la dureté envers ceux qui sont venus cette année au nombre de 110, et 115 de l’année passée, jusqu’à défendre à Mr le baron de l’Espérance [24] de leur permettre de se bâtir Le sieur Gilbert emmènera avec luy à Cayenne environ cent personnes de différentes nations ; le sieur Perrault et sa famille en feront partie » [25]
Non seulement tous les Acadiens étaient demeurés à mais l’année suivante, au début du mois d’octobre, en arrivèrent 111 qui s’étaient enfuis de l’île Saint-Jean et d’Halifax. Quelque temps après, 72 autres vinrent de la pointe Beau- séjour [26] ; ils avaient frété en ce lieu un bateau anglais pour aller à Halifax, mais ils avaient profité d’une tempête pour venir à Miquelon d’où ils ne voulurent pas repartir pour leur primitive. Dangeac ne pouvait pas les garder dans la colonie, à cause du manque de vivres ; aussi ordonna-t-il au baron de l’Espérance de les faire passer à Saint-Pierre d’où ils s’embarqueraient pour la France sur le brigantm Les deux amis ; l’ordre ne fut exécuté qu’en partie ; 35 personnes seulement acceptèrent d’être rapatriées ; les autres se cachèrent à Miquelon pour éviter ce nouvel exil [27].
A Versailles, le ministre s’émut de cet afflux d’habitants dans la colonie. Le 1er août 1766, il informa Dangeac qu’il était « impossible de les conserver dans un pays sans ressource pour eux, qui ne sont pas pêcheurs. Sa Majesté m’a ordonné de vous dire en conséquence qu’elle leur laisse la liberté ou de retourner à l’Acadie ou de revenir en France. S’ils viennent en France, on leur procurera des terres à cultiver et la subsistance en attendant la première récolte. Quelle que soit la détermination que ces familles prendront lorsque vous leur aurez fait part des intentions de Sa Majesté, elles ne doivent point «spérer qu’on leur fournisse aucune espèce de ration à partir du mois de mai de l’année prochaine. La plupart se contentent de vivre aux dépens du gouvernement sans rien faire ; elles sont à charge aux finances sans aucune espèce d’utilité, au lieu que si elles viennent en France, elles pourront du moins travailler à l’agriculture et Sa Majesté, qui connoit leur zèle pour la religion et leur attachement à sa personne, les traitera avec la même bonté que les autres acadiens qui sont en France. Je vous répète que le Roy ne veut absolument souffrir aux îles Saint-Pierre et Miquelon que des pêcheurs. » [28] Dangeac ne manqua pas de faire part des propositions ministérielles à ses administrés ; ce qui les jeta, rapporte le gouverneur, « dans la plus grande consternation, chaque famille ayant employé le peu de ressources qu’elle avoit pour se bâtir une maison et un jardin. Ils ont actuellement douze bateaux, ou bâtiments pontés et dix esquifs de pêche. Ils sont attachés à la France et ne veulent point retourner en Acadie ; plusieurs d’entre eux passeroient volontiers en Louisiane » [29]. Dangeac envoyait aussi à la Cour le premier recensement de la colonie ; au 19 juin 1767, les îles comptaient 1.250 personnes auxquelles on fournissait la ration ; dans ce nombre, le gouvernement distinguait 551 Acadiens qui formaient une centaine de familles venues de Louisbourg, Chedabouctou, Boston, Pigiquit, Fort Cumberland, Halifax, Beauséjour, Fort Pesnit et de l’île Saint-Jean [30]. Qu’étaient donc les 599 autres ? Dangeac ne nous le dit pas ; nous pensons qu’il s’agissait également d’Acadiens, mais qui étaient venus de France avec la permission de la Cour, en 1763 et 1764 ; ils devaient faire partie des colons de l’Ile-Royale rapatriés en 1758, lors de la prise de Louisbourg ; habitués déjà au commerce maritime ils s’étaient installés à Saint-Pierre. Ce que Dangeac appelait Acadiens, c’étaient proprement les évadés des colonies anglaises qui, laboureurs jusque-là, s’étaient réfugiés dans le seul endroit de la colonie susceptible d’un peu de culture, l’île Miquelon ; ils avaient d’ailleurs courageusement tenté de s’appliquer à la pêche, puisqu’ils possédaient déjà quelques goélettes. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette distinction entre les habitants de Saint-Pierre et ceux de Miquelon, que la correspondance administrative qualifiera toujours d’Acadiens.
Pour obéir aux ordres de Versailles, Dangeac fit cesser, le 1er mai 1767, les distributions de vivres aux Acadiens ; cette mesure sévère ne suffit pas pour les engager à quitter leur nouvel établissement. Aussi, le 15 avril 1767, le roi prit-il une mesure radicale : il ordonna au gouverneur de renvoyer en France toutes les familles acadiennes [31]. Dangeac exécuta consciencieusement cet ordre, mais il ne put s’empêcher, le 6 octobre, de marquer à la Cour tout ce que la mesure avait d’injuste : « Me voici bientôt à la fin de l’émigration des habitants de ces isles. Elle m’a occasionné beaucoup de peines et d’embarras et sans doute il en coûte, quand il faut arracher de leurs établissements de pauvres misérables qui ont sacrifié le fruit de tous leurs travaux pendant quelques années pour se les former et sont forcés de les abandonner dans le temps qu’ils commençoient à en tirer quelqu’avantage. » [32] 763 quittèrent la colonie ; 586 d’entre elles s’embarquèrent pour la France, 14 gagnèrent l’Amérique, c’est-à-dire sans doute la Louisiane, et 163 retournèrent en Acadie. Il ne restait sur les îles qu’environ 300 habitants sédentaires [33]. En France, les exilés connurent à nouveau dans les ports de débarquement, à Saint-Malo et Rochefort, une longue attente, oisive et misérable, jusqu’au moment où, quelques mois plus tard, Choiseul prit la décision inattendue de leur permettre de retourner à Miquelon. Quels motifs lui inspirèrent cette volte-face ? On ne le sait trop. Peut-être s’émut-il de leur triste situation ; peut-être céda-t-il à leurs prières ; plus probablement fut-il impressionné par les mémoires des négociants de Saint-Pierre, Antoine Rodrigue, Dupleix-Sylvain et Loyer-Deslandes, qui représentaient que la situation de leurs compatriotes de Miquelon n’était pas si déplorable que Dangeac l’écrivait et que leur exil causait au commerce de la colonie un grand préjudice [34]. Dangeac vit donc revenir, à la fin du mois de juin 1768, 66 personnes sur la goélette La Louise, appartenant à Vigneau, et 219 sur le navire Le Senac, armé à Rochefort pour le compte du roi [35]. Tel fut le dénouement d’une mesure regrettable qui eut pour résultats de coûter au trésor royal les frais de deux voyages, du séjour dans les ports et du rachat des meubles et chaloupes vendus en 1767, d’aigrir un peu plus les Acadiens et de produire, dans leur petit groupe, une sourde méfiance envers Dangeac rendu responsable de leurs malheurs [36].
L’année suivante, 1769, quelques familles de Saint-Pierre demandèrent à leur tour à repasser en France au compte du roi, parce qu’elles ne pouvaient plus assurer leur subsistance dans l’île ; le 24 octobre, l’aviso du roi L’Expérience, commandé par M. de Ravenel, reçut les familles Dubourdieu, Martin, Guillaume Desroches et Pierre Dupont, comptant en tout une trentaine de personnes [37]. En 1773, trois autres familles gagnèrent le Canada où des parents aisés les appelaient ; la Cour montra une nouvelle fois, en cette occasion, les hésitations de sa politique envers les Acadiens ; de Boynes, le secrétaire d’État à la marine, informa le gouverneur, le 28 février 1774 que le roi avait désapprouvé sa conduite : « II m’a chargé de vous dire que son intention étoit que vous ne vous prêtiez à aucune expatriation de ce genre, sous quelque prétexte que ce soit, cet exemple étant d’une dangereuse conséquence. » [38] Beaucoup plus tard, en octobre 1789, la famille de Noël Rosse s’en alla elle aussi ; Dumesnil-Ambert en fit part à la Cour le 15 novembre : « Hors d’état de vivre dans la colonie, il passe en France pour se rendre à l’Isle de France où il a des parents dans l’opulence qui l’appellent auprès d’eux ; cette famille appartient aux plus notables habitants » ; à la même époque, Laurent Sire et Ambroise Hébert passèrent pour les mêmes raisons au Canada ; ces trois familles comptaient en tout dix- neuf membres [39].
On voit donc combien la population de la colonie était peu stable et difficile à recenser avec exactitude. Tandis que certains partaient, d’autres venaient les remplacer ; ces allées et venues se produisaient au cours d’extraordinaires périples. Bourde de la Rogerie cite le cas d’Augustin Benoît. « Né en Acadie, il céda aux conseils des officiers de Louisbourg et des missionnaires et émigra vers 1750 à l’île Saint- Jean où il se fit pêcheur. Il fut déporté en France en 1759, pendant que ses parents d’ Acadie étaient dispersés dans le Massachusetts ; en 1763, il partit de Saint-Malo pour les îles Falkland ou Malouines, avec sa femme, son fils et sa belle-sœur. La colonie des Malouines ne réussit pas mieux que le Kourou. Elle fut abandonnée le 1er avril 1767. Les colons français, parmi lesquels se trouvaient des compatriotes de Benoît, furent transportés à Montevideo où ils furent embarqués cinq mois plus tard pour Cadix, en compagnie de 250 jésuites, chassés des colonies espagnoles. Benoît revint péniblement et lentement à Saint-Malo ; en 1775, il fut transporté sur sa demande à Saint-Pierre et Miquelon avec sa famille qui s’était accrue de quelques enfants depuis 1767 et comptait dix personnes. Trois ans plus tard, en 1778, il fut expédié en France par les Anglais, avec tous les habitants de la colonie [40]. »
Comment, dans ces conditions, tenter de rendre un compte exact de la population ? Il convient d’abord de distinguer deux grandes catégories d’habitants : les sédentaires et les hivernants. La première catégorie comprenait les anciens colons de Louisbourg, installés à Saint-Pierre, qui avaient déjà exercé le commerce maritime à l’ Ile-Royale d’abord, en France ensuite, après leur rapatriement ; les plus notables, les Rodrigue, les Dupleix- Sylvain, les Loyer- Deslandes, connaissaient assez bien la situation commerciale en Amérique du Nord et en France pour espérer refaire leur fortune détruite. A Miquelon, au contraire, nous avons vu se réfugier les anciens laboureurs évadés de la Nouvelle-Angleterre ; ils tentèrent de tirer le meilleur parti des maigres pâturages et du pauvre sol de l’île, tout en s’exerçant à la pêche.
La seconde catégorie d’habitants se composait de jeunes gens, originaires des régions maritimes de la métropole, particulièrement de Bretagne et du Pays Basque ; mi-marins, mi- cultivateurs, ils passaient sur les bâtiments pêcheurs de Saint – Malo et de Bayonne et trouvaient du travail dans la colonie pendant un an ou deux. Les jeunes filles étaient employées comme domestiques ; la plupart des garçons étaient engagés pour sécher la morue sur les graves ; on les appelait « les garçons de graves ». Pourtant, quelques-uns travaillaient pour leur propre compte ; ils louaient une chaloupe, une partie de grave et traitaient leur propre poisson. Pour éviter les frais de passage en France, à la fin de la saison, tous ces pêcheurs hivernaient dans la colonie, aux frais des habitants qui les employaient pour la pêche d’automne. Ces hivernants ou passagers se mariaient parfois dans la colonie avec les jeunes domestiques venues de France elles aussi ; mais en général, bien peu s’installaient définitivement à Saint-Pierre et Miquelon ; après deux ou trois ans, ils revenaient en Europe.
A ces deux grandes catégories, les habitants sédentaires et les habitants hivernants, venaient s’ajouter au printemps et en été, les équipages des navires métropolitains ; ceux-là s’en retournaient en automne, mais durant six mois, de juin à novembre, la population de la colonie s’en trouvait doublée. Pour citer quelques chiffres, le recensement fait, en 1776, par le baron de l’Espérance, indique pour Saint-Pierre 1.208 personnes dont 604 habitants sédentaires et 604 hivernants ; pour Miquelon, 776 personnes, dont 649 sédentaires et 127 passagers ; au total donc, 1.253 résidents qui, ajoutés aux 731 hivernants formaient une population de 1.984 personnes [41]. Mais, durant la saison de pêche, il fallait bien compter sur 2.500 à 3.000 habitants. En 1778, lors de la prise de la colonie par les Anglais, il y avait, à Saint-Pierre seulement, 1.048 dont 112 hommes, 114 femmes, 166 filles, 243 garçons, 344 pêcheurs et 69 domestiques [42]. En 1783, lorsque la Cour eut fait savoir aux exilés qu’ils pourraient retourner dans la colonie, les demandes de retour se montèrent à 1.244 personnes, dont 717 à La Rochelle, 420 à Saint-Malo, 26 à Lorient, 23 à Nantes, 27 à Cherbourg, 8 à Granville, 21 à Bayonne [43]. En 1784, la population, en y comprenant seulement les habitants résidents, comptait à Saint-Pierre 763 personnes (116 hommes, 139 femmes, 200 filles, 257 garçons, 51 domestiques), à Mique- lon 432 personnes (63 hommes, 72 femmes, 138 filles, 159 ; au total 1.195 résidents [44]. En 1785, Danseville signalait 633 habitants et 323 matelots passagers à Saint-Pierre [45]. Enfin, en 1793, les Anglais envoyèrent à Halifax les officiers d’administration, la troupe et les marins non résidents, au nombre de 607 personnes [46] ; quelques mois plus tard, en 1794, la population sédentaire, comprenant 1.502 habitants, fut évacuée à son tour en Nouvelle-Ecosse d’où elle fut rapatriée en France [47]. En définitive, pour autant qu’on puisse en juger d’après ces chiffres, qui varient sensiblement d’une année à l’autre, il y. eut en moyenne, dans la colonie, de 1.000 à 1.500 résidents ; les matelots passagers faisaient augmenter la population jusqu’à environ 2.000 habitants et, l’été, la présence des équipages de pêche la faisaient atteindre 2.500 à 3.000 personnes qui animaient de leurs travaux et de leurs coutumes les petites et lointaines îles, dernier vestige des immenses territoires que la France avait possédés en Amérique du Nord.
2. — Le préfet apostolique et l’état-civil.
Ces indications quantitatives nous donnent bien une idée du mouvement de la population des îles Saint-Pierre et Miquelon. Mais quelle était la vie des habitants, dans la colonie même, lorsqu’ils avaient enfin, entre deux exils, la possibilité de se bâtir une maison, de se marier, d’avoir des enfants et d’enterrer leurs morts dans un lieu qui ne leur fût pas trop étranger ? L’administration civile de la colonie s’efforçait de leur assurer la paisible jouissance de leurs biens matériels, mais les Acadiens se souciaient aussi beaucoup d’observer leurs traditions religieuses.
En 1763, Dangeao avait amené avec lui deux aumôniers, deux anciens jésuites, les P. de Bonnecamps et Ardillier ; il les avait probablement recrutés à Rochefort, et les deux aumôniers disposaient de pouvoirs conférés par l’évêque de La Rochelle [48]. Pendant plusieurs années, Bonnecamps à Saint- Pierre et Ardillier à Miquelon assurèrent toutes les fonctions curiales dans la colonie. Cependant leur situation n’était pas claire ; les pouvoirs dont ils étaient munis ne leur avaient été conférés, en fait, que pour la traversée ; en outre, Saint- Pierre et Miquelon dépendaient toujours de l’évêque de Québec [49]. Le Canada devenu territoire britannique, il convenait de détacher nos îles du vaste diocèse canadien. Mais un simple curé ne pouvait assumer toutes les responsabilités spirituelles d’un territoire si éloigné de tout diocèse français et la Cour de Versailles désirait en outre retirer des colonies tous les missionnaires réguliers, de quelqu’ordre qu’ils fussent, pour leur substituer des prêtres séculiers. La solution consistait à les ériger en préfectures apostoliques, soumises directement au Saint-Siège, bien que par une déclaration royale du 31 juillet 1763, les préfets et vice-préfets apostoliques fussent obligés de faire enregistrer leurs pouvoirs par les Conseils supérieurs [50]. A Paris, depuis 1730, l’abbé de l’Isle-Dieu, Pierre de la Rue, portait le titre d’Aumônier Général des Colonies de la ; c’était donc à lui que revenait le soin d’examiner la situation particulière des îles Saint-Pierre et Miquelon. Il entreprit des démarches auprès de la Sacrée Congrégation de la Propagande et obtint en 1765 les titres de préfet et vice- préfet apostolique pour deux Spiritains : les abbés Julien- François Becquet et Jean-Baptiste Paradis ; les îles Saint- Pierre et Miquelon furent ainsi le premier territoire confié à la congrégation du Saint-Esprit par le gouvernement français, d’accord avec la Sacrée Congrégation de la Propagande. Les deux Spiritains s’embarquèrent à Rochefort le 28 avril 1767 et remplacèrent les deux aumôniers Bonnecamps et Ardillier au mois de septembre ; un bref du Pape Clément XIII, en mars 1767, avait régularisé les actes de leur ministère [51]. Becquet, en tant que préfet apostolique, s’installa à Saint-Pierre, et Paradis, vice-préfet, s’en fut à Miquelon. Dès 1773, Becquet, fatigué, parla de demander son rappel ; le baron de l’Espérance, au nom des habitants de Saint-Pierre, demanda à l’abbé de l’Isle-Dieu de s’opposer à ce départ et, pour soulager le préfet apostolique, d’envoyer un troisième prêtre dans la colonie [52]. L’abbé de l’Isle-Dieu transmit cette demande au secrétaire d’État de la Marine qui, en 1775, seulement décida d’envoyer le Spiritain Bouguet [53]. Le préfet apostolique, lorsqu’il vit arriver ce nouvel abbé, jugea qu’il pouvait donner sa démission ; toutefois, il demeura à Saint- Pierre car l’abbé Bouguet faisait bien fonction de curé, mais ne disposait pas des pouvoirs de préfet apostolique. En 1778, lors de la prise de l’île par les Anglais, les trois prêtres furent évidemment obligés de revenir en France. En 1783, l’abbé Paradis fut désigné comme préfet apostolique, assisté de l’abbé Longueville, prêtre du diocèse de Coutances, comme vice-préfet [54]. Paradis, si l’on en juge d’après la rédaction des actes d’état-civil, semble bien n’avoir pas disposé de toutes ses facultés intellectuelles ; le ministre écrivait d’ailleurs, le 31 mars 1786 : « Mr. le baron de l’Espérance et Mr. Danseville se sont réunis pour m’assurer que le sieur Paradis n’étoit plus en état de remplir les fonctions de Préfet Apostolique aux isles Saint-Pierre et Miquelon. Le Roi a décidé qu’il repasseroit cette année en France. » [55] II fallut un ordre de Mr. de Barbazan commandant la station pour que Paradis consentît à se démettre de ses fonctions [56]. Le 15 novembre 1786, il donc. Longueville reçut les pouvoirs de préfet tandis que l’abbé Jean-Baptiste Allam passait curé à Miquelon [57]. L’année suivante, l’abbé François Le Jamtel de la Blouterie vint à Saint-Pierre en qualité de vicaire de Longueville [58]. En 1792, ces deux derniers, Allain et Le Jamtel, refusant de prêter le serment constitutionnel, décidèrent de s’expatrier ; de nombreux Miquelonais les suivirent aux îles de la Madeleine. Le préfet Longueville demeura dans la colonie pour assurer malgré tout le service divin jusqu’au nouvel exil de 1793 [59].
Tel fut donc le personnel ecclésiastique des îles. Comme il n’y avait pas de Conseil Supérieur dans la colonie, les pouvoirs apostoliques, renouvelés en 1773, par des brefs de la Sacrée Congrégation, furent enregistrés au greffe de l’Amirauté [60]. Le roi accordait une pension annuelle de 900 livres au préfet et de 800 livres au vice-préfet [61]. Dès 1767, l’abbé de l’Isle-Dieu rappela au ministre que les missionnaires de l’ Ile-Royale « avaient un petit droit de dîme par forme d’offrande ou d’obla- tion » et demanda que ce droit fut attribué à ceux de Saint-Pierre et Miquelon. En fait, ces offrandes des fidèles ne pas un droit mais un don volontaire ; le gouvernement s’était toujours refusé à les transformer en droit de dîme et ne le permit pas plus pour Saint-Pierre et Miquelon [62]. Il accorda cependant, sur la demande de l’abbé de l’Isle-Dieu, une ration gratuite à chacun des deux ecclésiastiques et une autre pour leur domestique [63]. En 1774, ils réclamèrent cependant de nouveaux secours prétextant la modicité de leur traitement et leurs frais d’entretien excessifs [64]. Le 27 février 1775, le ministre informa le gouverneur que, « quoiqu’il n’y ait point de titre qui établisse aux îles Saint-Pierre et Miquelon la dixme sur la pesche de la morue, elle me paroit nécessaire pour fournir aux missionnaires les moyens de subsister et de secourir les pauvres ; j’approuve que vous ayez contraint les armateurs de Saint-Malo qui vouloient s’y soustraire. Vous maintiendrez cet usage jusqu’à nouvel ordre. » [65] En 1783, lors de la reprise des îles, le préfet et le vice-préfet apostolique se virent chacun 1.200 livres de traitement annuel, auquel s’ajoutait environ 3.500 livres d’offrandes volontaires, ainsi que nous l’apprend un mémoire de Longueville et Allain qui protestait en 1792 contre la suppression de la « dîme » [66]. Chaque paroisse disposait de son église. Les premières années, ce furent seulement deux modestes chapelles dont le roi fournissait le mobilier [67]. A Miquelon, l’abbé Ardillier fit construire une église à ses frais, pour 978 livres [68] ; et il la dédia à Notre-Dame des Ardilliers, du nom d’un sanctuaire jadis célèbre de la ville de Saumur [69] ; trop peu solide, il fallut la rebâtir en 1775 [70]. Le 26 juin 1774, le préfet apostolique Becquet procéda, dans l’église de Saint-Pierre, à la d’une cloche « nommée au nom du Roy, sous l’invocation des SSts Louis et Pierre, par MM. le Gouverneur Charles Gabriel Sébastien, baron de l’Espérance, chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, et Alexandre-René Beau- déduit, conseiller honoraire du roy, ordonnateur, en présence de tous les différents corps. Le même jour, demande nous fut faite des prières de quarante heures par MM. les Gouverneur et Ordonnateur, accompagnés de tous les corps, pour la de Sa Majesté dangereusement malade. » [71] En 1778, les Anglais permirent à l’abbé Bouguet d’emporter le mobilier de son église avec lui, à l’exception des trois cloches, qu’ils s’attribuèrent ; l’inventaire de ce mobilier révèle que la paroisse de Saint-Pierre n’était pas trop dépourvue [72]. En 1783, Bernard Lafitte, qui devait reconstruire tous les officiels de la colonie, fut également chargé de bâtir une église et un presbytère à Saint-Pierre et à Miquelon [73] ; en outre en 1788 une petite chapelle fut construite sur l’île aux Chiens [74].
Le préfet apostolique disposait d’un petit personnel auxiliaire. Ainsi, en 1769, Dangeac demanda-t-il au ministre d’accorder une ration gratuite « au nommé Tabou, chantre de cette église et qui, en outre, tient une école pour l’éducation de la jeunesse. » [75] En 1784, Longueville fait mention, dans un acte, de Séverin-Martin Barthe « notre maître-garçon d’église » [76]. Les demoiselles de la colonie pouvaient aussi acquérir un minimum d’instruction auprès d’une maîtresse d’école, Jeanne Le Moine, Vve Loustalet, mentionnée dans le recensement de 1785 [77]. Mais, l’éducation des jeunes gens dut laisser beaucoup à désirer, car dans son mémoire à l’Assemblée Nationale en 1790, Loyer- Deslandes réclamait la nomination d’un professeur de mathématiques et d’astronomie [78]. Un autre mémoire, beaucoup plus tardif, vers 1803, adressé par un certain Goueslard, « déporté des îles Saint-Pierre et Miquelon », au ministre Decrès, que l’on établit dans la colonie renaissante, un professeur d’hydrographie, car, disait-il, « il ne s’est jamais trouvé d’habitant qui fût capable de commander pour les voyages aux Antilles » ; il réclamait également l’établissement d’une école primaire dans chacune des îles, avec une petite bibliothèque publique de 1.200 à 1.500 volumes ; faute d’instruction, révélait-t-il encore, « il n’y avait que deux hommes dans la colonie qui, par un procédé très long, pussent parvenir à faire une règle de compagnie de la vente des huiles proportionnellement aux nombres de 40, 36 et 32, suivant l’usage établi depuis très longtemps dans le Nord ». A vrai dire, ce partage du de la vente des huiles, entre les membres de l’équipage, était fort compliqué. Le même personnage déclarait encore que l’entretien de trois prêtres dans la colonie et la construction d’une église dans chaque île était une nécessité, « car les habitants sont en général très attachés à la religion catholique ; sinon, une grande partie de la population ira s’établir sur les côtes des isles anglaises voisines où le gouvernement anglais autorise le culte catholique ». Enfin, dernière révélation intéressante, Goueslard écrivait, à propos du divorce, « il existe peu de pays où il se trouve autant de sources de divorces. L’impossibilité où l’on est de se livrer au travail pendant l’hiver force les habitants à se livrer fréquemment à des divertissements ; la quantité de jeunes européens qui y passent l’hiver peut concourir à engendrer des troubles dans les familles et les conduire au divorce ; le gouvernement doit prendre mesures les plus sévères pour empêcher que l’on n’abuse de la loi » [79]. Les craintes de notre informateur étaient certainement exagérées. Il régnait dans les îles Saint-Pierre et Miquelon « des mœurs plus rigides que dans la plupart des agglomérations maritimes », selon la remarque de Bourde de la Rogerie [80] ; mais, si cet auteur mentionne comme unique l’expulsion, prononcée par Dangeac le 21 octobre 1769, d’une jeune servante coupable d’avoir « produit un fruit précoce » [81], nous avons, pour notre part, au hasard des registres de l’État- civil, relevé une dizaine d’autres exemples d’accidents de ce genre, nombre tout à fait minime d’ailleurs et qui n’enlève rien à l’appréciation précédente. L’examen des registres paroissiaux de Saint-Pierre et de Miquelon permet tout de même de faire des constatations plus intéressantes. Les archives coloniales ont conservé ces registres [82] ; pour Saint-Pierre, ils couvrent la période 1763 à 1791, avec une lacune de 1776 à 1782 ; pour Miquelon, ils vont de 1763 à 1789, avec des lacunes en 1772, 1776 et pour la période 1779 à 1783. Dans la limite de ces dates et en tenant compte de ces lacunes, 1.303 actes furent inscrits sur les registres de Saint-Pierre et 664 sur ceux de Miquelon ; nous avons relevé pour Saint-Pierre, 679 baptêmes, 451 sépultures et 120 mariages. Nous ne pouvons malheureusement tirer de ces chiffres aucune conclusion précise, étant donné que les deux séries de registres présentent entre elles de notables différences dans leur durée, et même dans leurs lacunes. Toutefois si l’on compare le nombre des sépultures et celui des baptêmes de Saint-Pierre avec les chiffres correspondants de Miquelon, on constate une différence anormale : à Saint-Pierre, 451 sépultures pour 679 baptêmes, à Miquelon 130 sépultures seulement pour 414 baptêmes. La mortalité à Saint-Pierre était plus grande, à cause des accidents, noyades, naufrages et maladies qui affectaient les équipages des navires métropolitains ; plus de la moitié des actes de sépultures, inscrits sur les registres de Saint-Pierre, mentionnent pour les défunts une origine bretonne, basque ou normande. De même les hivernants, qui se trouvaient à Saint-Pierre beaucoup plus nombreux qu’à Miquelon, et les soldats de la garnison forment plus du tiers des jeunes mariés ; de ces nouveaux ménages, assez peu d’ailleurs dans la colonie. A Miquelon, au contraire, la population était beaucoup plus homogène ; tous ces Acadiens vivaient dans un certain isolement, étaient tous plus ou moins parents [83] et n’engageaient que le moins possible de matelots métropolitains.
Lorsqu’ils arrivèrent dans la colonie, les Acadiens n’avaient pu s’assurer les services d’un prêtre catholique depuis plusieurs années. Aussi le curé de Saint-Pierre eut-il à régulariser bien des situations anormales. Il conféra d’abord « les cérémonies du baptême » aux nombreux enfants nés dans les colonies anglaises. En 1763, il y eut 30 de ces « baptêmes suppléés pour cause de détention en Angleterre » à des enfants nés à Roxbury, Stolon, Boston, Tinten, Daxmas, Nidem, Dactister, Serten, Charlestown, Savannah, Querretcouq, et qui portaient les noms de Hébert, Vigneau, Le Blanc et Sire ; Anastasie Hébert la plus âgée était née en avril 1756 à Charlestown. Les années suivantes, du 8 juillet 1764 au 9 juin 1766, 70 autres baptêmes furent conférés à des enfants nés à Chedabouctou, la pointe de Beauséjour, l’île Saint-Jean, Beaubassin, Louis- bourg, Halifax, Chipagan et Miramichi.
Le curé de Miquelon eut à enregistrer des actes plus sincères. Fautes de prêtres, plusieurs jeunes gens s’étaient mariés par simple consentement mutuel, en présence de témoins et en promettant de se présenter devant un prêtre catholique aussitôt que les circonstances le permettraient. Ces mariages étaient parfaitement valides du point de vue canonique et l’abbé Ardillier se contenta de les enregistrer en accompagnant cette formalité de la cérémonie liturgique et des prières usuelles. Voici, par exemple, le premier de ces actes, rédigé le 16 octobre 1763 : « Le 22 février 1762, Joseph Sirs, fils légitime de Jean Sirs et de Anne Bourgeoy, et Josèphe Hébert, fille légitime de Jacques et de Anne Arsenau, étant détenus prisonniers en Angleterre et ne voyant aucun jour à être délivrés se sont unis ensemble par les liens du mariage, tant du consentement de leurs parents respectifs qu’en présence de témoins dignes de foy, avec promesse de se présenter en face de l’Eglise, aussitôt que faire se pourroit ; ce qu’ils ont véritablement accompli à Miquelon où je, soussigné, prêtre, aumônier du roy et curé de la paroisse de Notre-Dame des Ardilliers de l’île de Miquelon, ay fait à leur égard toutes les prières et cérémonies de l’Église catholique, apostolique et romaine, par parole de présent, en présence de Messire Charles, Gabriel,. Sébastien, baron de l’Espérance, commandant de l’île de Miquelon et Paul Sirs oncle de l’épouse. » On voit donc que l’abbé Ardillier se garda bien de donner aux couples qui se présentèrent une bénédiction nuptiale qui aurait laissé planer un doute sur la moralité des époux et sur la légitimité de leurs enfants [84]. Nous avons relevé vingt actes de ce genre, datés du 16 octobre 1763 au 22 juin 1766 ; trois d’entre eux contiennent une mention plus singulière encore : Le 1er juin 1766,. l’abbé Ardillier enregistra les déclarations de Charles Gautreau et de Françoise Bourg « déjà légitimement mariés par Joseph Guégen, le 4 septembre 1762 » ; celles de Paul Hébert et de Marguerite Arsenau « déjà légitimement mariés par Jean Terriau, le 23 juillet 1763 » et celles de Joseph Gaudet et de Marie Blanchebourg « déjà légitimement mariés par Joseph Guégen, le 2 août 1763 ». Ces deux hommes, Joseph Guégen et Jean Terriau, étaient de simples laïcs ; mais Bourde de la Rogerie a remarqué que Guégen, né à Morlaix en 1741,. avait voulu se destiner au sacerdoce et avait fait quelques études sous la direction d’un prêtre breton, l’abbé Manachr missionnaire en Acadie. Terriau devait être dans le même cas [85]. Aux yeux des Acadiens, ces deux hommes, par leur formation, étaient auréolés d’un certain prestige ecclésiastique et, en l’absence de tout prêtre, revêtus de certains pouvoirs canoniques. Le curé de Miquelon, là non plus, n’émit aucun doute sur la légitimité de la cérémonie. Après 1767, il n’y eut plus d’exemples de ces mariages civils dans les actes d’État-Civil de la Colonie. Mais en 1773, le 18 octobre, le préfet apostolique Becquet eut à régulariser une situation assez différente des précédentes, car les mariés avaient été conjoints par un ministre protestant ; le 18 février 1761, en effet, Dominique Lissabe, originaire de la paroisse de Bardos, diocèse de Bayonne, et prisonnier en Angleterre, avait épousé Anne Armstrong de la paroisse de Brampton, duché de Cumberland, « en présence de Guillaume Towton, ministre de la paroisse de Brampton » ; de ce mariage, ils avaient six enfants ; mais les deux conjoints,. « de retour en France, pour obvier à tous les inconvénients qui pourroient résulter de leur mariage, vu qu’il n’a pas été célébré en face de la Sainte Église Catholique, Apostolique et Romaine, et suivant les lois du Royaume, pour qu’il ne soit fait à leurs enfants aucunes difficultés soit sur le droit légitime, soit sur celui des successions qui pourroient leur écheoir, se sont présentés devant nous pour revêtir leur mariage des formalités nécessaires ; en conséquence, après leur avoir accordé la dispense des trois bans, nous leur avons donné la bénédiction nuptiale. »
3. — Irlandais et Micmacs.
Le préfet apostolique de Saint-Pierre assura les offices de son ministère à deux catégories particulières de fidèles : les Irlandais et les sauvages micmacs. La colonie anglaise de Terre-Neuve comptait en effet de nombreux Irlandais, qui n’avaient pas toujours entretenu avec leurs compatriotes des relations très cordiales. Un rapport anglais écrit par le capitaine d’artillerie William Griffith le 24 février 1766 et parvenu à la connaissance des autorités françaises, rappelait qu’après la paix d’Aix-la-Chapelle « un grand nombre d’Irlan- dois catholiques étoient attachés aux habitants comme domestiques ; ils se livrèrent à un grand nombre d’excès (vols, insultes aux magistrats, le chief Justice fut même assassiné). Un grand nombre d’habitants abandonna l’isle ; les Irlandois catholiques d’Irlande y abondèrent. Quand les François de Terre-Neuve, les Irlandois y étoient six fois plus nombreux que les Anglois. » [86] Depuis cette époque, la proportion s’était rétablie en faveur des Anglais et les Irlandais catholiques souffraient dans la grande île d’une situation misérable. Lorsque la frégate du roi La Licorne, commandée par Tronjoly, vint, au début de juin 1763, prendre possession des îles Saint-Pierre et Miquelon, parmi les habitants britanniques qui les occupaient encore, se trouvaient quelques Irlandais ; ils furent très heureux de recourir au ministère du Père augustin, Gaspard Hoser, religieux du couvent de Metz et aumônier de la frégate. Le 13 juin, il baptisa Patrice et Hélène Wualel, enfants de Richard Wualel, originaire de « Wualefort » en Irlande, et de son épouse Elisabeth Cœur, de Londres, et Catherine Penny, fille de Guillaume Penny, de Milbon en et de son épouse Marguerite Burk, de Corken en Irlande. Quelques mois plus tard, l’abbé Bonnecamps baptisa, le 2 octobre 1763, Marie Penny, âgée d’un an et trois mois, fille des précédents ; les parrain et marraine étaient eux-mêmes Irlandais : Thomas Corbin et Angélique Protace. Par la suite, des cérémonies semblables se renouvelèrent. Le 29 octobre 1767 Denis Kenslei, âgé de 21 ans, Marguerite Penny, âgée d’un an et Elisabeth Kinchelli, âgée de 18 ans, furent baptisés. En 1770, un jeune couple vint trouver le préfet apostolique Becquet. Il était formé par Guillaume Pour, âgé de 27 ans et Françoise Jeanne Thébault, âgée de 23 ans, tous les deux du diocèse de Québec, mais demeurant à Saint-Laurent en Terre-Neuve ; ils amenaient avec eux leurs deux enfants, Guillaume, âgé de 4 ans et Marie-Catherine, âgée d’un an ; Becquet baptisa les deux enfants puis, écrit-il, « nous avons légitimé les deux enfants que les deux ci-devant conjoints ont eu avant leur mariage, ne leur ayant point été possible de trouver de prestre qui ait baptisé Françoise- Jeanne Thébeau, la disparité du culte ne leur ayant point permis de contracter mariage ; nous avons baptisé la future et les avons mariés en nous servant des pouvoirs accordés par le Saint-Siège aux préfets apostoliques au nombre desquels nous sommes. » Les difficultés canoniques que Becquet résolvait avec assez de clarté constituèrent pour Paradis, nommé préfet apostolique en 1783, de redoutables complications [87] ; ainsi, au mois de novembre de cette même année, une petite troupe d’Irlandais vint solliciter les services de son ministère. Le 17, il baptisa sous condition Guillaume-Laurent Migra, âgé de deux ans et demi, né à Saint-Laurent de Terre-Neuve et fils de Michel Migra et de Marie Séné, « depuis douze ans unis civilement » ; le 19, « a reçu les cérémonies du baptême et a été baptisé sous condition, Joseph ou pour mieux dire Josette, âgée de … (nous l’ignorons et nous ignorons aussi les noms des père et mère anglois), laquelle hic et nunc passagère en cette isle Saint- Pierre : lequel baptême conferré en la salle du gouvernement actuel, laquelle servant de présent et tenant lieu d’église, eu égard aux circonstances présentes » ; le même jour, il conféra également le baptême sous condition à Hélène et Anne- Charlotte Migra, âgées de 8 et 6 ans ; enfin, le 21 novembre, Marie Séné, leur mère, « née au Martyre ou à la Martyre en Terre-Neuve, âgée de 28 ans, çà et là éparse en Terre-Neuve, passagère en cette colonie pour peu de jours », fut baptisée, sous conditions encore, et quelques moments après, si l’on en croit l’acte rédigé par le préfet Paradis, « n’y ayant aucun empêchement canonique, du moins parvenu à notre connoissance ; la publication des trois bans ne nous ayant point paru requise ni possible et d’ailleurs leur dispense concédée de nous en vertu de nos pouvoirs apostoliques et pour raisons graves, je soussigné, vice-pro-préfet apostolique des isles Saint-Pierre et Miquelon, de présent désigné et réputé préfet apostolique des susdites mêmes isles, faisant fonction curiale, ayant interrogé dans la salle du gouvernement… servant momentanément hic et nunc pour la célébration du service divin, eu égard à la position du lieu et aux circonstances de la colonie renaissante, Michel Migra, baptisé à Oualesfor en Irlande, âgé de trente- neuf ans, anglois, d’une part et Marie Séné, née au Martyre (ou à la Martyre) en Terre-Neuve ci-proche, laquelle âgée de 28 ans et baptisée par nous-mêmes jour et an que dessus, de l’autre part, et angloise : nous ignorons les noms de leurs pères et mères et s’ils existent et où, et lesquels unis en mariage depuis douze ans, çà et là épars en Terre- Neuve, de présent momentanément passagers en nostre isle Saint-Pierre, après avoir reçu leur mutuel consentement, les ay conjoints par paroles de présent en mariage… Ont été témoins, du côté des deux parties contractantes un nombre d’Irlandois qui se sont retirés précipitamment après la célébration de ce mariage et dont nous n’avons pu nous procurer les noms. » Pour simplifier la situation, l’abbé Paradis baptisa après la cérémonie l’aîné de leur fils, Rémy Migra, âgé de dix ans. On voit combien le pauvre abbé était dépassé par la des situations qu’il devait régulariser. Il y eut, jusqu’à la seconde évacuation de la colonie en 1793 environ 40 autres baptêmes d’enfants nés d’Irlandais établis à Terre-Neuve. Une autre catégorie de fidèles causa à l’abbé Paradis de grosses difficultés pour la rédaction de ses actes d’état-civil : ce furent les sauvages micmacs. Le gouverneur de Plaisance les avait fait venir, plus de cinquante ans pour l’aider dans sa lutte contre les Anglais de Saint- Jean ; les micmacs avaient accompli leur tâche, avec quelque férocité et avaient pris, à cette époque, leurs quartiers d’hiver sur l’île Saint-Pierre. Le départ des Français de Plaisance les avait mis vis-à-vis des Anglais en état d’infériorité et désormais ils menaient une vie errante et misérable. Pourtant leur fidélité envers le roi de France n’avait pas été ébranlée ni leur catholicisme. Les autorités britanniques craignaient beaucoup l’attachement des sauvages à la cause française et la Cour de Versailles, il faut bien l’avouer, se souciait peu assez de leur existence maintenant qu’elle n’avait plus besoin de leur aide. Les instructions rédigées par Choiseul pour Dan- geac, le 23 février 1763, marquaient bien qu’ « à l’égard des sauvages canadiens de l’Isle-Royale et l’Acadie, Sa Majesté lui défend d’en recevoir aucun, leur apparition à Saint-Pierre et Miquelon ne pouvant qu’être désagréable aux Anglois et aussi dispendieuse qu’inutile aux François. » [88] Les de la colonie, Dangeac comme le baron de l’Espérance, n’appliquèrent pas cet ordre à la lettre ; ils accueillirent le mieux possible les pauvres représentants des tribus jadis florissantes et qui devaient pour une bonne part leur misère à leur sympathie pour les Français. Le 24 décembre 1765, le baron de l’Espérance signalait l’arrivée à Miquelon d’une chaloupe de sauvages micmacs venant de Terre-Neuve lui demander des secours en vivres et se plaignant en outre d’avoir été par les Anglais « à cause qu’ils se sont approchés des François » ; les vents contraires les forcèrent à demeurer quinze jours dans l’île. [89] En septembre 1769, il reçut à nouveau la visite « d’une chaloupe de sauvages mich-mach, sous prétexte de demander des nouvelles de la santé du Roy et pour qu’ils étoient toujours fort attachés. » [90] En 1777, une famille de sauvages de l’ Ile-Royale, composée de sept personnes, n’hésita pas à faire la traversée en chaloupe ; « l’objet de leur voyage, écrivait le baron de l’Espérance, a été de s’informer de la santé du Roy de France, leur Père, sous la domination duquel ils désirent retourner ; cette famille, pendant son séjour, a donné des preuves de catholicité. » [91] L’année suivante, M. de la Boucherie, qui commandait à Miquelon, accueillit 21 sauvages et sauvagesses venus « pour devoir de religion » ; le gouverneur lui ordonna de ne les garder que le moins possible pour ne pas encourir les reproches des Anglais [92]. En 1784, la situation était très différente ; les Anglais n’avaient plus aucun droit de regard sur nos îles. Aussi le baron de l’Espérance reçut-il avec bienveillance une délégation de sauvages venus de l’Ile-Royale ; ils avaient débarqué au mois d’août, au nombre de 80, hommes, femmes et enfants, sur l’île de Miquelon. « Leur projet, raconte le gouverneur, étoit de se rendre ensuite tous ici, mais ils n’ont pu l’effectuer parce qu’ils ont été informés qu’il y avoit plusieurs enfants attaqués de la petite vérole ; comme ils redoutent beaucoup cette ils se sont déterminés à en détacher quinze dont douze femmes et trois hommes. On a eu soin d’eux tant ici qu’à Miquelon et, après un séjour de trois semaines, ils sont partis fort contents avec des présents ; ils ont ajouté que pour témoigner de plus en plus leur attachement pour la France, ils se proposaient d’aller s’établir à la baye de Désespoir afin d’être plus à portée de venir nous voir plus souvent. » [93] Le gouvernement avait, en effet, bien fait les choses ; outre un festin qui coûta 40 livres au trésor royal, il leur offrit en guise de présents, 18 vieux fusils, 100 pierres à fusil, 100 livres de poudre à canon, 200 livres de plomb à giboyer, 10 quarts de farine de 180 livres l’un, 100 livres de tabac en feuille, 6 petites haches, des cordages, de la toile à voile, du brai, des clous, des compas, du beurre, de la mélasse et du pain frais [94].
Le souci de se ravitailler, tout en renouvelant leur fidélité au roi de France, ne constituait pas le seul motif qui amenait les micmacs à Saint-Pierre et Miquelon. Ils profitaient chaque fois de leur visite pour accomplir leurs dévotions et recevoir les sacrements [95]. Nous avons compté 22 baptêmes, 6 mariages et 3 sépultures concernant les micmacs. L’abbé Paradis, dont nous avons déjà eu l’occasion de remarquer les singularités d’écriture, éprouvait les plus grandes difficultés pour rédiger ces actes. A titre d’exemple, voici un acte de mariage, en date du 26 juillet 1778 : « La dispense des trois bancs obtenue et accordée de nous en vertu de nos pouvoirs apostoliques et pour des raisons graves, ainsi que toute dispense de consanguinité pour en cas de besoin, hormis néanmoins la dispense de consanguinité du premier, ainsi que du second degré ; toute dispense nous en vertu de nos pouvoirs apostoliques (ainsi que nous nous sommes exprimé, parce que nous ne pouvions rien définir de clair d’après ces bonnes gens, sinon qu’il nous a paru que les époux n’étoient point parens ni au premier ni au second degré), je soussigné, préfet apostolique, ayant interrogé Louis… dit Beguiddavalouet, âgé d’environ 27 ans, fils par conséquent majeur de Bernard … dit Beguiddavalouet et de Marie-Anne Gougou son épouse, défunte tout novissime par accident de détachement de pierres, passant sous un cap, en la grande terre de Terre-Neuve, ses père et mère, baptisé au Cap-Breton par feu Monsieur Maillard, ancien missionnaire des sauvages, évêché de Québec, d’une part et Janette Doujet, âgée d’environ 20 ans, fille mineure de Guillaume Doujet et de Marie-Magdeleine Pegilahadeschz son épouse, ses père et mère, baptisée à l’isle Saint-Jean par Monsieur Cassiet, paroisse de Saint-Louis au nord-Est, évêché de Québec, d’autre part ; tous deux actuellement domiciliés aux isles Berjaus en Terre-Neuve et passagers maintenant à l’isle Miquelon ; après avoir reçu leur mutuel consentement, je les ay, vers le milieu de la nuit, vu la nécessité de leur subit départ de Miquelon, solennellement conjoints en mariage par paroles de présent et leur ai ensuite donné la bénédiction nuptiale. Ont été témoins toute la petite troupe des hommes et femmes sauvages et sauvagesses qui estoient venus vers nous pour leurs Pâques et, par amitié, ont bien voulu estre témoins Pépin Pichard, dont je me servois auprès d’eux pour interprète et Germain Pichard son frère, ces deux domiciliés en cette isle. » On doit bien avouer, après cette lecture, que la du texte de l’abbé Paradis ne le cédait en rien à celle des circonstances de la cérémonie. Les trois mentions de sépultures que nous avons relevées dans les registres paroissiaux de la colonie nous ont obligé à nous poser une question assez macabre ; en effet le 21 avril 1785, les sauvages apportèrent avec eux le cadavre d’un certain Jacques, décédé à Terre-Neuve le 15 février précédent ; le 12 septembre de la même année, fut inhumée à Saint-Pierre le cadavre de Marie, veuve d’André, sauvagesse morte à Terre-Neuve, à l’âge de 91 ans, quatre mois auparavant ; enfin l’année suivante, le 6 septembre fut apporté par les sauvages le corps de Anne Etiennchuit, veuve de André Gougou, décédée elle aussi à Terre-Neuve, le 25 mai précédent. Par quel procédé les micmacs parvenaient-ils à conserver si longtemps les cadavres de leurs morts ? Il est probable qu’ils utilisaient une technique semblable à celle des pêcheurs pour la sècherie du poisson et qu’ils conservaient leurs cadavres dans du sel.
Les registres d’état-civil nous apprennent encore la présence aux îles Saint-Pierre et Miquelon de personnages inattendus. Ils mentionnent par exemple cinq sépultures de nègres ; en effet, les capitaines de navires s’attachaient souvent comme domestiques des esclaves de couleur ; le climat rigoureux de la colonie ne devait guère leur convenir. Des Espagnols, engagés parmi les équipages basques, fréquentaient aussi l’île Saint- Pierre, ainsi qu’en témoignent six mentions de décès, dont cinq concernant quatre individus originaires de la paroisse de « Sougharamourdy, évêché d’Eraine », et un cinquième de la paroisse de « Ourdas ». Un Italien « Louis Patroviche, de Rouvigne (Italie) », patron d’une des chaloupes du roi, épousa le 5 septembre 1786, Marie- Joseph Taupic. Un acte indique que « François Thomas, navigateur, âgé de 23 ans, fils d’Antoine et de feue Thérèse Ynapse, de la ville de Fayal (Açores), diocèse de Fayal et résident dans ces isles depuis trois années », épousa le 16 juillet 1787 la jeune Servanne- Julie Allemand, âgée de 16 ans. Quelques Anglais s’étaient établis à Saint- Pierre ; ainsi Joseph Powell et Sara Parker, son épouse, firent baptiser, le 13 juillet 1788, leur fille Marie-Geneviève, née à Boston le 15 mars 1786 ; Joseph Powell était dit « négociant, habitant de ces isles » ; leur seconde fille, Julie- Henriette naquit d’ailleurs à Saint-Pierre le 24 mars 1789. Certains actes demeurent énigmatiques, telle la mention le 22 1784 de l’inhumation de « Pierre Boyer, prêtre, capucin de Toulon-sur-Arroux en Bourgogne, demeurant en cette isle depuis trois mois, venant de la Nouvelle-Angleterre incognito, décédé le 21 octobre. » D’autres, enfin, nous apprennent la destinée singulière de certains Acadiens, telle celle de Pierre Douville, époux de Cynthea Aborn, devenu lieutenant de vausseau des États-Unis et chevalier de l’Ordre de Cincinnatus, dont un fils Charles-Laurent était né à Rhodes- Island le 14 avril 1786 et fut baptisé à Saint-Pierre le 13 juillet 1788, lorsque le lieutenant de vaisseau revint dans la colonie exercer son métier d’armateur [96].
II. — LA CONDITION DES COLONS
Tout au long de l’histoire des îles Saint-Pierre et Miquelon, la Cour de Versailles craignit que leur peuplement ne gênât leur exploitation. Le roi, dans les instructions qu’il remit à Dangeac, le 23 février 1763, lui assignait comme tâche « de commander ceux de ses sujets qui iront s’y établir, les faire vivre suivant les loix et coutumes de son Royaume », mais aussi de « veiller principalement sur tout ce qui concernera la pesche et la sècherie des pescheurs françois dans lesdites isles. » [97] Choiseul, dès le 12 avril, précisa bien quel devait être, dans cette double tâche, le souci principal du gouvernement : « Je sais bien que les isles Saint-Pierre et Miquelon pourront avec le temps devenir un entrepôt assez considérable de commerce ; mais elles ne le peuvent qu’autant que la base de leur établissement qui est la pêche et la sècherie prendra des accroissements et des principes ; il en résulte absolument qu’il ne faut, quant à présent, placer que des pêcheurs et des ouvriers et n’y souffrir aucune bouche inutile. » [98] Nous avons vu que cette recommandation visait les Acadiens ; le ministre craignait en effet que ces laboureurs, incapables de s’adapter à l’unique industrie de la colonie, la pêche et le séchage de la morue, ne fussent une charge pour l’État, tandis qu’au il plaçait toute sa confiance dans le talent des réfugiés des îles Royale et Saint- Jean, déjà accoutumés au commerce maritime. Si ce n’était simplifier à l’extrême les termes du problème, on pourrait dire que le gouvernement français faire des îles Saint-Pierre et Miquelon une colonie d’exploitation plus qu’une colonie de peuplement. Comment ce dessein fut-il réalisé ? L’exploitation de la seule ressource des îles, la pêche, fut réalisée en collaboration par les colons et les négociants métropolitains. Mais les habitants de Saint-Pierre et ceux de Miquelon n’employèrent pas les mêmes méthodes et en outre la collaboration avec les armateurs des ports de France n’alla pas toujours sans difficultés.
1. — Les notables.
Les réfugiés des îles Royale et Saint- Jean s’étaient empressés en 1763 de gagner Saint-Pierre où ils espéraient mettre à profit leur expérience du commerce de l’Amérique du Nord. Autour des gouverneurs successifs Dangeac et le baron de l’Espérance vinrent se regrouper les anciens habitants de Louisbourg, officiers militaires comme les Le Neuf de Beaubassin, les La Boucherie-Fromenteau, les Poulain de Courval, les de Couagne ; officiers civils comme l’ordonnateur Beaudéduit et le chirurgien Arnoux, ou simplement négociants, comme les Dupleix- Sylvain et les Rodrigue. Or, lorsqu’on étudie la généalogie de ces familles, on découvre entre elles des liens de parenté très étroits. Dangeac était né vers 1708, d’un père militaire qui, en tant que lieutenant du détachement de la marine en garnison au Fort -Louis de Plaisance, avait pris part aux campagnes qui avaient presque chassé les Anglais de Terre-Neuve ; il passa ensuite capitaine dans le même détachement à Louisbourg ; il était marié à Marguerite Bertrand et mourut en 1737 [99]. Leur fils, François-Gabriel, se trouvait en 1723 enseigne en second à l’ Ile-Royale ; enseigne en pied en 1730, lieutenant en 1732, capitaine en 1747, il fit honneur à la croix de chevalier de Saint-Louis qu’il reçut en 1754, en prenant part à la défense de Louisbourg où il fut blessé en 1758 [100].. En 1760, il commanda la dernière colonne de secours envoyée au marquis de Vaudreuil ; dans la baie des Chaleurs, il eut à s’opposer à lord Byron, commandant une escadre de cinq vaisseaux ; « je lui fis si bien trouver du feu partout, qu’il ne remporta rien de cette expédition », raconte Dangeac lui-même [101] ; il fut, en définitive, compris dans la capitulation de Montréal. C’est donc à un vieux et valeureux officier que, dès le 6 janvier 1763, l’on songea comme gouverneur de Saint-Pierre et Miquelon : « On propose à Sa Majesté de nommer pour gouverneur de ces isles, le sieur Dangeac, le plus ancien des capitaines des troupes qui servoient ci-devant à l’isle Royale ». [102] II arriva dans la colonie avec sa nombreuse famille. Veuf d’une canadienne, Mademoiselle Labbé de Bellefeuille, il était accompagné de sa seconde femme, Geneviève Lefebvre et de sept enfants dont cinq filles ; ses deux fils, Dangeac l’aîné et Dangeac de la Loge, étaient respectivement sous-lieutenant et enseigne de la compagnie du baron de l’Espérance mais, en 1769, le fit nommer son fils aîné lieutenant des compagnies d’ouvriers à Saint-Domingue, son second fils devenant lieutenant à Saint-Pierre, remplacé à son grade d’enseigne par Philippe Le Neuf de Beaubassin [103]. Des cinq filles de Dangeac, trois étaient mariées ; Catherine-Françoise avait épousé en 1762 Louis-Benjamin de La Boucherie-Fromenteau, ancien des canonniers-bombardiers de l’Ile-Royale, nommé capitaine en second à Saint-Pierre [104] ; de Marguerite Dangeac de Mer ville et de Charlotte-Marie Dangeac de la Fuye, nous pensons qu’elles devaient être veuves, car les registres d’état civil de la colonie ne parlent jamais de leur mari ; enfin, Marie- Geneviève et Félicité-Charlotte demeuraient célibataires [105]. Dès le 20 novembre 1769, Dangeac marquait à la Cour qu’après 47 ans de services toujours pénibles, 30 ans de commandement, une blessure dans la poitrine au siège de Louisbourg et une santé chancelante, il désirait être rappelé [106]. Pour le faire patienter, Choiseul lui fit connaître, le 20 juin 1770, son au grade de brigadier des armées du roi [107]. Le 23 octobre 1772, Dangeac demanda tout de même sa retraite, à l’âge de 64 ans [108]. Dès le 12 octobre 1770, le baron de avait demandé, au cas où Dangeac serait mis à la retraite, de le remplacer [109] ; sa candidature fut naturellement agréée. Charles-Gabriel Sébastien, baron de l’Espérance, était issu d’une curieuse famille ; son grand-père Léopold-Eberhard de Wurtemberg, prince de Montbéliard, avait courtisé les quatre filles d’un tailleur d’habits de sa bonne ville et l’une d’entre elle lui avait donné un fils qui, arrivé à l’âge de porter les armes, servit au Canada [110] ; le 27 février 1725, ce Léopold- Eberhard, dit encore Charles-Léopold, épousa, à Louisbourg, Marguerite Dangeac, la sœur du futur gouverneur des îles Saint-Pierre et Miquelon [111]. De ce mariage était né, la même année, Charles-Gabriel qui lui aussi devint officier dans les troupes de l’ Ile-Royale. Non content d’être le neveu de Dan- geac, il devint son beau-frère en épousant une autre demoiselle Labbé de Rellefeuille. Veuf, il se remaria en 1755 à Anne-Claire Dupont de Renon, descendante d’officiers canadiens. Sa carrière militaire commencée en 1735 au grade de cadet, l’amena en 1763, avec celui de capitaine, au commandement de la compagnie des îles Saint-Pierre et Miquelon [112]. Détaché à Miquelon, il eut le malheur, le 21 mai 1770, d’y perdre sa seconde femme et le lendemain, l’abbé Paradis inhuma, « en l’église paroissiale de Notre-Dame de la ville Miquelon, le corps de très illustrissime dame Anne-Claire Dupont de Renon, âgée d’environ 56 ans. » [113] Dangeac, pour consoler son neveu, l’invita à venir passer un mois avec lui à Saint-Pierre [114]. Durant ce séjour, le gouverneur dut lui faire ses confidences car, dès le 12 octobre, le baron avança sa candidature au poste de gouverneur et y fut en effet nommé en 1773. Titulaire du grade de colonel en 1775, il épousa, le 27 mars de la même année, à l’âge de 50 ans, Jeanne-Françoise Rodrigue, fille du capitaine de port, qui en avait 21 et lui donna l’année suivante une fille, Jeanne-Rose [115]. Son habile capitulation, en 1778, lui valut, lorsqu’il se retira à Lorient en 1779, le grade de des armées du roi.
Un autre personnage notable de Louisbourg s’était réfugié à Saint-Pierre, Philippe Le Neuf de Beaubassin, conseiller au Conseil Supérieur de l’ Ile-Royale. Sa famille l’y avait accompagné et son épouse, Marie-Charlotte Daccarette lui donna deux fils, Louis-François, né le 13 septembre 1763 et Gabriel, né le 18 avril 1765 [116] ; le 3 juillet 1764, leur fille aînée, avait épousé à Saint-Pierre, François-Louis Poulain de Courval, capitaine de brûlot, fils de feu Jean-Louis Poulain de Courval, conseiller des Trois-Rivières en Nouvelle-France. Philippe Le Neuf de Beaubassin mourut dans la colonie le 12 juin 1769 et sa veuve, accompagnée de toute sa famille, comptant 8 personnes, s’embarqua au début d’octobre de la même année pour gagner la France. Mais un de ses fils revint y assumer les fonctions de lieutenant dans les troupes de la colonie et, le 4 janvier 1774, il épousa Marguerite Louise de Coux, fille de feu Louis de Coux, capitaine d’infanterie et de défunte Marguerite Henriette de l’Espérance baronne du Saint-Empire, originaire de la paroisse Sainte-Anne de l’Ile-Royale et sœur du gouverneur de Saint-Pierre.
On voit combien toutes ces familles nobles étaient liées entre elles ; mais elles n’hésitaient pas à s’allier aux familles des négociants. C’est ce que montre l’histoire des deux plus notables habitants de Saint-Pierre : Dupleix- Sylvain et Rodrigue. Le 26 décembre 1682 était baptisé à Québec par Monseigneur Henry de Bornières, vicaire-général de l’évêque de Québec, Claude, fils de Sylvain Dupleix et de Marie Minet, sa femme, demeurant à la Petite Rivière. On peut penser que Sylvain Dupleix était entrepreneur, car le parrain de son fils, Claude Baillif, exerçait la profession d’architecte et la marraine Jeanne Potain, était la fille d’un certain Jean Le Rouge, arpenteur [117]. Le jeune Claude Dupleix-Sylvain se fit, lui, capitaine de navire marchand et s’installa à Plaisance. C’est là, que le 4 novembre 1713, dans la maison de Joannis Daccarette, il signa le contrat de mariage qui le liait à Catherine de Gounillon, fille de feu Louis de Gounillon et de Marie-Anne Gilbert, sa veuve, remariée au marchand Joannis Daccarette ; cette cérémonie eut lieu en présence du R. P. François Raoul, supérieur du couvent des Récollets et du lieutenant Dangeac, le père du futur gouverneur de Saint-Pierre. De ce mariage naquit Jean-Baptiste Dupleix-Sylvain qui, le 24 février 1753, épousa à Louisbourg, Geneviève Benoîst, fille du capitaine Pierre Benoît et de Anne Jacau ; à ce mariage furent témoins outre Jean-Louis, comte de Raymond, seigneur d’Oye-la-Cour et autres lieux, gouverneur de la ville et du château d’Angoulême, commandant à l’ Ile-Royale, des personnages que nous connaissons déjà, dame Marie-Charlotte Daccarette, épouse de Philippe Le Neuf de Beaubassin, qui devenaient ainsi beau- frère et belle-sœur du marié, Antoine Rodrigue et Jeanne- Françoise Jacau, son épouse, qui devenaient ses oncle et tante. Dans le contrat de mariage, Jean-Baptiste Dupleix- Sylvain, outre l’établissement d’un douaire préfix de 7.000 livres notait qu’il faisait partie de la société de commerce de Beau- bassin, Sylvain et compagnie, pour une somme d’au moins 20.000 livres, non compris les immeubles. Ses affaires étaient donc assez florissantes. Lorsqu’il s’installa à Saint-Pierre, son épouse lui avait déjà donné un fils, Jean-Baptiste, né en 1759, et une fille, Marguerite, née en 1762 ; mais dans la nouvelle colonie, dix autres enfants leur naquirent, dont trois moururent en bas-âge. Les personnages les plus notables de la colonie acceptèrent d’être les parrains et marraines, témoignant ainsi de la considération dont jouissait la famille Dupleix- Sylvain [118]. La place de juge et lieutenant de l’amirauté vint consacrer en 1783 la situation privilégiée de Jean-Baptiste Dupleix-Sylvain, qui s’acquitta d’ailleurs de ses fonctions avec conscience et compétence, tout en continuant à surveiller la gestion de ses affaires mises sous le nom de ses enfants. L’histoire de la famille Rodrigue ressemble à celle de son amie Dupleix-Sylvain. Le 6 novembre 1710, Durand la Garenne, commandant la garnison du fort Louis de Plaisance, annonçait qu’ « un nommé Rodrigue, de nation portugaise, après avoir été entretenu pilote pour le service de Sa Majesté au Port-Royal, où il s’est marié », s’était fait corsaire et avait amené le 31 octobre, à Plaisance, une prise anglaise dont il s’était emparé sur les bancs de l’Acadie [119]. Son fils, Antoine Rodrigue, marié à Jeanne-Françoise Jacau, avait été témoin le 24 février 1753 au mariage de sa nièce, Geneviève Benoît, avec Jean-Baptiste Dupleix-Sylvain. Les deux familles se retrouvèrent à Saint-Pierre, où Antoine Rodrigue assura la fonction de capitaine de port ; sa femme lui donna huit enfants et la situation sociale des époux Rodrigue fut à son comble lorsque Jeanne-Françoise, leur fille, devint baronne d’Empire en épousant en 1775 Charles-Gabriel-Sébastien, baron de l’Espérance, gouverneur des îles Saint-Pierre et Miquelon [120].
En-dessous de ces deux catégories sociales, les nobles et les notables, quelques autres habitants représentaient les aisés : les Loyer-Deslandes [121], Vital-Chevalier, Pradère- Niquet, Bernard Lafitte ; enfin, certains réfugiés n’avaient que leurs talents de marins pour faire subsister leur famille ; les Douville [122], Rosse [123], Malvilain, Dupont [124], capitaines de navires qui partageaient leur existence entre la colonie et métropole la une partie de leur famille habitant à Saint-Pierre, l’autre à Saint-Malo [125].
Ces officiers militaires et civils, ces bourgeois, ces armateurs et ces capitaines constituaient les notabilités de la colonie. Que dire du reste de la population ? A Saint-Pierre comme à Miquelon, la majeure partie des habitants vivait pauvrement de la pêche et du séchage de la morue. Mais chaque île avait sa physionomie particulière.
2. — Pêcheurs et artisans de Saint-Pierre.
Au printemps, avec l’arrivée des premiers navires qui amenaient de France une main-d’œuvre de jeunes gens venus s’engager au service des colons, Saint-Pierre se réveillait de son sommeil hivernal et, jusqu’à la fin de l’automne le petit bourg connaissait une grande activité. Les gérants d’habitation engageaient leurs matelots et leurs garçons de grave. Les boulangers et les bouchers préparaient les provisions pour la campagne de pêche, tirant parti des farines et des salaisons apportées de France [126]. Les blanchisseuses, ravaudeuses, couturières et tailleurs d’habits lavaient, reprisaient et les solides vêtements des pêcheurs. Il fallait aussi construire, réparer et équiper les goélettes et les chaloupes ; de nombreux artisans se chargeaient de ces besognes, depuis les charpentiers (Pierre Saint- Jean, Amant Vigneau, Jean La Guerre, Louis Terriau, Félix Hébert etc.), les menuisiers (Jean Joly, Jean Garnache, François Martin, Pierre Guyon, François Contai etc.), jusqu’au charron (Pierre- Joseph Aourdequin), au ferblantier (Julien-Guillaume La Roche), aux forgerons-serruriers (Louis La Mâle, Thomas Le Noir), aux tourneurs (Guillaume Saintonge, Jérôme Guichon), en passant par le voilier (Pierre Le Tiecq) et les nombreux calfats. Les habitants profitaient de la belle saison pour faire réparer leurs maisons ; ils faisaient alors appel aux maçons qui, chose curieuse, étaient tous Anglais (Barthélémy Tayton, Martin Fay, Etienne Demerson), aux vitriers (Jean Colin, Pierre Guirouflet) et même, s’ils désiraient débarrasser leurs cheminées de toute la suie qu’avait produite un feu incessant durant l’hiver, ils s’adressaient aux ramoneurs (René Thébault, François Boisadau). Les trois ou quatre auberges ne désemplissaient pas, tandis que passait dans les rues le crieur public, François Bedel, chargé des publications et affiches. A la fin de la saison de pêche, venait l’important moment de traiter les affaires ; les habitants échangeaient leur poisson contre les marchandises des capitaines métropolitains et renouvelaient les engagements des garçons de grave pour la prochaine campagne.
C’était également à Saint-Pierre que se trouvait l’étude du notaire. Pendant quelques années, l’abbé Bonnecamps avait authentifié quelques très rares actes, tels que testaments et contrats de mariage ; il se déclarait « autorisé par Messire Gabriel Dangeac, gouverneur des isles Saint-Pierre et Miquelon, pour recevoir, au défaut de notaires royaux, les clauses » de tel et tel acte. Par la suite, il arriva parfois que l’abbé Paradis, à Miquelon, et le préfet apostolique Becquet, à Saint- Pierre, assumèrent la même fonction dans des circonstances exceptionnelles ; Becquet ne manquait pas dans ce cas de se parer du titre de « licencié es droit de la faculté de Paris » ; mais l’accroissement de la vie commerciale dans la colonie, avec la multiplication des actes d’engagements, de ventes, de louages, de procurations, nécessita la nomination d’un notaire en titre. En 1768, le greffier de l’amirauté, Mounier, fut chargé de recevoir tous ces actes, que le règlement pour la pêche de 1743 ordonnait de passer devant notaire [127]. Après lui, à partir de 1773, Bordot occupa la même place. De leur activité il nous reste deux registres renfermant un nombre assez réduit de documents, d’un intérêt minime d’ailleurs [128]. Deux ou trois testaments, autant d’inventaires, une trentaine de contrats de mariage ne révélant rien de bien particulier sur la mentalité, les pratiques pieuses, les habitudes juridiques ou la condition matérielle des colons, sinon une grande pauvreté et le désir de constituer en faveur de la femme une petite réserve d’argent, à l’abri de toutes les revendications des créanciers du mari. En effet, le crédit constituait, si l’on peut dire, la base de l’économie, dans la colonie ; les habitants avaient de grandes dettes envers l’État, mais aussi envers les commerçants et les armateurs. Aussi tous les contrats de mariages étaient-ils rédigés sur le même modèle et comprenaient les clauses suivantes : l’état-civil des parties avec la mention des parents et témoins ; la promesse de mariage « en face de notre mère la Sainte-Église, sitôt que l’une des parties requerra l’autre » ; la communauté des biens : « Lesdits futurs conjoints seront un et commun en tous biens meubles et immeubles, faits et progrès, pendant et durant leur future communauté, conformément à la coutume de Paris, sous laquelle les parties contractantes s’engagent, renonçant expressément à toute autre loi, usage et coutume à ce contraire, quand même les parties feroient leur demeure en pays qui en règleroit autrement, et ce par clause expresse » ; l’exception des dettes : « Ne seront lesdits futurs conjoints tenus de payer les dettes l’un de l’autre, et si aucunes il y a de fait et progrès avant la célébration de leur mariage, elles seront payées par et sur les biens de celui ou celle d’où elles proviendront sans que l’autre ni ses biens soient tenus ni obligés, et ce par clause expresse » ; l’apport de la femme était indiqué parfois par une dot d’un montant variable [129], mais le plus souvent par cette clause générale : « Ledit futur époux prend ladite demoiselle, sa future épouse, avec tous les droits, noms, raisons et actions qui pourront lui écheoir par le décès de ses père ou autrement, de quelque nature qu’ils soient et en quelqu’endroit qu’ils soient situés, desquels ledit futur époux ne sera tenu de faire rechercher qu’autant qu’il le jugera à propos » ; en prévision de la dissolution de la communauté, le mari constituait très souvent pour sa femme, lorsque celle-ci n’avait pas apporté de dot, un douaire préfix [130], garanti par une hypothèque, en ces termes : « Ledit futur époux, pour la bonne amitié qu’il a pour sa future épouse, il l’a douée et doue de la somme de … livres de douaire préfix, et, une fois payée, pour dudit douaire faire et disposer par la future épouse comme d’un bien à elle appartenant et légitimement acquis sans que, pour raison de ce, elle soit tenue de faire demande en justice, et ce par clause expresse, de laquelle somme il a chargé, affecté et hypothéqué ses biens meubles, immeubles, présents et à venir » ; assez rarement figurait la clause réservant un préciput égal et réciproque de quelques milliers de livres au survivant ; par contre, la clause de donation mutuelle au survivant, en cas de non-postérité, était courante : « chacun desdits futurs conjoints, en cas qu’il n’y ait point d’enfant issu de leur mariage, fait à celui des deux qui survivra à l’autre une donation entière de tous les biens qui appartiendront à la communauté lors de la mort de l’un des deux futurs conjoints ; veut et entend que le survivant possède lesdits biens et en jouisse en toute propriété sans que les héritiers du mort, quels qu’ils soient, puissent pour quelque raison et sous quelque prétexte que ce soit les troubler dans la jouissance paisible desdits biens ni lui en demander aucun compte, et ce par clause expresse » ; mais aucun des contrats de mariage n’omettait de mentionner la faculté pour la veuve de renoncer à la communauté, si elle le jugeait bon ; cette dernière clause était particulièrement importante, étant donné les nombreuses dettes que la plupart des familles devaient contracter pour assurer leur subsistance et financer leurs entreprises commerciales.
Les colons de Saint-Pierre n’avaient pas ménagé leurs efforts pour rétablir leur fortune détruite. En 1767, Rodrigue et Dupleix-Sylvain, faisaient remarquer au ministre qu’ils avaient dépensé 80.000 livres pour leurs nouveaux établissements [131]. En quoi consistaient-ils ? Le recensement détaillé fait par le baron de l’Espérance en 1776 nous l’apprend [132]. Le capitaine de port, Antoine Rodrigue, âgé cette année-là de 54 ans, possédait une habitation de pêche composée d’une grave, de deux échafauds, d’une maison, de trois magasins, de cinq cabanes pour y loger ses pêcheurs et d’une écurie [133] ; il avait à sa charge son épouse Jeanne-Françoise Jacau, âgée de 50 ans, ses fils Pierre- Joseph, âgé de 23 ans, Charles-Joseph, de 17 ans, Michel, de 11 ans, François-Edme, de 4 ans, sa fille Domitille, âgée de 9 ans et une servante, Marie-Françoise Dupuis, âgée de 28 ans. Mais son fils aîné, Antoine Rodrigue, âgé de 25 ans, dirigeait, avec l’aide d’un commis de 30 ans, Théophile Barbaste, une petite flottille de pêche composée de deux goélettes au long-cours, de quatre goélettes de pêche, de onze chaloupes, de trois barquettes ou demi-chaloupes, de deux canots, de deux warys [134], et possédait en outre dix bêtes à cornes, trois chevaux, cinq moutons, six chèvres et un magasin à sel. Jean-Baptiste Dupleix-Sylvain, âgé de 54 ans, faisait subsister sa famille, composée de son épouse Geneviève Benoît, 41 ans, et de leurs neuf enfants, dont l’âge s’échelonnait de 21 mois à 17 ans, en exploitant à Saint-Pierre, une grave, deux maisons, une cabane, deux magasins, une étable, une goélette au long-cours de 100 tonneaux, trois goélettes de pêche ; à l’île aux Chiens, une grave, un échafaud, une cabane, une saline, six chaloupes, une barquette et un wary ; à Miquelon enfin, une maison, une grave, un échafaud, une cabane, une saline, trois chaloupes et un wary. Quelques autres familles semblent avoir été assez aisées ; la veuve Lagroix, âgée de 60 ans, faisait exploiter par son gendre Alexis Dubois, 32 ans, marié à sa fille Marguerite Lagroix, 20 ans, une habitation composée d’une maison, un magasin, une boulangerie, huit cabanes de pêche, un échafaud, deux graves, trois goélettes, un brigantin, dix chaloupes, deux barquettes, quatre canots, trois bêtes à cornes, deux moutons. Le jeune Jean-Pierre Boullot, qui n’avait que 21 ans, disposait d’une maison, d’un magasin, de six cabanes de pêche, d’un échafaud, d’une grave, de six chaloupes et de trois goélettes. Loyer-Deslandes, 40 ans, marié à Marie Arondel, 25 ans, faisait vivre ses quatre jeunes enfants, Simon, 5 ans, François, 4 ans, Marie, 3 ans, Nicolas, 2 ans, sa belle-sœur Françoise Arondel, 27 ans, et la servante Marguerite Vigneau, 26 ans, en tirant profit d’une maison, de trois magasins, de cinq cabanes de pêche, d’un échafaud, d’une grave, de deux goélettes, de huit chaloupes, d’un canot, d’une barquette, d’un cheval, d’une vache, de cinq cochons et de deux moutons. Bernard Lafitte, 47 ans, Elisabeth Talard, sa femme, 40 ans et leurs cinq fils disposaient d’une maison, de deux magasins, de deux étables, d’une grave, d’une cabane, d’un canot, de sept bêtes à cornes et de dix moutons. Pradère Niquet, chef d’une famille de sept personnes, possédait une maison, trois cabanes, un échafaud, un magasin, une goélette, dix chaloupes, deux barquettes, un canot, une grave et une étable abritant une vache, un veau et un cheval. Vital devait entretenir les six personnes de sa famille avec une maison, deux magasins et une vache. Mais combien d’autres habitants n’avaient pour tout bien qu’une chaloupe en société, tel Augustin Dubois qui devait faire subsister sa femme et ses cinq enfants. L’inventaire général de l’île Saint-Pierre indiquait en 1776 : 130 maisons, 95 cabanes de pêcheurs, 65 magasins, 15 étables, avec 50 bêtes à corne, 5 chevaux, 26 moutons, 53 chèvres et 15 cochons, 2 forges, 5 boulangeries, 41 graves, 29 échafauds, 47 goélettes, 2 brigantins, 1 bateau, 154 chaloupes, 84 canots et warys, 14 barquettes et 4 salines. La déportation de 1778 causa d’importants dommages à ces établissements puisqu’en 1784, un an après la reprise de possession, Antoine Rodrigue ne disposait plus que d’une maison, trois cabanes, un échafaud, un brick, une goélette, sept chaloupes, une barquette, deux canots, deux warys et une grave ; Dupleix-Sylvain ne possédait plus qu’une cabane de pêche, un échafaud, une goélette, deux chaloupes, une barquette, une grave à Saint-Pierre, une autre à l’Ile aux chiens et une troisième à Miquelon. L’inventaire général de l’île indiquait, pour 763 habitants, 85 maisons, 34 cabanes, 14 44 graves, 15 bricks, 28 goélettes, 71 chaloupes, 17 barquettes 21 canots et 68 warys [135].
3. — Les Acadiens de Miquelon
Miquelon demeurait à l’écart de l’animation qui régnait à Saint-Pierre, chaque année, six mois durant. Peu de navires métropolitains venaient y relâcher, à cause du mouillage dangeureux. Les Acadiens mirent longtemps à s’adapter à leurs nouvelles conditions de vie. En 1768, Dangeac faisait observer à la Cour : « Les Acadiens ne se sont adonnés à la pêche qu’en 1766. Il leur était même défendu de la faire à l’Ile- Royale, pendant le gouvernement de Mr. le comte de Raymond et à l’isle Saint- Jean, ils ne l’ont jamais exercée. Nos anciens colons de Terre-Neuve et de l’Isle Royale, au contraire, de père en fils depuis plus d’un siècle ont exercé la pêche de la morue dans ces climats. Chaque famille acadienne, ne seule entreprendre de faire la pêche, cinq ou six ou quelquefois plus, se mettent pour cet objet en société : elles bâtissent ou achètent à frais communs une voiture pontée ; les ustensiles et les vivres sont également fournis par chaque associé. Les hommes et les garçons vont prendre du poisson et les chefs trop âgés, les femmes et les filles les font sécher à terre. Mais, jusqu’ici, il y a eu nécessité pour chacune de ces sociétés d’engager un homme qui pût conduire sa goélette ou voiture sur les bancs et d’un trancheur pour habiller la morue, auxquels elle est obligée de faire de très grands avantages, d’où peu de profits. J’ai eu assez longtemps les Acadiens à mes ordres pour les connoître. Leurs enfants pourront s’endurcir au métier de Terre-Neuve, s’ils le suivent jamais. Mais les pères n’ont jamais su se captiver ; s’ils sont adroits, c’est surtout à la chasse et à travailler le bois. » [136] L’ordonnateur Beaudéduit confirmait ces remarques ; il écrivait dans un mémoire personnel : « L’Acadien est effectivement industrieux ; mais pour faire la pesche en goélettes et bateaux, ils sont obligés de prendre quelquefois des hauturiers pour les conduire sur les bancs et des trancheurs pour le poisson » [137].
Un enquêteur anglais, Joseph Woodmass, envoyé en 1769 par William Campbell, gouverneur de la Nouvelle-Ecosse, pour opérer une discrète inspection de la colonie, passa quelques jours à Miquelon [138]. A Halifax, il avait connu personnellement plusieurs Acadiens ; il les retrouva dans une situation misérable. 50 à 60 familles employaient 50 chaloupes et 14 goélettes dont 8 avaient été bâties durant l’hiver sur la petite Miquelon ou Langlade, pour approvisionner en morue 10 échafauds que l’on devait reconstruire chaque printemps, car les tempêtes d’hiver les emportaient régulièrement. Sur les graves de cailloux, des maisons bâties de piquets de sapin très petits [139], quelques magasins démunis, des vaches maigres et des brebis affamées formaient toute la richesse de ces colons qui demandaient à Woodmass des passeports pour retourner en Nouvelle- Ecosse. Ce pitoyable tableau était sans doute exact, mais il faut noter que les colons venaient à peine de rentrer de France. Leur situation s’améliora par la suite. Le recensement de 1776 qui mentionne 649 habitants et 127 hivernants à Miquelon, y dénombrait également 107 maisons, 21 cabanes, 24 magasins 64 étables abritant 222 bêtes à corne, 73 chevaux et 106 moutons, 23 échafauds, 2 boulangeries, 20 goélettes, 71 chaloupes 39 canots et warys et 59 graves [140]. En 1784, après la reprise de possession, la situation n’était pas encore tout à fait rétablie ; 432 habitants disposaient de 49 maisons, de 9 cabanes, de 9 échafauds, d’une goélette de 26 chaloupes, de 3 demi-chaloupes, de 2 canots, de 30 warys, et de 82 graves [141].
Les Miquelonais d’ailleurs tirèrent parti de leur vieille expérience de laboureurs et de fermiers pour exploiter le sol de l’île. Dumesnil-Ambert, commandant à Miquelon, transmit en 1785 un rapport à la Cour où il décrivait le travail de ses administrés : « On doit regarder le jardinage comme un des principaux moyens de subsistance ; la terre, sans beaucoup de culture, rapporte avec abondance des patates, qui peuvent au besoin suppléer la farine et des choux, que l’on vend 8 et 10 sols la pièce. Le prix des journées est aussi de grande Les hommes, à quelqu’ouvrage que ce soit, gagnent 4 et 5 livres par jour et les femmes qui blanchissent, repassent et raccommodent le linge n’ont jamais moins de 20 à 30 sols, outre la nourriture. » [142] Les conditions de travail étaient donc assez différentes de celles de Saint-Pierre ; les habitants ne s’appliquaient pas exclusivement à la pêche ; à la fois pêcheurs, laboureurs, journaliers, ouvriers, ils tâchaient de se suffire à eux-mêmes, avec courage et ingéniosité.
Ainsi, dans ce rapport de 1785, Dumesnil-Ambert recense les familles en indiquant leurs moyens d’existence. Par exemple Madeleine Sire, veuve de Pierre Bourg, âgée de 41 ans, vivait avec ses cinq enfants : Jean, 21 ans, Joseph, 19 ans, Anne, 16 ans, Hélène, 13 ans et Pierre, 11 ans ; « deux de ses enfants sont pescheurs, les autres gagnent leur subsistance en levant des langues et naves de morue qu’ils salent, font sécher et vendent à raison de 30 livres le quart ; ils luy aident d’ailleurs à cultiver son jardin qui est d’un très bon rapport. Ce que font les enfants de cette femme est un exemple suivi par beaucoup d’autres. Le produit de ce travail est vendu ou gardé pour l’approvisionnement d’hiver. » [143] Jean Cormier, 47 ans, époux de Rosalie Vigneau, 40 ans, avait 7 enfants ; « excellent et pescheur, il a la moitié d’une chaloupe ; ses deux fils aînés sont également pescheurs ; il a été maître de grave cette année pour deux chaloupes et n’a employé que sa famille à ce genre de travail. Il a un jardin d’un très grand rapport. » [144] Vincent Sire, 39 ans, mari d’Angélique Vigneau, 28 ans, ne devait compter que sur lui, car ses cinq enfants étaient très jeunes ; « pescheur et charpentier, il fait la pesche en qualité de maître dans une chaloupe dont la moitié lui appartient ; il est allé s’établir au Barachoix avec trois autres familles qui ont fait une grande quantité de fourage, au moyen duquel ils se sont arrangés pour passer l’hiver un grand nombre de bestiaux à raison de 40 livres par grosses pièces ; il a un » [145] Enfin Abraham Dugas, 50 ans, sa femme, Marguerite Le Blanc, 50 ans, et leurs deux enfants, offrent un exemple encore plus caractéristique ; « cet habitant demeure à Lan- glade où son habitation est très bien montée. Il ne fait point la pesche, mais il élève des bestiaux et fait beaucoup de jardinage qu’il porte à Saint-Pierre dans une très grande chaloupe qui lui appartient. » [146] Dumesnil-Ambert concluait : « Le présent dénombrement contient 96 familles qui forment une population de 514 personnes. La crainte de repasser en France, où elles sont persuadées que la plus noire misère les attend, a servi d’aiguillon à leur industrie, en sorte que, s’il n’y a pas eu de fraude de leur part dans le recensement des vivres dont elles se sont pour l’hiver, aucune d’elles ne peut être à charge à la colonie. On pourroit même assurer que deux ou trois années d’une pesche abondante les mettroit toutes en quelque sorte au-dessus du besoin ; mais il n’est pas moins vrai que, pour peu que la pesche prochaine ne soit pas plus heureuse à Miquelon qu’elle ne l’a été cette année et que le prix des denrées que le commerce leur fournit soit aussi exorbitant qu’il l’a été, il n’y aura pas dix de ces familles en état de subsister à Miquelon sans le secours du Roy. » [147]
Dans une lettre qu’il adressait à un ami, probablement Bretel,. premier commis au ministère de la Marine, Dumesnil-Ambert donnait des indications complémentaires : il y avait à Miquelon « 76 maisons, 9 magasins, 20 cabanes, 13 échafauds, 21 étables abritant 3 chevaux, 6 juments, 120 bêtes à cornes et 182 bêtes à laine, 15 boulangeries et fours pratiqués dans les maisons, 54 chaloupes, dont 43 ou 44 ont fait la pesche, les 10 autres ayant été ou louées à Saint-Pierre ou non équipées faute de monde, 70 warys grands et petits. » II faisait remarquer que la moitié des moutons appartenait au commandant de Saint-Pierre, à celui de Miquelon, au vice-préfet, au commis principal et au chirurgien de Miquelon ; à la réserve de ce dernier, les mêmes personnages possédaient chacun une vache. Dumesnil-Ambert concluait : « Quel dommage, mon bon amir que des gens aussi laborieux que le sont ces habitants soient tombés dans le découragement par l’abandon que l’on a fait d’eux. Il semble que cette pauvre race d’Acadiens soit vouée au malheur pour l’éternité des siècles. Est-ce là la récompense que méritent les sacrifices que leur amour et leur fidélité pour la France leur ont fait faire ? » [148]
Le ministre, averti de ce découragement, ordonna, le 31 mars 1786, à Barbazan, commandant la station, de se rendre à Miquelon : « Les habitants qui, pour la plupart, sont d’anciens Canadiens, mériteront une attention spéciale. On prétend qu’il y a entre eux et les habitants de l’île Saint-Pierre une ancienne jalousie provenant de l’opinion où l’on est à Miquelon que les habitants de Saint-Pierre, des avantages de leur situation, ont toujours été mieux traités par les commandants. » [149] Nous avons pu constater, en effet, que des liens étroits de parenté et d’amitié existaient entre les deux gouverneurs, Dangeac et le baron de l’Espérance, et les plus notables habitants de Saint-Pierre, les Dupleix-Sylvain et les Rodrigue ; il est possible que les responsables de l’administration aient favorisé leurs amis négociants mais nous n’avons jamais trouvé qu’ils l’eussent fait au préjudice des Miquelonais. Barbazan ne découvrit d’ailleurs rien d’anormal au cours de sa mission ; il demeura six jours dans l’île, au début de juin 1768, « sans accompagnement des administrateurs. » Le rapport qu’il rédigea, à la suite de son séjour confirme tout ce que l’on connaît de la situation des colons : 92 familles formaient une population d’environ 500 personnes logées dans 78 cabanes ; « les hommes pèchent les morues, les femmes et les enfants les préparent à terre et se procurent à force de culture quelques légumes » ; 240 bœufs, vaches et veaux et un nombre égal de moutons subsistaient sur les prairies de l’île. La propriété des 44 chaloupes de pêche se partageait entre les 92 familles, endettées par ailleurs envers les négociants qui leur fournissaient à crédit du sel, des voiles, des cordages, des biscuits et de l’eau-de-vie [150].
Malgré cette existence précaire, les Acadiens de Miquelon conservaient leurs traditions familiales et leur bonne humeur, si l’on en juge par le choix des surnoms qu’ils se donnaient ; c’était d’ailleurs une coutume nécessaire, étant donné la des noms de famille. Il y avait ainsi un Joseph Vigneau dit l’Ambassadeur, un Jacques Vigneau dit Menack, un Jean Vigneau dit Maurice, dit encore l’Écrivain et un Joseph Vigneau dit Forban ; un Jean Vigneau était surnommé Son Jean, un Armand Vigneau Son Petit et un Pierre Vigneau dit Son Homme. Il y avait un Jean Cormier dit Nampanne, un Joseph Cormier dit Meilleur, un Jean Cormier dit Wescack. Il y avait un Jean Hébert surnommé Boudiche, un autre Jean Hébert dit Grosjean et un Jacques Hébert dit Boudiche Père. Il y avait Jean Briand dit Finance, Pierre Arseneau dit Veneris, Pépin Richard dit Menouche, Jean Boudrot dit Miqueteau, Michel Le Borgne dit l’Éveillé, François Buot dit France, Joseph Dugas dit Petit- Jo, François Mons dit la Montagne, Jean Sire dit Jean-go et bien d’autres qui montrent que les Acadiens ne manquaient, malgré tout, ni d’humour ni même de malice [151].
4. — Des témoins : Cassini et Chateaubriand.
Ces quelques indications nous ont permis de préciser certains aspects de la vie des colons aux îles Saint-Pierre et Miquelon. Mais nous ne pouvons nous dispenser d’invoquer le témoignage de deux voyageurs qui visitèrent les îles à la fin du xvme siècle et, durant leur séjour, regardèrent vivre les A plus de vingt ans d’intervalle, le savant Cassini et le poète Chateaubriand firent une escale de quinze jours à Saint- Pierre, le premier en 1768, le second en 1791 [152].
Leur première impression fut identique ; ils la rapportent avec des talents divers : « Nous ne fûmes pas plutôt mouillés à l’entrée de la rade de l’isle Saint-Pierre, le 25 juillet à six heures du matin, écrit Cassini, que la brume la plus épaisse vint dérober à nos yeux, pendant deux jours, la terre qui nous environnoit. Il falloit, à la vérité, avoir été quarante-deux jours en mer, pour être sensible à la privation de la vue d’une côte aride, telle que celle qui forme la rade et, en général, le total de l’isle Saint-Pierre ; mais pour des marins ennuyés du spectacle uniforme de la mer, le plus hideux rocher a des charmes. » L’impression qu’éprouva Chateaubriand fut à peine moins pénible : « Quand nous approchâmes (de l’île Saint- Pierre), un matin entre dix heures et midi, nous étions presque dessus ; ses côtes perçaient, en forme de bosse noire, à travers la brume. Nous mouillâmes devant la capitale de l’île : nous ne la voyions pas, mais nous entendions le bruit de la terre. Les passagers se hâtèrent de débarquer… Je pris un logement à part ; j’attendis qu’une rafale, arrachant le brouillard, me montrât le lieu que j’habitais, et pour ainsi dire le visage de mes hôtes dans ce pays des ombres. »
Chateaubriand ne semble pas avoir été incommodé, comme le fut Cassini, par l’air que l’on respirait à Saint-Pierre. « Le lendemain de notre arrivée, raconte en effet le savant, nous allâmes gagner la côte, au milieu d’un nuage de brume. Nous en étions encore éloignés, lorsqu’une odeur désagréable nous annonça ce que nous allions trouver sur le rivage. L’infection augmentoit à mesure que nous approchions et elle fut à son comble lorsque nous vînmes à débarquer auprès d’une espèce de maison de bois, saillante dans la mer et bâtie sur pilotis. C’est ce qu’on appelle dans le pays un chafaud… Descendus à terre, nous prîmes le chemin de la maison du gouverneur, en traversant un champ semé uniquement de cailloux blancs, ou galets, qui servoient de tapis à une multitude innombrable de morues qui y étoient étendues. M. Dangeac, gouverneur de l’isle, vint au-devant de nous, accompagné de sa famille. Les politesses et les attentions que nous éprouvâmes de leur part, pendant tout le temps de notre séjour, nous persuadèrent que les agrémens d’une aimable société peuvent quelquefois réparer et faire oublier les désagrémens des plus vilains climats.
M. Dangeac fut à peine instruit de l’objet de ma mission, qu’il ne s’occupa plus qu’à me procurer les commodités nécessaires à mes opérations. J’étois comblé de ses honnêtetés ; la manière dont elles étoient faites les rendoit encore plus agréables ; il m’obligea d’accepter la maison et même l’appartement de MM. ses fils. »
On savait vivre à Saint-Pierre. Chateaubriand n’en disconvientpas : « Je dînai deux ou trois fois chez le gouverneur, officier plein d’obligeance et de politesse [153]. Il cultivait sur un glacis quelques légumes d’Europe. Après le dîner, il me montrait ce qu’il appelait son jardin. Une odeur fine et suave d’héliotrope s’exhalait d’un petit carré de fèves en fleurs. Elle n’y était pas apportée par une brise de la patrie, mais par un vent sauvage de Terre-Neuve sans relation avec la plante exilée, sans sympathie de réminiscence et de volupté. Dans ce parfum non respiré de la beauté, non épuré dans son sein non répandu sur ses traces, dans ce parfum chargé d’aurore, de culture et de monde, il y avait toute la mélancolie des regrets, de l’absence et de la jeunesse [154]. »
En cet endroit, les impressions de nos deux auteurs prennent un tour un peu différent. Ce qui pour le poète constituait le prétexte d’une rêverie raffinée, devint pour le savant le sujet de préoccupations gastronomiques : « Les habitants, note Cassini, ont de petits jardins, où ils cultivent avec peine quelques laitues qui ne parviennent jamais à une parfaite maturité, mais qu’ils mangent avec délice lorsqu’elles sont encore toutes vertes… La soupe se fait communément avec des têtes de morues ; je n’en ferai pas l’éloge… Notre arrivée à Saint^Pierre fut célébrée par la mort d’un bœuf ; c’étoit vraiment la plus grande réception que l’on pût nous faire. »
Nos deux voyageurs ne manquèrent pas de parcourir l’île ; la description qu’ils en ont laissée est conforme au tempérament de chaque auteur. « Je me suis quelquefois, rapporte Cassini, enfoncé dans l’isle Saint-Pierre pour y prendre connoissance du local et en examiner les productions ; je n’y ai trouvé que des montagnes qu’on ne peut escalader sans ; les vallons qui les séparent ne sont pas plus faciles à parcourir ; les uns, remplis d’eau, forment plusieurs lacs ; les autres sont embarrassés de méchans petits sapins et de quelques bouleaux… L’isle Saint-Pierre n’est qu’un amas de montagnes ou plutôt de rochers escarpés, couverts en quelques endroits d’une mousse aride et d’autres mauvaises herbes, tristes fruits de la stérilité d’un sol pierreux. La plante la plus commune que j’aie remarqué à Saint-Pierre est une espèce de thé (du moins on l’appelle ainsi dans le pays) ; sa feuille est veloutée en-dessous, fort ressemblante, ainsi que la tige, à notre romarin. 11 y a aussi une autre plante qu’on nomme anis ; j’ai goûté de l’un et de l’autre infusé dans de l’eau chaude ; l’anis m’a paru avoir le goût le plus agréable. » [155]
La prose de Chateaubriand est à la fois plus précise et plus évocatrice : « Les mornes à l’intérieur étendent des chaînes divergentes dont la plus élevée se prolonge vers l’anse Rodrigue. Dans les vallons, la roche granitique, mêlée d’un mica rouge et verdâtre, se rembourre d’un matelas de sphaignes, de lichen et de dicranum. De petits lacs s’alimentent du tribut des ruisseaux de la Vigie, du Courval, du Pain- de- Sucre, du Ker- gariou, de la Tête- Galante. Ces flaques sont connues sous le nom des Etangs-du- Savoyard, du Cap- Noir, du Ravenel, du Colombier, du Cap-à-l’Aigle [156]. Quand les tourbillons fondent sur ces étangs, ils déchirent les eaux peu profondes, mettant à nu çà et là quelques portions de prairies sous-marines que recouvre subitement le voile retissu de l’onde… La pente des monticules de Saint-Pierre est plaquée de baumiers, d’amelanchiers, de palomiers, de mélèzes, de sapins noirs, dont les bourgeons servent à brasser une bière antiscorbutique. Ces arbres ne dépassent pas la hauteur d’un homme. Le vent océanique les étête, les secoue, les prosterne à l’instar des fougères ; puis, se glissant sous ces forêts en broussailles, il les relève ; mais n’y trouve ni troncs, ni rameaux, ni voûtes, ni échos pour y gémir, et il n’y fait pas plus de bruit que sur une bruyère. »
Enfin, nos deux auteurs ne furent pas sans se préoccuper de l’existence des habitants. Cassini observa leur travail ; d’un échafaud « dont le toit est à jour pour laisser passer la pluie et l’air qui enlèvent une partie de la malpropreté et de la mauvaise odeur de ce lieu », il remarque « un petit bateau à voile quarrée… L’équipage n’est jamais composé que de deux pêcheurs et, ordinairement d’un chien, leur compagnon et serviteur fidèle. De dessus leur bateau, ces pécheurs tuent à coups de fusil des goélands et autres oiseaux de mer, dont ils font leur soupe. Le chien se jette à la nage et rapporte l’oiseau, sans que le maître soit obligé de se déranger de sa pêche. » Cassini nous a laissé un croquis de cette scène prosaïque ; Chateaubriand, lui, conserva des habitants de l’île un souvenir d’une autre nature. Le jeune chevalier en route pour l’Amérique avait vingt ans et l’esprit exalté ; il serait bien étonnant qu’il n’eût pas découvert, même à Saint-Pierre, une des innombrables incarnations de sa Sylphide. De cette rencontre, il a brossé une scène de genre où l’affabulation et la réalité se mêlent si étroitement que, dans l’impossibilité où nous sommes de les distinguer, force nous est de la reproduire telle quelle. « Un matin, j’étais allé seul au Cap-à-l’Aigle, pour voir se lever le soleil du côté de la France. Là, une eau hyémale formait une cascade dont le dernier bond atteignait la mer. Je m’assis au ressaut d’une roche, les pieds pendant sur la vague qui déferlait au bas de la falaise. Une jeune marinière parut dans les déclivités supérieures du morne ; elle avait les jambes nues, quoiqu’il fît froid, et marchait parmi la rosée. Ses cheveux noirs passaient en touffes sous le mouchoir des Indes dont sa tête était entortillée ; par-dessus ce mouchoir,, elle portait un chapeau de roseaux du pays en façon de nef ou de berceau. Un bouquet de bruyères lilas sortait de son sein que modelait l’entoilage blanc de sa chemise. De temps en temps elle se baissait et cueillait les feuilles d’une plante aromatique qu’on appelle dans l’île thé naturel. D’une main elle jetait ces feuilles dans un panier qu’elle tenait de l’autre main. Elle m’aperçut : sans être effrayée, elle se vint asseoir à mon côté, posa son panier près d’elle, et se mit comme moi, les jambes ballantes sur la mer, à regarder le soleil » « Nous restâmes quelques minutes sans parler ; enfin, je fus le plus courageux et je dis : « Que cueillez-vous là ? La saison des lucets et des atocas est passée. » Elle leva de grands yeux noirs, timides et fiers, et me répondit : « Je cueillais du thé. » Elle me présenta son panier. « Vous portez ce thé à votre père et à votre mère ? — Mon père est à la pêche avec Guillaumy. — Que faites-vous l’hiver dans l’île ? — Nous tressons. des filets, nous péchons les étangs, en faisant des trous dans la glace ; le dimanche, nous allons à la messe et aux vêpres, où nous chantons des cantiques ; et puis nous jouons sur la neige et nous voyons les garçons chasser les ours blancs [157]. — Votre père va bientôt revenir ? — Oh ! non : le capitaine mène le navire à Gênes avec Guillaumy [158]. — Mais Guillaumy reviendra ? — Oh ! oui, à la saison prochaine, au retour des pêcheurs. Il m’apportera dans sa pacotille un corset de soie rayée, un jupon de mousseline et un collier noir. — Et vous serez parée pour le vent, la montagne et la mer. Voulez-vous que je vous envoie un corset, un jupon et un collier ? — Oh ! non. » « Elle se leva, prit son panier, et se précipita par un sentier rapide, le long d’une sapinière. Elle chantait d’une voix sonore un cantique des Missions : Tout brûlant d’une ardeur immortelle C’est vers Dieu que tendent mes désirs. » « Elle faisait envoler sur sa route de beaux oiseaux appelés aigrettes, à cause du panache de leur tête ; elle avait l’air d’être de leur troupe. Arrivée à la mer, elle sauta dans un bateau, déploya la voile et s’assit au gouvernail ; on l’eût prise pour la Fortune : elle s’éloigna de moi. » « Oh ! oui, oh ! non, Guillaumy, l’image du jeune matelot sur une vergue au milieu des vents, changeait en terre de délices l’affreux rocher de Saint-Pierre : L’isole di Fortuna ora vedete. » II serait agréable de terminer cet article sur cette vision des Iles Fortunées. Hélas ! seul un poète amoureux peut se permettre de transfigurer ainsi les îles Saint-Pierre et Mique- lon. Le prosaïque Cassini se faisait une idée plus exacte de « la difficulté de vivre dans un pays si ingrat », propre seulement pour « des pêcheurs battus par la tempête » et contraints de « passer six mois entiers entre le ciel et l’eau, dans un séjour privé de la vue du soleil, respirant la plupart du temps une brume si épaisse que l’on distingue avec peine d’une extrémité à l’autre du bâtiment. »
Lorsque, le 14 mai 1793, les troupes du brigadier-général Ogilvie firent prisonniers le commandant, la garnison et les habitants des îles Saint-Pierre et Miquelon, ils arrêtèrent pour une vingtaine d’années, jusqu’en 1816, le développement de notre petite colonie. Alors commença une nouvelle période de l’histoire des îles, période qui dure encore et au cours de laquelle les colons n’ont plus jamais été troublés par aucune invasion. En effet, la caractéristique la plus notable de l’histoire des îles Saint-Pierre et Miquelon au xvme siècle résida dans l’extrême précarité de leur situation ; les Anglais s’en emparèrent à neuf reprises (en 1690, 1702, 1703, 1707, 1708, 1710 et 1711, puis en 1778 et 1793) ; elles furent pillées à peu près chaque fois, sans compter la dévastation que leur fit subir l’amiral Richery en 1796. Ainsi les îles Saint-Pierre et Miquelon furent-elles le lieu qui eut le plus à souffrir de la rivalité franco- anglaise à Terre-Neuve au xvme siècle. Cette perpétuelle insécurité fut aussi le lot dramatique de la population acadienne. Expulsés de leurs terres, spoliés de leurs biens, déportés, exilés, prisonniers, les Acadiens avaient subi tout ce qu’un peuple peut souffrir en fait d’avanies ; leurs tribulations les avaient aigris. « Ils passaient leur temps à parler de l’Acadie et des beaux biens qu’ils y avaient possédés » [159]. De longues années durant, ils cherchèrent, selon l’expression d’un des leurs, Perrault, « la terre promise » et crurent la trouver aux îles Saint-Pierre et Miquelon où pourtant « il n’y a point de ruisseaux qui coulent le lait ni le miel. » [160] Avec courage et ingéniosité, ils s’adaptèrent à la rude existence des pêcheurs, à laquelle, anciens fermiers, ils n’étaient pas préparés ; il y avait quelque injustice à dénoncer, comme le fit le baron de l’Espérance, le « mauvais esprit des Acadiens portés au gaspillage » [161]. Les îles Saint-Pierre et Miquelon constituèrent pour eux une nouvelle patrie, souvent perdue d’ailleurs et jamais tout à fait retrouvée ; après chaque exil en France, en 1767, en 1778, en 1793, la plupart d’entre eux demandèrent à revenir dans la colonie. En 1817, on en retrouve encore trente-huit qui portaient les noms familiers de Boudrot, Cormier, Gaultier, Hébert, Vigneau, etc. ; la doyenne, Marie Vigneau, était née en 1746 dans la Caroline ; elle avait subi une demi-douzaine d’exils [162].
De nos jours, notre petit territoire d’Amérique du Nord a connu et connaît encore une situation difficile au point qu’on a pu dire à son propos : « Des îles qui meurent » [163]. L’histoire de sa population à la fin de l’Ancien Régime, telle que nous avons tenté ici de la rappeler, devrait faire modifier ce Saint-Pierre et Miquelon ne sont pas des îles qui meurent, mais des îles qui n’ont jamais cessé de survivre. Jean-Yves Ribault.
- Pour la bibliographie, je me permets de renvoyer le lecteur à ma thèse, Saint-Pierre et Miquelon et la rivalité franco-anglaise à Terre-Neuve au XVIIIe s, (École Nationale des Chartes. Positions des thèses… Paris, École des Chartes, 1960, p. 97-102), partiellement publiée sous le titre Histoire des îles Saint-Pierre et Miquelon (des origines à 1814). Saint- Pierre, Impr. du Gouvernement, 1962. Voir également Bourde de la Rogerie (Henri), Saint-Pierre et Miquelon (des origines à 1778). Mor- tain, 1937 (extr. de la revue Le Pays de Granville) et Martineau (Alfred), Saint-Pierre et Miquelon dans Hanotaux (Gabriel) et Martineau (Alfred), Histoire des colonies françaises, t. I, L’Amérique. Paris, 1929, p. 245 à 259.
- On voudra bien se reporter à l’étude monumentale de M. de la Morandière (Histoire de la pêche française de la morue dans l’Amérique septentrionale. Paris, Maisonneuve et Larose, 1962, 2 tomes, 1023 p.) et à notre étude présentée au Congrès National des Sociétés Savantes tenu à Rennes en 1965 (La pêche et le commerce de la morue sèche aux îles Saint-Pierre et Miquelon de 1763 à 1793, à paraître dans les Actes de ce Congrès, Section d’Histoire moderne et contemporaine).
- Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 30-31 et Lauvrière (Emile). — La tragédie d’un peuple, 2e éd. Paris, 1923. 2 vol. Voir au tome II : Saint- Pierre et Miquelon, p. 221 à 245.
- Cf. Gaudet (Placide), Généalogie des familles acadiennes, dans Report concerning Canadian Archives for the year 1905, vol. II (1905), Ottawa, p. 150.
- Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 31.
- Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 34-35.
- Gaudet, op. cit., p. 150.
- Gaudet, op. cit., p. 150.
- Arch. Min. Aff. Étr., Anglet. 450, f° 415 et suiv.
- Arch. Min. Aff. Étr. Anglet., 452, f° 205.
- Gaudet, op. cit., p. 156.
- Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 29.
- « Quoi qu’on en ait dit, le gouvernement de Louis XV n’abandonna pas ces malheureux, il leur distribua des secours, à la vérité très minimes et irrégulièrement payés, et il chercha par d’importantes concessions à les indemniser des pertes qu’ils avaient subies. Mais, par suite du manque d’entente entre les fonctionnaires, par suite surtout des habitudes et du caractère des Acadiens, tous les efforts faits pour les établir en Poitou, en Corse, dans les Landes, en Limousin, en Louisiane, échouèrent plus ou moins misérablement. La colonie fondée à Belle-Isle et généreusement dotée par les États de Bretagne ne donna que des résultats médiocres. » Bourde de la Rogerie dans son introduction à l’ Inventaire-Sommaire des Archives Départementales antérieures à 1790. Finistère. Série B, tome III. Quimper, 1902, p. lxv.
- Cf. Gaudet, op. cit., Mémoire du 16 avril 1763 : « D’après les invitations écrites par Monseigneur dans les différents ports où résident ces pour les engager à passer aux Colonies il s’en est embarqué environ 500 tant pour Saint-Domingue et la Martinique que pour les îles Saint-Pierre. Il y a en outre actuellement, à Morlaix, 20 à 24 familles, formant environ 100 personnes qui demandent à passer à Cayenne. »
- A.N., Col., C12 1, f° 3 v».
- A.N., Col., F3 54, f° 467.
- A.N., Col., C12 1, f° 62 ; voir aussi A.N., S.O.M., État-Civil, registre 1, île Saint-Pierre (1763 à 1787).
- A.N., Col., C12, f° 61, et A.N., S.O.M., État-Civil, Saint-Pierre.
- Il s’agit de l’établissement du Kourou, tristement célèbre.
- A.N., Col., F3 54, f° 469.
- Cf. Gaudet, op. cit., p. 159.
- Gf. Gaudet, op. cit., p. 158.
- Ibid., p. 156.
- Le baron de l’Espérance commandait à Miquelon.
- A.N., Col., G12 1, f° 62.
- Ibid., f° 107.
- Ibid., f° 107 ; A.N., Col., C12 2, f° 22 et Gaudet, op. cit., p. 171.
- A.N., Col., F3 54, fû 478.
- A.N., Col., C12 2, f° 107-108.
- Ibid., f° 108 et Gaudet, op. cit., p. 171 à 176.
- A.N., Col., F3 54, f° 482.
- A.N., Col., C12 2, f° 82.
- A.N., S.O.M., Recensements, G1 467.
- A.N., Col., G12 2, f° 114 et suiv., 142 et suiv.
- Ibid., f° 164-165.
- Ibid., f° 172 : « Joseph Vigneau, dit Maurice, semble être à la tête du parti acadien hostile à Dangeac. »
- A.N., Col., C12 3, f<> 55-56 et 61.
- A.N., Col., C12 6, f° 13 v°.
- A.N., S.O.M., Recensements, G1 467.
- Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 51. Les registres de l’état-civil de Saint-Pierre mentionnent le 16 avril 1787 le mariage d’Adélaïde Benoît, née aux îles Malouines, et de Jacques Trégui de Saint-Pierre.
- A.N., S.O.M., Recensements, G1 467 et A.N., Col., C12 5, f° 4 et
suiv. - A.N., S.O.M., Recensements, G1 467 et A.N., Col., C12 5, f° 4 et
suiv. - A.N., Col., G12 7, f° 13 et suiv.
- A.N., S.O.M., Recensements, G1 467.
- Ibid.
- Cf. Sasco, Éphémérides, à la date du 20 juin 1793.
- Prowse (D. W.), A History of Newfoundland. Londres, New- York, 1895, p. 574.
- Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 53.
- Cf. David (R. P. Albert), Les Spiritains à Saint-Pierre et Miquelon dans Bulletin des Recherches Historiques édité par P. G. Roy, Québec, vol. XXV (1929), p. 283 et 437 à 441.
- Daubigny (E.), Choiseul et la France d’Outre-Mer, p. 167.
- Pour ce qui précède, voir David, p. 437-438. Des recherches dans les papiers de l’abbé de l’Isle-Dieu permettraient sans doute de découvrir des documents intéressants pour l’histoire des îles Saint-Pierre et; nous n’en voulons pour preuve que ce rapport au ministre où il déclare : « J’ai cru devoir supprimer (de mon rapport) toutes les autres
lettres que j’ai reçues des deux colonies de Saint- Pierre et de Miquelon, n’y trouvant rien qui concernât mon ministère et la fonction que je vis-à-vis d’elles, et il en sera de même de toutes celles dont j’ai la correspondance, car, grâces à Dieu, elles m’écrasent chaque année de ports de lettres et de mémoires, soit pour la Cour, soit pour la Ville et les Provinces et quoique je me sois défait du Vicariat Général du diocèse de Québec depuis qu’il a passé de la domination du Roi sous celle de Sa Majesté Britannique, on ne m’en fait pas plus de grâce et on ne m’en écrit pas moins surtout pour ce qui regarde la correspondance qu’ils sont obligés d’entretenir avec le Saint-Siège et la Sacrée Congrégation de la Propagande dont je me trouve le correspondant intermédiaire, non pour ce qu’elle veut faire passer à Québec en particulier et en général dans l’Amérique septentrionale, mais dans les autres missions
qu’elle a en Afrique, comme Loango, le Congo et autres. » (A.N., Col., C12 4, f° 20). - A.N., Col., C12 4, f° 22 et C12 6, f° 58.
- A.N., Col., C12 6, f° 19.
- A.N., Col., C12 16, f° 5.
- A.N., Col., F3 54, f° 558.
- A.N., Col., C12 16, f° 46.
- Ibid., f° 47 v°.
- A.N., Col., C12 10, fo 186.
- L’abbé Longueville, d’origine granvillaise, fils et frère de capitaines de navires, prêta le serment constitutionnel en 1792 ; à son retour en France, il s’établit à Saint Servan ; l’évêque de Rennes le nomma chanoine ; il mourut en 1815. L’abbé Le Jamtel, curé d’Arichat dans les mêmes îles, fonda ensuite la mission de Sydney et fut curé de Bécancourt ; il décéda en 1835. Cf. David, op. cit., p. 283 et Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 74.
- Cf. A.N., Col., F3 54, f° 574. 28 avril 1787, Ordre du roi pour au contrôle des îles Saint-Pierre et Miquelon du Bref de Préfet Apostolique accordé par la Cour de Rome à l’abbé Longueville.
- A.N., Col., C12 2, f° 153.
- A.N., Col., C12 2, f° 151.
- Ibid., f° 150.
- A.N., Col., C12 4, f° 22.
- A.N., Col., C12 6, f° 19.
- A.N., Col., C12 12, f° 164.
- A.N., Col., C12 1, f° 49, « État de demandes pour les deux chapelles du roy qui sont à Saint-Pierre et à Miquelon ». L’église de Saint-Pierre, en 1776, avait 60 pieds de long sur 24 de large ; elle était bâtie pour les trois quarts en piquets de bois de chêne et le quart en madriers de pin ; à l’intérieur, elle était lambrissée. A.N., S.O.M., Recensements, G1 463.
- A.N., Col., C12 23, f° 30, budget pour l’année 1773 : « Au sieur abbé Ardillier, pour remboursement de dépenses extraordinaires qu’il a faites pour la construction d’une église et d’une sacristie à Miquelon : 978 livres 10 sols.
- Cf. Bourde de la Rogerie, p. 54.
- Cf. A.N., S.O.M., État-Civil, registre de Miquelon : en août 1775, on trouve cette mention : « temps où l’on sortoit de détruire notre ancienne église et que l’on en bâtissoit une nouvelle » ; cf. également A.N., Col., C12 23, f° 73, budget pour l’année 1776 : « pour la reconstruction de l’église de Miquelon, 6.000 livres ».
- A.N., S.O.M., État-Civil, registre de Saint-Pierre (1763-1787), à la date du 26 juin 1774.
- A.N., Col., C12 5, f° 104. « Liste des effets appartenant à l’église que M. J. J. Bouguet a rapportés de ladite île, savoir : 10 aubes garnies, 4 aubes unies, 17 cordons, 21 purificatoires unis, 20 purificatoires garnis, 17 tours d’étole, 12 pales, 9 corporaux, 1 ornement de satin fleuri dont la croix est à fleur d’or, chappe et devant d’autel semblable, 1 ornement de damas blanc, devant d’autel pareil, 1 chappe fleurie de côté et noire de revers, 3 ornements communs et les devants d’autel semblables, 2 nappes d’autel, dont 5 garnies et 4 unies, 2 planchettes servant à du Saint-Sacrement, 2 niches, 4 nappes de communion, 12 grands surplis, 10 petites aubes d’enfants de chœur, 2 bénitiers de cuivre plus 2 autres usés, 2 encensoirs de cuivre, 1 encensoir d’argent fort mince, 2 burettes d’argent et leur plat, 1 lampe de cuivre argentée, 3 grands livres pour le chant, 4 antiphoniers et rituels, 2 missels, 1 croix de cuivre argenté, 4 crucifix (il en a été laissé 1 aux Anglais), 4 calices, 1 ostensoir ou soleil et 1 piscide, 2 petits ciboires, 1 dai d’un rouge écarlate, 2 écharpes et 1 voile épistolier, 3 cloches (les Anglais s’en sont emparés), 1 pierre sacrée. » Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 72, fait remarquer que cette confiscation des cloches était conforme à l’usage pratiqué dans toutes les villes conquises.
- A.N., Col., C12 7, f° 59.
- A.N., Col., C12 24, f° 67 v°. En 1787 avaient été placés dans l’église de Saint-Pierre une chaire, une balustrade, un confessional et une croix en fer et en 1788 une sacristie ; à la même époque, l’église de Miquelon fut ornée d’une chaire, d’une stalle, d’un bénitier et d’un devant d’autel ; en outre, on bâtit une chapelle dans le cimetière.
- A.N., Col., C12 3, f° 76.
- Cf. A.N., S.O.M., État-Civil, registre de Saint-Pierre (1763-1787).
- Ibid., Recensements, carton G1 467.
- A.N., Col., C12 12, f° 43.
- Ce long mémoire de Goueslard est contenu dans A.N., Col., G12 13, f° 101 à 153.
- Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 63.
- A.N., Col., C12 1, î<\61.
- Cf. A.N., S.O.M., G1, État-Civil. Il existe dans cette série cinq registres qui concernent l’état-civil de la colonie ; il s’agit des doubles originaux. Cf. A.N., Col., C12 6, f° 42 v°, lettre du ministre en date du 29 novembre 1776 : « Depuis ma dépêche, Messieurs, pour de l’édit du mois de juin dernier, portant établissement à Versailles d’un dépôt des papiers publics des Colonies, j’ay fait venir des papiers relatifs à ce dépôt, qui ont été envoyés précédemment à Rochefort.
J’ay trouvé parmi ces papiers des doubles collationnés sur les minutes des registres des baptêmes, mariages et sépultures pour la paroisse de Saint-Pierre, à compter de 1763 jusqu’au 30 novembre 1773, des doubles ou expéditions des registres de baptêmes, mariages et sépultures pour la paroisse de Notre-Dame des Ardilliers à Miquelon, à compter de 1763 jusqu’au 11 décembre 1773 ». Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 54, signale qu’il a pu étudier l’état-civil de Miquelon sur une copie moderne du registre original (16 octobre 1763 à fin 1771), apporté à Rochefort en 1778, passé ensuite aux archives de la Charente-Maritime à La Rochelle et rendu vers 1935 à la commune de Miquelon. - Ainsi, le 15 septembre 1767, en rédigeant l’acte de mariage entre Pierre Arondeau et Marie Sire, Paradis remarquait qu’il avait accordé « dispense du second ou troisième degré, peut-être du troisième degré au troisième degré de consanguinité (car ils s’expliquent, ces bonnes gens, avec tant de bonacité, que, avec toute notre complication, nous ne pouvons rien statuer de juste là-dessus) ». Cf. A.N., S.O.M., Etat-Civil, registre de Miquelon (1763 à 1789).
- Cf. Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 55. Nous devons à cet auteur de nombreuses et précieuses remarques. Il note par exemple que dans les registres paroissiaux de Saint-Servan, se trouve, à la date du 30 novembre 1720, l’enregistrement d’un mariage contracté en 1718 à la côte du Chapeau-Rouge, par J. Salomon de Saint-Jean de Luz et Françoise Delafosse de Toulouse ; les époux avaient refusé les services d’un ministre protestant anglais. Il rappelle également que la pratique de ces « mariages privés » n’était pas rare au Canada, cf. Bonnault (Cl. de), « La Vie Religieuse dans les paroisses rurales canadiennes, » dans Bulletin des Recherches Historiques de Québec (nov. 1934), p. 637. Enfin, il signale que l’évêque de Québec autorisa en 1785 un laïc de l’île Saint- Jean, Jean Doucette, à recevoir les consentements des personnes qui désiraient se marier, pourvu qu’il n’y eût entre elles aucun empêchement de parenté ou d’affinité. Cf. Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 54-55.
- Cf. Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 55.
- A.N., Col., C12 2, f° 42, et suiv.
- Paradis semble avoir perdu la juste notion des choses ; l’énumération de ses titres et qualités prenait plusieurs lignes dans les actes qu’il rédigeait : « Vice-pro-préfet apostolique des isles Saint-Pierre et Miquelon, de présent désigné et réputé préfet apostolique des susdites mem.es isles, chargé spécialement des fonctions curiales, etc. ». Il qualifiait Miquelon de cille et Dangeac de « gouverneur généralissime ».
- A.N., Col., C12 1, f° 4.
- A.N., Col., C12 2, f° 22.
- A.N., Col., C12 3, f° 49.
- A.N., Col., C12 5, f° 20.
- A.N., Col., C12 5, f° 72.
- A.N., Col., C12 8, fo 54.
- A.N., Col., C12 8, f° 55.
- Au xixe siècle, les sauvages micmacs continuèrent à fréquenter la colonie. Sasco dans ses Éphêmêrides signale à la date du 23 mai 1817, la relâche forcée à Miquelon, par suite de la perte du gouvernail de leur chaloupe, de 54 sauvages, hommes, femmes et enfants, qui se rendaient à Saint-Pierre accomplir leurs dévotions annuelles ; un contingent de la même tribu vint à Miquelon, le 17 août 1834, dans le même but, enfin, le 12 septembre 1842, le chef d’une peuplade, connu sous le nom de « roi Michel Agathe », et plus de cent personnes de sa tribu, se perdirent corps et biens dans une tempête en s’en retournant de Saint-Pierre. Fait plus émouvant encore, au début du xxe siècle, le géographe Perret qui explora Terre-Neuve reprit contact avec ces indiens micmacs. « Nos anciens
dit-il, ont gardé l’usage de la langue française et la pratique du catholicisme romain. Ils rnènent la vie errante des caribous qu’ils suivent à la piste, transportent leurs familles en canot le long des lacs, des rivières et des portages, passent l’été sur les côtes de la baie Blanche et l’hiver près de Saint-Georges. Leur nombre n’excède pas 400 individus. On leur a fait, bien à tort, la réputation d’être intraitables » (cf. Perret, op. cit., p. 279). Il serait intéressant de savoir si cette tribu a encore des représentants à Terre-Neuve, de nos jours, et s’ils sont toujours fidèles aux traditions françaises. - Pour les actes d’état-civil cités tout au long de ce chapitre, nous n’avons pas indiqué de références. Ils sont en effet assez faciles à retrouver, à leur date, dans les registres de l’état-civil ancien conservés au Archives Nationales, Section Outre-Mer.
- A.N., Col., C12 1, fo 3.
- A.N., Col., F3 54, f° 458.
- Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 43.
- A.N., Col., G12 3, f° 183, Etats de service de Dangeac.
- Ibid., f° 24.
- A.N., Col., D2 C 50.
- A.N., Col., C12 3, f° 12, 17 et 18.
- A.N., S.O.M., État-Civil, Registre de Saint-Pierre.
- Lorsqu’il se retira en 1773, Dangeac les em.mena avec lui à Soubise en Saintonge et après sa mort, elles reçurent une pension de 500 livres chacune, réduite à 150 livres en 1791. A.N. Mar., B. 189.
- A.N., Col., C12 3, f° 70.
- Ibid., f° 132.
- A.N., Col., C12 3, fo 183.
- Ibid., fo 140.
- Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 43.
- Le fiancé était dit fils de feu Jean Fleury de l’Espérance, baron du Saint-Empire, lieutenant-colonel du régiment du prince de Mont-Béliard (personnage sans doute fictif) et de dame Sébastienne.
- A.N., Col., Da G 50.
- La pierre tombale de la seconde baronne de l’Espérance demeure le seul vestige que Miquelon ait conservé de son passé antérieur à la Révolution. En granit rouge, rongé par le temps, cette pierre constitue une relique bien émouvante. Cf. Nova Scotia, t. I (1925), p. 231 et 278.
- A.N., Col., C12 3, f° 153.
- Le contrat de mariage, passé par-devant le notaire Mounier, la communauté de biens à l’exception des dettes, un douaire préfix de 3.000 livres tournois, un préciput égal et réciproque de 1.500 livres au survivant et une donation mutuelle en cas de non-postérité, à la réserve de 30.000 livres à partager, au décès du baron, entre ses neveux et nièces, les enfants de Coux. En effet, à la mort en 1766 du capitaine de Coux, veuf de Marguerite-Henriette de l’Espérance, le baron de l’Espérance avait recueilli ses six neveux et nièces devenus orphelins. Cf. A.N., S.O.M., Notariat G3 479 et A.N., Col., C12 2, f° 23.
- Tous les actes d’état-civil auxquels il est fait allusion se trouvent dans le registre de Saint-Pierre.
- Dupleix-Sylvain pour conserver l’état-civil de sa famille, malgré les pérégrinations qu’elle avait accomplies, fit enregistrer par le notaire de Saint-Pierre, les principaux actes. Ils se trouvent donc au A.N., S.O.M., Notariat, registre G3 479, in fine.
- Les deux aînés, Jean-Baptiste et Marguerite, étaient nés en 1759 et 1762 ; une autre fille Victoire, née en 1760, mourut à Saint-Pierre, le 1er novembre 1764 ; puis il y eut Marie-Geneviève, née le 16 octobre 1763, dont Marie-Geneviève Dangeac fut marraine ; Louise-Marguerite née le 29 décembre 1764, tenue sur les fonts par Marguerite Le Neuf de Beau-Bassin de Courval, mourut le même jour ; le 9 décembre 1765 naquit Jeanne qui eut pour marraine demoiselle Jeanne-Françoise Rodrigue ; Antoine Rodrigue fut parrain le 4 mars 1767, de Charles-Antoine dont la marraine fut Marie-Charlotte Daccarette. Marie-Charlotte Dangeac donna son prénom à Marie-Charlotte Dupleix-Sylvain née le 22 mai 1768, dont le chirurgien Edme Henry fut parrain ; l’enfant décéda le même jour. Après Edouard né le 17 février 1770, il y eut à qui, le 26 mars 1771, François-Xavier de Savigny, assisté de Jeanne-Françoise Jacau, épouse d’Antoine Rodrigue, donna son prénom. Edme Henry, le chirurgien, assisté de Charlotte-Dangeac de La Fuye, parraina Edme, né le 22 février 1773. Enfin, le dernier enfant de Dupleix-Sylvain, Marguerite-Joséphine, née le 27 janvier 1775, eut pour parrain et marraine Pierre Rodrigue et Marguerite-Louise de Coux de Beau-Bassin.
- A.N., Col., Cllc7, f<> 54.
- Les enfants d’Antoine Rodrigue se prénommaient Antoine, né en 1751, Pierre-Joseph né en 1753, Jeanne-Françoise née en 1754, Charles-Joseph né en 1763, Michel né le 1er avril 1765, mort à 22 ans le 11 1787, Louise née le 10 février 1766, morte le 28 août 1768, Domitille née le 30 avril 1768, François-Edme né le 24 novembre 1772.
- LAUVRIÈREop. cit., (p. 228) et Bourde de la Rogerie op. cit., (p. 47) indiquent que la famille Loyer-Deslandes était originaire du Havre et qu’un de ses membres avait commercé à Louisbourg. François Loyer-Deslandes se maria, en tout cas, avec une certaine Marie Lemonnier, et leur fils naquit à Granville en 1736. Ce dernier vint s’installer à Saint-Pierre, s’y maria le 10 juillet 1770 avec Marie Arondel, originaire de Louisbourg, et en eut quatre enfants. Il prit une très grande part aux troubles qui survinrent dans la colonie à partir de 1791. Son fils Simon devint de vaisseau (Arch. d’I.-et-V., 4 Fgl29 : États de services de Simon Loyer-Deslandes, an III-1827).
- Un Douville avait été le premier habitant de l’île Saint- Jean ; on trouve à Saint-Pierre, dès 1763, un Jacques Douville de l’île Saint-Jean, marié à Judith Kemine acadienne, qui perdit le 17 octobre 1763 sa fille Anne-Marie née en 1762 à Saint-Servan. Plus tard, en 1785, un Philippe-Charles Douville se. maria à Saint-Pierre, avec Marie-Julienne Le de Louisbourg, en eut un fils Philippe-Bertrand né le 21 1788 et mourut à 46 ans le 27 juin 1789. Son frère Pierre Douville était lieutenant de vaisseau des Etats-Unis, se maria lui-même avec une américaine Cinthia Aborn, dont il eut deux fils, l’un, Charles, né le 14 avril 1786, à Rhodes-Island et baptisé à Saint-Pierre le 13 juillet 1788, l’autre, Samuel- Joseph, né à Saint-Pierre le 22 juillet 1788, et dont la marraine fut sa cousine germaine Judith-Joseph Douville.
- La famille Rosse était originaire de Louisbourg ; le 3 septembre 1767, Marie Rosse, fille de Noël et de Marie Herpin se maria avec Jean Hesry, officier navigant, demeurant à Saint-Malo et s’en alla vivre en France. Son frère Noël Joseph demeura dans la colonie jusqu’en 1789, date à laquelle il décida de se retirer avec sa fem.me et ses quatre enfants à l’Ile de France où des parents aisés l’appelaient. Un René Rosse fut capitaine de navire durant les guerres de la Révolution et de l’Empire (cf. Bourde de la Rogerie, Introduction à V Inventaire-Sommaire des archives du, Finistère, t. III, p. lxvi).
- Vers 1780, Pierre Dupont commanda les corsaires de Saint-Malo, La Jeune Olympe, Le duc de Chartres et Le Flesselles (Bourde de la Introduction à V Inventaire- Sommaire des Archives du Finistère, t. III, p. lxvi).
- Cf. Bourde de la Rogerie, Saint-Pierre et Miquelon, p. 57.
- Nous avons glané les noms des ouvriers et artisans cités dans ce paragraphe, dans le livre de comptes de l’ordonnateur, pour les années 1783 à 1787, A.N., Col., C12 22, f° 104 à 227.
- A.N., Col., C12 2, f° 140.
- Ces registres sont conservés aux A.N., S.O.M., Notariat G3 478 et G3 479 ; ils ne sont pas paginés, ce qui rend impossible de placer sous une cote précise les documents dont nous faisons mention dans ce paragraphe
- Marie Rosse, fille de feu Noël Rosse, apporta, le 25 août 1767, à son futur mari, Jean Hesry, capitaine de navire, demeurant à Saint-Malo, une dot de 4.000 livres. Le 28 octobre 1767, Jeanne-Marie Le Tourneur apporta à Jacques Debon une dot de 1.000 livres. Le 8 avril 1769, Gabrielle Roisfier apporta au pêcheur François Gadiou une dot de 400 livres, etc.
- Le 4 février 1765, Jean-Pierre Tournier constitua pour Jeanne Roullot un douaire préfix de 600 livres. Le 17 juillet 1771, le capitaine Alexis-Bertrand Dubois, de Saint-Malo, fixa le douaire qu’il destinait à Madeleine Morin, à une somme de 10.000 livres. Le 29 septembre 1771, Pierre-Joseph Bannet constitua pour Anne Arondel, un douaire de
1.000 livres. Enfin le baron de l’Espérance, à l’occasion de son mariage avec Jeanne-François Rodrigue, assigna 3.000 livres pour son douaire préfix. - A.N., Col., C12 2, f° 114.
- A.N., S.O.M., Recensements, G1 467.
- Une habitation de pêche constituait une unité d’exploitation ; elle comprenait une étendue de grave, plage couverte de galets où l’on exposait la morue pour la faire sécher, un éehafaud où les chaloupes débarquaient le poisson péché et où des matelots spécialisés les morues, des cabanes où logeaient les pêcheurs, des magasins et naturellement la maison du propriétaire ou du gérant d’habitation
- Ces différentes embarcations sont citées par ordre d’importance, mais il est bien difficile de leur assigner des tonnages caractéristiques. Une goélette au long-cours jaugeait de 50 à 100 ou 120 tonneaux, une goélette de pêche de 30 à 50 ou 60 tonneaux ; une chaloupe, de 15 à 25 ou 30 tonneaux ; ces trois catégories formaient la classe des bâtiments pontés. Les barquettes, canots et warys allaient à la rame, avec parfois une petite voile d’appoint ; ils n’étaient pas pontés. Il existait des plus forts que la goélette et gréés différemment ; c’étaient les brigantins, 60 à 150 ou 160 tonneaux, les bateaux et les navires qui atteindre 300 ou 400 tonneaux.
- Cf. A.N., S.O.M., Recensements, G1 467.
- A.N., S.O.M., Dépôt des Fortifications, Saint-Pierre et Miquelon, carton 1, pièce 16.
- Ibid., pièce 17.
- L’inspection de Woodmass eut pour cause l’inquiétude du britannique, de Hillsborough en particulier, devant du commerce de notre petite colonie ; ils soupçonnaient que ces progrès étaient dûs à la contrebande. Woodmass ne remarqua d’ailleurs aucune infraction aux traités durant sa visite ; il ramena un rapport par le pitoyable tableau qu’il faisait de nos établissements. Placide Gaudet a publié toutes les pièces relatives à cette affaire dans Report concerning Canadian Archives for the vear 1905, vol. II (1905), Ottawa, p. 215 à 233.
- Dangeac déclarait, en octobre 1768, que « les cases » de Miquelon étaient bâties de piquets plantés en terre, sans doublage, avec une de gazon et une cheminée en torche de foin mêlée à de la terre grasse.
- A.N., S.O.M., Recensements, G1 467.
- Ibid.
- Ibid., G1 463, f° 53.
- A.N., S.O.M., Recensements, G1 463, f° 55.
- Ibid., fo 56 v».
- A.N., S.O.M., Recensements, G1 463, f° 62.
- Ibid., fo 64 v°.
- A.N., S.O.M. Recensements, G1 463, f° 65-66.
- A.N., Col., C12 9, f° 146 et suiv.
- A.N., Col., F3 54, f° 559.
- A.N., Col., C52 10, f° 69 et suiv.
- Nous avons recueilli ces surnoms un peu partout dans les que nous avons consultés, mais spécialement dans le registre cité A.N., Col., G12 22.
- Jean-Dominique Cassini y vint en mission, pour étudier l’exactitude et la résistance de nouvelles montres marines. Il publia en 1770 le récit de sa mission dans un petit ouvrage intitulé Voyage fait par ordre du roi en 1768, pour éprouver les montres marines inventées par M. Le Roy… Paris, 1770, in-4°. Ce petit volume contient quelques planches, dont l’une nous est précieuse car elle représente, avec une grande exactitude, semble-t— il, une vue de la rade de Saint-Pierre. Pour le séjour de Chateaubriand, nous avons utilisé l’édition des Mémoires d’Outre-Tombe, par Maurice Levaillant et Georges Moulinier. Paris, 1951, in-16, xxxn-1233 p. {Bibliothèque de la Pléiade, tome 67).
- En fait, M. Danseville n’était que commandant faisant fonction de gouverneur.
- Marcel Proust admirait beaucoup ce passage des Mémoires de Chateaubriand. C’est là un prolongement inattendu de l’histoire des îles.
- La flore de Saint-Pierre a été décrite par le célèbre Auguste Bachelot de la Pylaie dans un ouvrage fort austère, Flore de Terre-Neuve et des îles Saint-Pierre et Miclon (sic)… Paris, 1829. In-fol.
- La précision et l’exactitude avec lesquelles Chateaubriand rapporte la toponymie de l’île constituent un petit mystère. Comme on ne voit pas très bien où il aurait pu se documenter, il nous faut croire qu’il avait pris à Saint-Pierre même des notes, qui lui servirent plus de vingt ans après, à rédiger ce passage.
- Chateaubriand est bien le seul auteur qui ait pu imaginer la d’ours blancs à Saint-Pierre !
- Si nous avons rencontré quelques exemples de navires se rendant de Saint-Pierre en Méditerranée, aucun ne se dirigeait vers Gênes. devait songer aux bâtiments de Saint-Malo qui, partis de la côte du Petit-Nord, gagnaient en grand nombre Marseille et certains même l’Italie.
- Rameau de Saint-Père, Une colonie féodale en Amérique. L’Acadie (1604-1881). Paris, Montréal, 1889. 2 vol. in-12 ; voir tome 2, p. 234.
- Cf. supra.
- A.N., Col., C12 1, fo 100.
- Bourde de la Rogerie, op. cit., p. 39.
- Papy (Louis), dans Annales d’histoire économique et sociale, t. X (1938), p. 160-161, Compte rendu de l’ouvrage de Louis-Legasse Évolution économique des îles Saint-Pierre et Miquelon. Paris, 1935. In-8°, 182 p.
Source : Ribault Jean-Yves. La population des îles Saint-Pierre et Miquelon de 1763 à 1793. In: Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 53, n°190-191, premier et deuxième trimestres 1966. pp. 5-66.